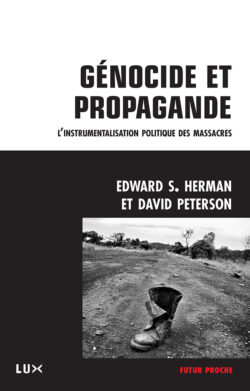Sous-total: $
Liens socio – Lectures
Edward S.Herman, David Peterson, Génocide et propagande, L’instrumentalisation politique des massacres
Nelcya Delanoë
Intitulé The Politics of Genocide et ouvert par un avant-propos de Noam Chomsky, ce livre a été publié à New York par la Monthly Review Press en 2010 et traduit en 2012 par la maison d’édition québécoise Lux, éditeur tout aussi indépendant que le précédent. C’est que le travail d’Edward S. Herman et David Peterson, connus pour leur professionnalisme de journalistes engagés, s’inscrit dans une lignée de chercheurs déterminés à déchiffrer, et à démasquer, la rhétorique utilisée par les Etats-Unis et la grande presse américaine, particulièrement en matière de politique étrangère. Chomsky en est la figure de proue. Dans son avant-propos, il écrit que ce livre analyse comment «la fin de la guerre froide a ouvert la voie à une ère littéralement négationniste».
Comme l’indiquent titre et sous-titre, il s’agit en effet ici de démonter les rouages qui contribuent, chacun, à «l’instrumentalisation politique des massacres», ou encore de montrer comment «la politique du génocide» est efficace grâce à «des organes de l’establishment et notamment de medias, d’intellectuels et de militants… pleinement intégrés aux structures du pouvoir» (p. 15). Sont passés en revue génocides ou massacres ayant eu lieu au Darfour, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, au Rwanda et en République démocratique du Congo, en Israël, en Croatie, en Afghanistan, en Turquie et en Irak, en Indonésie, au Salvador, au Guatemala. Enfin, suite à une préface à l’édition française rédigée par les auteurs, en Lybie et au Sri Lanka.
Parmi les génocides, les auteurs distinguent deux catégories. La première recense les «génocides constructifs», à savoir ceux qui servent les buts, avoués ou pas, de la puissance américaine et de ses alliés, reliés par les médias de l’establishment. Aucun de ces protagonistes n’est qualifié, ipso facto, pour en parler comme de génocides. Selon les cas, il s’agit de lutte contre le terrorisme, contre les rebelles, l’ennemi, les communistes, les djihadistes, les génocidaires. Ces glissements sémantiques et leurs développements aboutissent ainsi à la minoration voire à la normalisation d’un génocide effectif, rabaissé au prix de la guerre, de ses justes victoires, et à des dégâts collatéraux.
L’exemple phare est celui de l’Irak. Adoptées en 1990 à la suite de l’invasion du Koweït par l’Irak, les sanctions économiques (1990-2003) contre ce pays, bientôt dévasté par la guerre, sont analysées comme «la plus vaste entreprise génocidaire des trente dernières années». La destruction des réseaux d’eau potable, suivie du blocage des projets de réparation avec expansion de maladies voire d’épidémies alertèrent l’OMS et l’UNICEF et entraînèrent la démission successive de deux coordonnateurs aux Affaires humanitaires de l’ONU en Irak, dont l’un parle de «génocide», sans ébranler pour autant le Comité de sanctions. «Il s’agissait de mettre à genoux l’une des premières puissances du Moyen Orient en préparation de l’invasion/occupation de 2003» (p. 50).
Intitulé «Différentiel d’attribution du terme de génocide à différents cas de massacres», un tableau récapitulatif parle en chiffres, clairs et éloquents. Sont convoquées, en entrée principale, «les victimes, responsables ou causes». Ici, l’estimation du nombre de civils irakiens morts des suites de l’embargo -800 000-, le nombre d’utilisations du mot «génocide» dans la presse écrite américaine -80-, la proportion d’utilisation du mot «génocide» -1-, la proportion du mot «génocide» par rapport au nombre de morts -1 pour 10 000. Les proportions sont encore plus criantes dans le cas de l’invasion/occupation de l’Irak, dont le nombre de victimes est pourtant supérieur -un million-. Jusqu’à l’administration Obama comprise, aucune mention n’a été faite de la fabrication des preuves d’«armes de destruction massive» détenues par Saddam Hussein, fabrication qui servit pourtant de prétexte au déclenchement de la guerre. En 2007, le futur le vice-président Biden parlait plutôt de la dette que les Irakiens avaient envers les États-Unis (p. 56). Mass media (télévision et presse écrite, dont le New York Times et le Washington Post) ont longtemps et abondamment relayé cette version héroïque et sacrificielle, muette sur ses ambiguïtés et sa finalité, locale, régionale et au-delà. Un appareil de notes précis et détaillé permet au lecteur de se reporter aux sources et de vérifier les données utilisées dans l’argumentation, accablante.
6Une deuxième catégorie analyse les «génocides néfastes» que les États-Unis et leurs alliés, -dont l’ONU, l’OTAN et les cours de justice- qualifient cette fois bel et bien de génocides. Les perpétrateurs de ces génocides-là sont alors mis au banc de la communauté internationale qui invoque contre eux la mise en application de «la doctrine de protéger», adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 septembre 2005 (A/RES/60/1). S’ensuit une guerre, appelée de leurs vœux par les dirigeants, légaux ou légitimes selon le cas, du peuple martyr. Manière, comme dans la catégorie précédente, de servir les buts, avoués ou pas, de l’empire américain et des puissances qui le soutiennent. Mais manière inversée, selon le système de deux poids et deux mesures. Cette dichotomie dans la qualification officielle des responsabilités stratégiques des uns et des autres permet, au nom de valeurs démocratiques classiques, de faire passer l’inacceptable pour du désirable auprès de l’opinion publique. Un trompe-l’œil et un outil. Un leurre.
L’exemple le plus intéressant est celui du conflit du Rwanda -800 000 morts, 481 utilisations du mot «génocide» dans la presse écrite américaine, soit une proportion d’utilisation de 40, et de 1 pour 250 morts. La réponse à la question clef -pourquoi les États-Unis ont pesé «de tout leur poids pour obtenir le retrait des troupes de l’ONU alors que le ‘génocide’ commençait»- est tout simplement que l’armée ougandaise et le FPR faisaient au Rwanda ce que les Etats-Unis désiraient qu’on y fasse (p. 76). Après cette assertion brutale, les auteurs s’emploient à décortiquer ce qu’il en fut de l’attentat contre l’avion des présidents du Rwanda et du Burundi et de l’inversion consécutive du rapport prédateur/victime. Ce qui était une conspiration du FPR de Kagamé pour prendre le pouvoir et surtout pour le garder fut ensuite relayé par les États-Unis, leurs alliés, la couverture médiatique, des ONG et des intellectuels comme génocide ethnique, avec peu d’éclairage sur le sort de milliers de civils Hutus massacrés (25 000 à 45 000 morts). Les agresseurs initiaux passaient ainsi pour les défenseurs de l’unité nationale contre les extrémistes hutus. Ce montage strictement racialisé estompait jusqu’à la faire disparaître la dimension politique d’un conflit destiné à contrôler une bonne partie des Grands Lacs, dont la République démocratique du Congo et ses fabuleuses ressources. Là encore, l’abondance des documents cités ou consultables aide à démêler l’écheveau des connivences, des distorsions et des omissions à différents niveaux -agences internationales, responsables politiques, militaires, judiciaires, mass media- en faveur d’une version univoque, qui dit le bien et lui ouvre la voie.
Deux autres catégories, consacrées aux « massacres », permettent de compléter et de conforter l’argumentation. Il s’agit en effet de massacres présentés comme « bénins » par leurs auteurs et leurs alliés américains, quand ils ne sont pas qualifiés de « bains de sang mythiques ». Le massacre de Sabra et Shatila (1982) et l’invasion de Gaza (décembre 2008/janvier 2009) illustrent le premier cas, le massacre de Racac (Kosovo, 15 janvier 1999) le deuxième cas. Moins connu, cet événement fut présenté tour à tour par la presse anglaise et américaine comme «le massacre de 45 villageois par les Serbes du Kosovo… corps mutilés… carnage… yeux arrachés, têtes fracassées…» Condamné par Bill Clinton, Kofi Annan, Robin Cook, Louise Arbour, ce massacre a joué un rôle charnière pour la suite de la guerre. L’analyse méticuleuse qu’en font les auteurs leur permet d’aboutir à la conclusion selon laquelle les 40 morts de ce jour-là étaient des combattants, tués dans le feu de l’action et non exécutés. Ce champ de cadavres regroupés à des fins démonstratives de « massacre » devenait l’incident qui permettait à l’OTAN « d’avaliser les frappes aériennes contre des objectifs situés sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie », planifiée depuis des mois (p. 124). Les États-Unis n’ayant pas reconnu la compétence de la Cour internationale de Justice, celle-ci se déclarait à son tour incompétente pour examiner les plaintes de la Yougoslavie mettant en cause les États-Unis. En somme, la Cour reconnaissait le statut d’impunité « dont les grands inégaux jouissent depuis toujours » (p. 140).
Certes. Et c’est peut-être là à la fois la faiblesse et la force de ce livre. Il démontre à l’envi la faculté qu’ont les grandes puissances et leurs relais dans la société civile d’utiliser l’histoire pour faire vivre une version officielle, celle des vainqueurs. En somme rien de nouveau sous le soleil. Mais cette démonstration, analytique et synthétique, conduite avec vigueur et documents à l’appui, incite à la réflexion, aiguise l’esprit critique et invite à la recherche.
 Mon compte
Mon compte