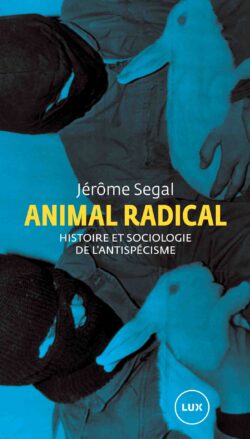Sous-total: $
Vers l’Internationale animaliste
Plongeant ses racines dans le militantisme social du XIXe siècle, l’antispécisme multiplie aujourd’hui ses discours et ses stratégies. Prenons garde à ne pas l’uniformiser.
L’historiographie francophone de la cause animale s’est dans les dernières années enrichie de travaux fouillés tant en sociologie historique qu’en sociologie de l’engagement. Parmi eux, le livre Animal Radical de Jérôme Segal propose une perspective historique sur l’antispécisme, idée inconnue du grand public il y a quelques années et aujourd’hui mobilisée lors de débats politiques, que ce soit par ses partisans ou ses adversaires. À partir d’une question large sur l’origine de la cause animale et de ses aspects les plus radicaux, le livre s’intéresse à l’histoire de ce courant de pensée, dont les tenants récusent l’idée que l’espèce humaine serait plus digne de considération morale que les autres espèces animales. Le concept de radicalité se situe au cœur de l’analyse du livre, entendu tour à tour comme radicalité du discours, des actes ou dans son sens initial, comme manière d’appréhender la racine d’un problème — ici, le spécisme.
L’ouvrage est organisé en deux parties. La première commence au début du XIXe siècle, époque où sont fondées les premières sociétés de protection animale, et explique comment certains militants passent, à la fin du siècle, de la protection à la défense plus active des droits des animaux, jusqu’à la naissance d’un mouvement antispéciste à partir des années 1970. La seconde partie propose un regard sociologique sur l’antispécisme contemporain, en mettant en lumière les diverses stratégies des associations militantes ainsi que la complexité des débats autour du spécisme. Trois cas nationaux sont convoqués pour illustrer l’analyse : la France, le Québec et Israël.
Histoire de la cause animale radicale
Si les premières lois de protection contre la cruauté envers le bétail sont introduites, en France notamment, par des hommes de différentes orientations politiques, c’est surtout dans les courants de gauche qu’on trouve les défenseurs les plus radicaux de la cause animale. Alors que Marx et Engels raillent les protecteurs des animaux dans le Manifeste du parti communiste (1847), des figures comme le géographe Élisée Reclus ou la militante anarchiste Louise Michel tiennent des propos qui ne diffèrent guère, finalement, de ceux des activistes contemporains. Reclus met ainsi sur le même plan le meurtre d’un humain et celui d’un animal, et dit embrasser les bêtes dans son « affection de solidarité socialiste » (p. 35). Quant à Louise Michel, elle est parmi les premières à dresser, dans ses Mémoires, le parallèle entre l’exploitation humaine et animale. Ce sont en effet les « tortures infligées aux bêtes » (p. 36) qui, dès son plus jeune âge, la poussent à se révolter contre le pouvoir des forts et des puissants. Certes, le concept d’antispécisme n’est pas encore inventé, mais on trouve déjà la trace d’idées similaires chez certains auteurs, en particulier à travers des critiques de l’élevage et de la chasse. Segal montre par ailleurs que l’engagement en faveur des animaux — comme celui de Marie Huot, fondatrice en 1883 de la Ligue populaire contre l’abus de la vivisection en France — est considéré comme pathologique par divers psychiatres de l’époque. Celles et ceux qui ne mangent plus de viande et s’opposent à l’abattage des animaux souffriraient de ce que ces médecins nomment la « zoophilie » et qui serait, aux côtés du « saphisme » et de la « pédérastie » (p. 43), un signe de dégénérescence mentale.
Il faut attendre le milieu du XXe siècle pour qu’émerge le concept d’antispécisme, forgé sur le modèle du mot antiracisme par un collectif d’étudiants et d’étudiantes d’Oxford. Proche de ce groupe, le philosophe Peter Singer contribuera à populariser le terme dans son ouvrage Animal Liberation (1975). En adoptant un vocabulaire utilitariste inspiré de Jeremy Bentham, Singer y défend l’idée que la plupart des animaux ont des intérêts, dont le plus fondamental est l’intérêt à ne pas souffrir : c’est là le seul critère moral qui importe, au-delà de l’espèce. Parallèlement à la parution du livre de Singer, qui connaît un certain retentissement, des groupes comme l’Animal Liberation Front se forment au Royaume-Uni. Ces groupes prônent non pas la protection, mais la libération des animaux, que ce soit par l’ouverture des cages ou plus généralement par leur émancipation du joug humain. À la même époque, aux États-Unis, c’est l’ancien militant pour les droits de la personne Henry Spira qui marque les esprits, avec sa campagne contre les tests cosmétiques effectués sur les animaux. En France, l’antispécisme se fait connaître plus tardivement, dans les années 1990, par le biais d’une revue : fondés à Lyon, « Les Cahiers antispécistes » mettent la sentience (ou sensibilité) au cœur de leurs réflexions. Ces antispécistes tiennent un discours radical, en proposant de renverser l’ordre spéciste, mais défendent également une vision pragmatique du militantisme, qui fera des émules au sein de l’association L214 « Éthique et animaux », fondée en 2008.
Sociologie de l’antispécisme
Plus qu’une histoire intellectuelle, Animal Radical propose un regard à la fois politique, sociologique et culturel sur l’antispécisme. On découvre ainsi comment la défense des animaux par les anarchistes du début du XXe siècle s’inscrit dans une remise en cause de l’industrialisation : en fondant des communautés végétaliennes en France et en Suisse, certains d’entre eux prônent le retour à la nature pour se libérer du « prétendu progrès de la civilisation » (p. 47). Segal décrit également la manière dont des groupes punks anglais des années 1970-1980, comme le groupe Conflict, en viennent à défendre, en tant que pacifistes, la cause animale et le végétarisme, plus de vingt ans après la création de la Vegan Society au Royaume-Uni.
Résolu à écrire une histoire située de l’antispécisme, Jérôme Segal analyse dans la seconde partie de son ouvrage la manière dont les militants, les associations et les groupes s’approprient, transforment et font évoluer les idées antispécistes. Son enquête se fonde sur une trentaine d’entrevues semi-directives, une démarche d’observation participante de plusieurs mois dans un collectif militant (269 Life) et sur sa connaissance personnelle du milieu animaliste.
En premier lieu, l’auteur se penche sur la variété des discours et des stratégies qui animent le mouvement. Il retrace les origines des différentes analogies entre l’exploitation animale et, d’une part, l’Holocauste, mais aussi, d’autre part, l’esclavage ou le traitement des femmes. Segal relève ainsi l’existence d’une « filiation directe, technique et idéologique » (p.118) entre les abattoirs et les camps d’extermination nazis, dont la conception fut probablement influencée par le fordisme, lui-même inspiré par la modernisation des techniques d’abattage au début du XXe siècle. Sur le plan conceptuel, de nombreux auteurs et autrices, tels que Théodore Adorno, Isaac Bashevis Singer, Primo Levi ou encore Marguerite Yourcenar ont dressé des parallèles entre les génocides et le traitement du bétail. L’analyse de ces comparaisons permet ensuite à Segal d’aborder la convergence des luttes féministes, antiracistes, anticapitalistes, écologistes et LGBTQ dans un mouvement qui compte environ deux tiers de femmes. Toutefois, le mouvement antispéciste semble divisé entre la volonté de faire front commun contre toutes les oppressions, et celle de mettre en son cœur la spécificité de la cause animale, souvent reléguée à l’arrière-plan des luttes.
L’auteur analyse en second lieu les débats stratégiques qui traversent la cause. Au centre des débats, une double tension qui opère entre réformisme et radicalisme d’un côté ainsi qu’entre véganisme et antispécisme de l’autre. Certains collectifs militants, comme Boucherie Abolition en France, jugent ainsi les actions de L214, comme les enregistrements vidéo à l’intérieur des abattoirs, trop timides et critiquent ces actions « réformistes » (p. 167). Boucherie Abolition, ainsi que 269 Libération animale en Suisse, prônent donc des méthodes plus radicales, à savoir la libération d’animaux ou le blocage des abattoirs. Quant au véganisme, certains militants le considèrent comme une forme de consumérisme dépolitisé, par opposition à un mouvement antispéciste plus explicite dans sa désignation de l’ennemi politique, le spécisme, et de ses victimes, les animaux non humains.
Discussion
Animal Radical brosse un portrait fin, documenté et accessible de la cause antispéciste. Le récit historique et l’enquête sociologique permettent une lecture fluide qui emporte le lecteur. En prenant soin de toujours ancrer les concepts dans leur contexte sociopolitique, le livre illumine les débats contemporains à la lumière du passé et souligne la filiation de l’antispécisme avec les premiers défenseurs radicaux de la cause animale, même si les années 1970 marquent un tournant dans le mouvement, l’éthique animale devenant un objet d’intérêt autant pour les intellectuels que pour les militants qui s’en approprient les concepts.
On peut s’interroger toutefois sur la sélection des cas nationaux. Si l’on comprend en filigrane qu’Israël, le Québec et la France ont été choisis parce que le mouvement antispéciste y est plus visible qu’ailleurs, il aurait été intéressant de tourner le regard vers d’autres espaces. En effet, dans certains pays, les mouvements ont une identité collective moins proche de l’antispécisme que du véganisme, et les militantes se qualifient elles-mêmes, plus généralement, de militantes pour les droits des animaux, comme aux États-Unis. Paradoxalement, alors que le terme antispécisme est né au Royaume-Uni, les militants anglophones semblent moins prompts à l’utiliser aujourd’hui, y compris au Québec où 7,5 % de la population est de langue maternelle anglaise. Ainsi, en parlant de mouvement « globalisé » et « internationaliste » (p. 9, p. 153), ne risque-t-on pas de ranger sous la bannière de l’antispécisme un mouvement finalement très diversifié ? On aurait aimé également en lire davantage sur les spécificités respectives des contextes politiques français et québécois. Comment des cultures militantes différentes, forgées pour l’une dans un État-nation souverain imprégné de républicanisme, et pour l’autre dans une province francophone linguistiquement isolée au sein de la fédération canadienne, influencent-elles localement le mouvement antispéciste ?
Une autre critique a trait à l’aspect sociologique de l’ouvrage. Il n’y a en effet pas d’analyse spécifique du genre, de l’âge ou encore de la catégorie socioprofessionnelle d’appartenance des personnes rencontrées : la question reste donc entière de la nature des couches sociales mobilisées. Traïni (2011), Ingram (2013) et Carrié (2015) montrent par exemple, dans leurs sociogenèses du mouvement (portant respectivement sur la France, le Royaume-Uni, le Québec et l’Ontario), comment les contextes politiques et culturels influencent les catégories sociales qui s’engagent dans la cause animale, du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle. En Ontario par exemple, le mouvement pour les droits des animaux est porté, dans ses débuts, par des femmes et des réformistes sociaux, alors qu’au Québec, c’est plutôt la bourgeoisie anglophone qui est à l’avant-plan de la cause. Qu’en est-il aujourd’hui ? Quels sont les déterminants sociaux contemporains de cet engagement qui croît en popularité et en légitimité ? Qu’en est-il, par ailleurs, des trajectoires d’engagement ? Segal en amorce une analyse fascinante lorsqu’il évoque le passage, en Israël, de certains déçus du camp de la paix vers l’antispécisme, et l’on aurait aimé en savoir plus les parcours des autres militants cités au fil des pages. Ces quelques remarques sont plus un appel à prolonger la réflexion qu’une réelle critique de l’ouvrage, dont le propos n’est pas de dresser une sociologie détaillée du mouvement.
Pour conclure, la force d’Animal Radical tient à l’engagement de l’auteur et à sa connaissance ethnographique du mouvement. L’historien Antoine Prost rappelle que ce sont des historiens sensibles au mouvement ouvrier, dont plusieurs étaient membres du parti communiste, qui ont donné leur pleine légitimité scientifique à l’histoire ouvrière du XXe siècle. En tant que militant et historien, Jérôme Segal s’inscrit dans cette tradition d’intellectuels engagés capables de bâtir, avec rigueur et recul, le récit historique de causes caricaturées ou méconnues. Animal Radical permet ainsi d’entrer dans un mouvement dont les préoccupations nous concernent toutes et tous. Sur fond de crise écologique et sanitaire, c’est en effet une crise morale qui se profile, alors que plus de 70 milliards d’animaux sont abattus chaque année dans le monde, dans des conditions que peu de personnes cautionnent encore.
Alexia Renard, La Vie des idées, 5 octobre 2020.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte