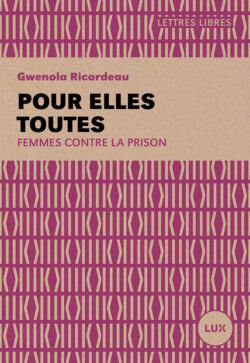Sous-total: $

Pour certaines féministes, la prison n’est pas la solution contre les agressions sexuelles
Un point de vue qui va à rebours des revendications pour l’application des lois et des sanctions envers les agresseurs.
«La prison ne nous sauvera pas du patriarcat»: c’est l’un des slogans tagués dans les rues parisiennes par le tout jeune collectif Pour un féminisme anticarcéral, le 7 mars dernier. La formule pourrait paraître surprenante, alors que nombre de féministes militent pour la pénalisation des violences sexistes et sexuelles, l’intégration du mot «féminicide» dans le Code pénal, ou encore la verbalisation du harcèlement de rue.
Issu de l’abolitionnisme pénal qui prône, entre autres, la suppression des prisons, le féminisme anticarcéral entend sortir les violences sexistes et sexuelles du système pénal. Cette question pourrait prendre de l’importance, à l’heure où les témoignages d’agressions se multiplient dans plusieurs milieux.
Un courant moins visible
Le point de vue de ces féministes éclot à peine en France, et notamment dans les mouvements radicaux et intersectionnels. Claire, enseignante et porte-parole du collectif LGBT+ Irrécupérables, se souvient d’un engouement lors du Village féministe, un événement organisé par plusieurs associations le 8 mars: «Je devais signaler à la tribune les ateliers à venir dans l’heure, et l’atelier sur le féminisme anticarcéral organisé par le collectif Mwasi était déjà complet. Il y a une vraie demande d’un féminisme et de luttes LGBT qui pensent la question d’un point de vue radical et révolutionnaire.»
L’association Genepi, qui veut sensibiliser le grand public aux problématiques carcérales, organise depuis deux ans des formations en interne et des tables rondes sur le sujet. «C’est une réaction aux demandes pour plus de pénalisation à chaque réponse aux agressions sexistes dans les discours féministes à grande échelle. Nous considérons que ce n’est pas une solution viable», déclare Ariane*, membre de l’association.
«Dès les années 1970, des liens se font entre l’abolitionnisme pénal et les mouvements féministes», décrit Gwénola Ricordeau, professeure assistante en justice criminelle à la California State University de Chico et autrice de Pour elles toutes-Femmes contre la prison. Dans le même temps, de plus en plus de revendications féministes s’appuient sur le système pénal (police, justice, prison). «Le viol conjugal existe dans la loi depuis 1992 seulement», rappelle Emmanuelle Piet, présidente du Collectif Féministe contre le viol (CFCV). Agacée, elle estime «curieux de militer à la fois contre les violences faites aux femmes et contre la prison» et que les féministes anticarcérales, en refusant l’incarcération des coupables, «minimisent les viols».
Des victimes encore peu audibles
Une femme sur cinq déclare avoir été victime d’au moins une forme de violence sexuelle, et parmi elles, une sur dix porte plainte, selon le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEFH). D’après une étude du CFCV, seuls 0,3% des agresseurs sont condamnés. Une enquête du Monde de 2017 donne à voir plusieurs cas de femmes confrontées à des procès-verbaux bâclés et à des refus.
Voire à des maltraitances: c’est le cas d’Émilie, placée en garde à vue après avoir voulu porter plainte pour agression; ou de Marie-Reine, brutalisée par des agents de police. «Lorsqu’on écoute les victimes, on assiste à un profond sentiment d’insatisfaction, décrit Gwénola Ricordeau. Mais même s’il y a le sentiment que la justice n’est pas juste, penser en dehors des institutions pénales est minoritaire.» Emmanuelle Piet est catégorique: «Dans l’État actuel, pour qu’une victime soit reconnue en tant que telle par la société, il faut passer par la justice. Le système judiciaire n’est pas adéquat car pas assez dur.»
«L’agresseur de Julia Boyer a été incarcéré, alors qu’elle avait demandé des travaux d’intérêt général.»
Au contraire, les féministes anticarcérales ne pensent pas qu’améliorer le système serait la solution: «La justice enlève la possibilité de choisir. Adèle Haenel a d’abord dit ne pas vouloir porter plainte contre Christophe Ruggia [qu’elle accuse d’attouchements sexuels alors qu’elle était mineure, ndlr], et le parquet a ouvert une instruction», rappelle Julia, membre du collectif Pour un féminisme anticarcéral et élève avocate spécialisée en droit pénal. «Elle n’a pas eu le choix et s’est constituée partie civile. Aujourd’hui, si une instruction est ouverte et que la victime se retire, l’instruction suit son cours et le procès se déroule sans elle, avec éventuellement une indemnisation financière.»
Autre exemple: celui de Julia Boyer, une femme transgenre frappée et insultée en mars 2019 place de la République à Paris, en marge d’une manifestation contre le gouvernement d’Abdelaziz Bouteflika. «L’agresseur de Julia a été incarcéré, alors qu’elle avait demandé des travaux d’intérêt général», regrette Claire du collectif Irrécupérables.
Discriminations
Les féministes anticarcérales veulent aussi dénoncer un système qu’elles jugent discriminatoire et maltraitant. La France a été condamnée le 30 janvier par la Cour européenne des droits de l’Homme pour surpopulation carcérale. Il n’existe pas de statistiques ethniques sur la population carcérale, mais selon des données de l’Observatoire international des prisons (OIP), les sans-abri et les personnes nées à l’étranger ont huit fois plus de risques d’être condamné·es à de la prison ferme et plus de la moitié des détenu·es sont sans emploi avant d’être incarcéré·es.
«On a une justice de classe! Ce n’est pas un scoop, ironise Emmanuelle Piet. Cela dit, Weinstein vient de prendre vingt-trois ans. Il y a aussi eu un premier procès contre Georges Tron, même s’il a fait appel.» Pas de quoi convaincre Julia, qui estime que Harvey Weinstein est «l’arbre qui cache la forêt».
Pour les féministes anticarcérales, les plaignantes seraient aussi discriminées selon leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou encore leur statut social et professionnel. «Il n’y a pas de statistiques sur celles qui ont du mal à porter plainte. Il me semble important de dire que c’est difficile pour tout le monde», récuse Emmanuelle Piet.
D’autres pistes
En attendant, que faire pour les victimes? Emmanuelle Piet mise sur la fin de la prescription pour les crimes sexuels et la mise en place de «vraies enquêtes» pour savoir si un violeur est récidiviste: «Quarante pourcent de nos appelantes savent que leur violeur a déjà violé quelqu’un», martèle-t-elle. En France, des mesures de justice restaurative ont aussi été prises, en complément d’une peine.
Le Genepi et les Irrécupérables n’ont pas pris position sur d’autres solutions: «C’est une réponse à construire, précise Ariane*. Comment s’organiser entre personnes concernées, mettre en place des protocoles, essayer d’écouter les besoins des personnes concernées par ces agressions.» Pour Julia, il n’y a pas encore de solution toute faite; l’heure est pour l’instant à la réflexion: «La première étape est de réfléchir au système pénal et de voir ce qu’on rejette pour ne pas le reproduire. Par exemple, dans certains groupes ces réflexions vont aboutir à des prises de position comme le refus de chercher des preuves.»
«Si la [victime] nous dit qu’elle veut rester dans le groupe sans croiser la personne qui l’a agressée, la gestion nous revient.»
Gwénola Ricordeau, elle, évoque les solutions de justice transformative, déjà appliquées par les communautés autochtones nord-américaines: «L’idée est de sortir du face-à-face victime/auteur qui met en avant la responsabilité individuelle, là où la justice transformative va parler de responsabilité collective et donc de l’engagement des pairs auprès de la victime et des auteurs.»
Il s’agit de proposer une approche centrée sur la victime et sur ses besoins: «Si la personne nous dit qu’elle veut rester dans le groupe sans croiser la personne qui l’a agressée, la gestion nous revient, décrit Julia. Il faut que ce soit fait avec la personne qui a agressé lors d’une période de discussion et de réflexion. Des solutions sont envisagées indépendamment, sans confrontation.» Des réflexions encore balbutiantes, mais qui débouchent sur un même principe: l’engagement de la société entière contre les violences sexuelles.
* Le prénom a été changé
Floréane Marinier, Slate, 8 avril 2020
Photo: ErikaWittlieb via Pixabay
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte