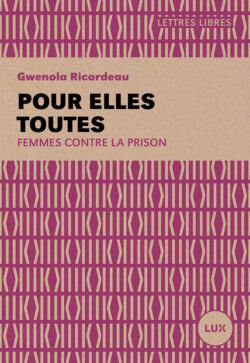Sous-total: $

Libérées de la prison
De Sylvester Stallone enfermé dans Lock Up à Elvis apprenant des accords dans Jailhouse Rock en passant par Nick Cage s’évadant dans Face Off, Hollywood a fait de la prison un décor de choix. Et le public s’est immergé dans ces fictions, imprégné des mythes présentés. Certes, Gwenola Ricordeau ne mentionne pas ces classiques du cinéma (classiques en ce qui a trait au temps, pour ce qui est de la qualité, cela se discute). Néanmoins, elle déplore les clichés véhiculés par les œuvres de ce type. Et ce sentiment de fausse familiarité qu’elles contribuent à transmettre. En résumé : « Tout le monde pense connaître la prison sans y être allé. »
Celle qui est professeure-assistante en justice criminelle à la California State University s’y est pour sa part rendue souvent. Dans le cadre professionnel, d’abord, mais également pour visiter des proches. La façon dont ces derniers ont été affectés par l’incarcération constitue du reste l’un des points de départ de son essai Pour elles toutes.
Toutefois, dans les pages de ce livre comme en entrevue, la chercheuse d’origine française n’insiste guère sur le côté individuel de son point de vue. Elle ne veut surtout pas que son propos, qu’elle a longuement fouillé, mûri, réfléchi, soit teinté de « moi, moi, moi, comment je me sens ». « Porter une parole basée sur le vécu, sur la sensibilité personnelle… Je veux me détacher de ce à quoi on est toujours ramenés. »
Pour elles toutes aussi se détache du lot, car le tout est consacré à une idée qui, l’auteure le répète elle-même, est à mille lieues de faire l’unanimité : celle de l’abolition du système pénal, de la fin de l’incarcération. « Je n’ai pas de solution, prévient-elle lorsque nous la rencontrons lors de son passage à Montréal. Je veux juste ouvrir un débat. »
Elle souhaite également rappeler qu’il ne faut surtout pas confondre cette position contre les prisons avec d’autres courants abolitionnistes. Principalement celui visant le travail du sexe. « Assez naturellement, ceux qui prônent l’abolitionnisme pénal appuient aussi la décriminalisation des rapports humains. J’ai beaucoup de sympathie et de respect pour les luttes des travailleurs et travailleuses du sexe. Ce sont des personnes extrêmement conscientes de ce que le système pénal fait aux populations les plus vulnérables. »
« Il n’existe pas une prison. Il existe des expériences de la prison. »
Gwenola Ricordeau
Une autre prise de conscience qu’elle souhaite provoquer chez le lecteur, c’est que l’enfermement n’est pas une expérience uniforme. « Il n’existe pas une prison. Il existe des expériences de la prison. » Qui varient, bien entendu, selon la durée de la peine, selon le type de délit commis, selon le type de ressources dont l’on dispose. « Ce n’est pas la même chose pour un homme issu d’un milieu favorisé qui a des ressorts divers à l’extérieur que pour un jeune en rupture sociale incarcéré pour une longue peine. »
Une peine, une tristesse qu’elle aborde également en ses pages, c’est celle causée par ce qu’elle nomme le manque de solidarité. « Il y a un certain désintérêt et même un désintérêt certain de plusieurs courants du féminisme sur la question, croit-elle. En dehors des appels à la criminalisation des auteurs de crimes ou de délits à caractère sexuel, très peu de revendications politiques portent sur les femmes incarcérées ou qui ont des proches en prison. »
Précisons, à ce sujet, que Gwenola Ricordeau préfère, et de loin, le mot « proches » à « famille ». Un long passage de son essai est du reste consacré à la raison pour laquelle ce terme la fait tiquer. « Beaucoup de personnes incarcérées vivent des ruptures familiales. Et ce, pour diverses raisons. C’est important de le prendre en considération. Les solidarités sur lesquelles elles peuvent alors compter se trouvent souvent dans l’entourage plus large. Ce sont leurs collègues de travail, leurs voisines. » Car oui, précise-t-elle, « ces proches sont le plus souvent des femmes. »
Pour elles
C’est pour toutes celles à qui on n’a jamais rendu justice, pour celles qui sont derrière les murs, pour celles qui sont aux portes des prisons que l’essayiste a écrit. S’interrogeant sur la nécessité de porter plainte, abordant la légitime défense et évoquant, notamment, la pensée du sociologue norvégien Nils Christie. Plus particulièrement son article de 1977 « Conflicts as Property » paru dans le British Journal of Criminology, dans lequel il avançait que les conflits font partie de l’expérience humaine et qu’apprendre à les gérer, à les résoudre nous-mêmes, est carrément un droit. « Une propriété, une richesse dont il faudrait éviter d’être dépossédé. »
Gwenola Ricordeau renchérit : « Plutôt que de les déléguer à une institution, qu’elle soit la police ou la justice dans son ensemble, il serait plus avantageux pour la société de prendre ces mêmes conflits comme une occasion d’apporter des changements sociaux. Je trouve ça extrêmement beau. C’est donner du pouvoir aux victimes alors que le système pénal a tendance à les rendre passives, à les mettre en attente. »
Beau, peut-être, mais réaliste ? « Bien sûr, cela peut paraître extrêmement théorique. Toutefois, lorsqu’on écoute les victimes, elles évoquent souvent de telles frustrations. De ne pas avoir pu parler au moment où elles avaient envie de parler, et de la manière dont elles voulaient le faire. De ne pas avoir pu rencontrer la personne qui leur a fait du tort au moment de leur choix, qui n’est pas nécessairement celui du procès. De ne pas avoir pu leur faire face dans un cadre autre que celui du tribunal. »
À propos de cadre, l’essayiste rappelle la pensée de Michel Foucault : « La réforme de la prison est à peu près contemporaine de la prison elle-même. Elle en est comme le programme. »
Le programme de Gwenola Ricordeau, lui, appelle à l’inventivité, à une transformation du système, mais surtout à une réflexion profonde. « La prison est quelque chose d’extrêmement récent qui a été imposé à nombre de cultures par la colonisation. Aujourd’hui, on a tendance à penser que c’est presque naturel d’enfermer les gens. Mais c’est loin de l’être, naturel. »
Natalia Wysocka, Le Devoir, 30 novembre 2019
Photo: Marie-France Coallier / Le Devoir
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte