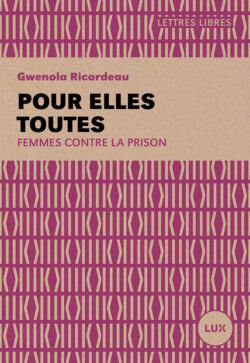Sous-total: $

Gwenola Ricordeau: «La punition de certains auteurs de féminicides n’a pas fait baisser leur nombre»
Avec « Pour elles toutes – Femmes contre la prison » (Lux Éditeur, 2019), Gwenola Ricordeau, professeure assistante en justice criminelle à la California State University, réalise un petit miracle, celui de faire converger luttes féministes et luttes pour l’abolition du système pénal et de la prison, deux mouvements souvent présentés comme antagonistes. Son dernier essai explore les formes de protection que les femmes peuvent attendre ou pas du système pénal, en mettant en lumière les manières dont celui-ci affecte leur existence, qu’elles soient incarcérées ou qu’elles aient des proches en prison.
Alter Échos : « Le jour où la prison a cessé d’être une abstraction pour moi, j’ai été convaincue qu’il fallait l’abolir. » Vous évoquez en préambule de votre essai le parcours qui a été le vôtre par rapport à la prison. Un parcours qui vous a pris aux tripes…
Gwenola Ricordeau : J’ai été saisie par le scandale qu’est la prison, de ce que les personnes y subissent, qu’elles soient derrière les barreaux ou proches de détenus. Ce sentiment d’injustice peut être un sentiment assez partagé, même quand on n’est pas abolitionniste comme je le suis. Beaucoup de personnes estiment que la prison ne fonctionne pas. C’est aussi par la question des victimes que je suis devenue abolitionniste, en constatant que la punition d’un auteur ne répond pas à toutes les problématiques des victimes. À cela se sont mêlées la recherche d’écrits, la rencontre de personnes qui avaient pensé la sortie de la matrice pénale. La découverte de l’abolitionnisme, démarrant dans les années 70, a été vraiment riche pour moi, d’autant que ce courant reste mal connu et souvent caricaturé. Il s’agit pourtant d’une pensée complexe et émancipatrice qui ne se résout pas seulement à la fermeture des prisons.
AÉ : À vos yeux, la conclusion est sans appel : les femmes sont mal protégées. Surtout, dites-vous, elles servent de plus en plus de prétexte pour justifier le durcissement pénal.
Gwenola Ricordeau : Il existe toute une population (les femmes, les minorités raciales, les personnes LGBT, etc.) dont les luttes d’émancipation, que ce soit autour de la question des violences sexuelles ou des discriminations, sont instrumentalisées par le populisme pénal pour étendre le filet punitif. Sous des airs progressistes, l’idée sous-jacente est celle d’un filet pénal qui protégerait toutes les populations. Or il n’est pas sûr qu’à moyen terme, toutes ces populations y gagnent. Lorsqu’on examine la question spécifique des violences faites aux femmes – ces violences n’étant pas le seul tort fait à celles-ci dans un système patriarcal –, on est obligé de reconnaître que le système pénal ne fonctionne pas : malgré une pénalisation accrue de ces violences depuis les années 1970, des peines de plus en plus lourdes prononcées, le niveau des violences n’a pas changé… Partant de ce constat-là, cela amène à interroger radicalement les revendications qui se placent sur le champ pénal, d’autant plus que toutes les femmes n’ont pas accès aux réponses pénales. Y recourir est compliqué pour les femmes sans papiers, pour celles qui ont peu de ressources financières… Puis, quand on observe qui est criminalisé pour ce type de violences, on voit assez nettement qu’il y a des catégories surreprésentées. Comme pour d’autres types de faits, les personnes racisées et celles issues des milieux populaires sont majoritaires parmi les personnes condamnées. De la sorte, le système pénal actuel reproduit les inégalités sociales ou raciales.
L’abolitionnisme est un courant mal connu et souvent caricaturé. Il s’agit pourtant d’une pensée complexe et émancipatrice qui ne se résout pas seulement à la fermeture des prisons.
AÉ : L’exemple états-unien est extrêmement parlant, où il y a eu un durcissement majeur sur la question des violences domestiques…
Gwenola Ricordeau : Ce durcissement s’est traduit par une criminalisation beaucoup plus importante des hommes racisés, sans papiers, mais, surtout, on a aussi constaté une criminalisation plus grande des femmes et des personnes LGBT puisque la police intervenant dans des domiciles, dans un contexte de violences, arrête aussi indistinctement des victimes, et beaucoup de personnes se retrouvent aujourd’hui criminalisées du simple fait du plus grand interventionnisme policier.
AÉ : Il y a en France comme en Belgique un débat autour des féminicides (meurtre d’une ou de plusieurs femmes en raison de leur genre) et de leur inscription au Code pénal. Qu’en pensez-vous ?
Gwenola Ricordeau : En tant qu’abolitionniste, je ne soutiens pas ce genre de revendication, d’autant que le droit actuel permet déjà de poursuivre les auteurs. La punition de certains auteurs de féminicides n’a pas fait baisser leur nombre comme je l’ai déjà dit. Ajouter des spécificités dans les poursuites pénales ne me semble pas pertinent. À mes yeux, la meilleure façon de combattre les féminicides est de se situer sur un autre terrain que le pénal, un terrain qui est celui de la lutte contre le patriarcat. Par exemple, la question de l’autonomie financière des femmes me semble beaucoup plus importante, à l’instar de l’égalité salariale qui n’est appliquée nulle part. C’est plus important, selon moi, de permettre l’autonomie, notamment économique, des femmes de sorte qu’elles aient la possibilité de faire des choix, en ayant par exemple la possibilité de quitter un foyer familial et conjugal problématique.
AÉ : Maintenir la femme dans son statut de victime, c’est aussi la maintenir dans une forme de patriarcat, soulignez-vous. Un des aspects de votre réflexion est de dépasser ce statut de victime…
Gwenola Ricordeau : En effet. Il y a l’idée que pour guérir, surmonter le tort qui a été fait, il faut avoir été reconnu comme victime par le système pénal. Une situation dommageable pour les personnes qui ont été victimisées puisque, dans de nombreuses circonstances, il n’y a souvent jamais de procès. Il est dès lors important que les personnes victimisées puissent trouver leur propre cheminement. Au-delà de ce statut de victime, il est essentiel que la communauté, les proches puissent être convoqués et participent de ce cheminement. Or, ils sont en grande partie déresponsabilisés par le système pénal. Je suis donc en faveur de la « justice transformative », approche qui mobilise toute une communauté, où chacun a un rôle à jouer. Elle part du constat que les victimes survivent, qu’il y a une expérience énorme en marge du système pénal. C’est aussi pour cela que cette conception a ses origines dans des communautés qui ont été la cible des politiques répressives et qui peuvent difficilement attendre une forme de protection du système pénal, comme les populations africaines-américaines aux États-Unis ou LGBT. Celles-ci ont dû prendre en charge elles-mêmes leur victimation, sans pouvoir attendre d’être reconnues comme victimes ou une forme de réparation du système pénal. Une telle démarche d’appropriation de sa propre expérience me semble plus intéressante pour les victimes que tout ce que peut promettre le système pénal.
AÉ : À propos des femmes en prison, vous rappelez que les conséquences sociales sont souvent plus importantes pour elles que pour les hommes…
Gwenola Ricordeau : Lorsque les femmes purgent une peine, à longueur de peine et conditions de détention égales aux hommes, leur bien-être, leur état de santé sont bien plus affectés que ceux des hommes. C’est lié au fait que les liens sociaux des femmes se détériorent beaucoup plus que ceux des hommes et qu’elles bénéficient de moins de soutien social. Au niveau des enfants, il y a une grande différence avec les hommes : les pères incarcérés peuvent souvent garder un lien avec leurs enfants parce qu’ils sont gardés par leur mère ou par une femme de la famille (une sœur, une grand-mère, etc.), là où les femmes détenues peuvent beaucoup moins compter sur le père de leurs enfants. Les enfants dont les mères sont incarcérées sont beaucoup plus à risque d’être placés en famille d’accueil ou en foyer que ceux dont les pères sont en prison. Les femmes incarcérées perdent davantage que les hommes incarcérés l’autorité parentale sur leurs enfants, voire tout contact avec leurs enfants. À la sortie, même chose. Elles peuvent moins compter sur les solidarités familiales : le fait d’être passé par la prison est davantage stigmatisant pour une femme que pour un homme. Même si les caractéristiques sociales des femmes en prison sont assez proches de celles des hommes incarcérés (niveau d’éducation, milieu social…), il y a néanmoins une spécificité à leur sujet : la surreprésentation parmi elles des victimes de violences à caractère sexuel ou de violences conjugales. Ces violences-là ont souvent un impact dans le parcours de criminalisation : elles ne sont pas forcément criminalisées parce qu’elles en ont été victimes, mais, par contre, cela peut s’inscrire dans un parcours d’usage de produits stupéfiants, d’itinérance, d’absence de domicile…
Lorsque les femmes purgent une peine, à longueur de peine et conditions de détention égales aux hommes, leur bien-être, leur état de santé sont bien plus affectés que ceux des hommes.
AÉ : Il y a aussi un désintérêt des femmes confrontées à la prison. Ce sont, dites-vous, des grandes oubliées…
Gwenola Ricordeau : Lorsqu’un homme est incarcéré, il y a souvent à l’extérieur des femmes qui réalisent un important travail de solidarité : soutien matériel, financier et psychologique, démarches administratives, etc. Ce travail de solidarité est d’ailleurs souvent attendu d’elles par les proches et la société. Celui-ci a un impact extrêmement important sur ces femmes issues majoritairement des milieux populaires, de l’immigration et de l’histoire coloniale. On commence à voir des travaux scientifiques sur cette question, notamment en Amérique du Nord. Ce qui me semble intéressant, c’est que c’est très rarement pensé comme une question féministe alors qu’il y a là un véritable travail domestique, même s’il se fait à distance. Une des raisons de cette invisibilité des femmes impactées par l’existence de la prison est que ces femmes sont en grande partie invisibles politiquement.
Propos recueillis par Pierre Jassogne, Alter Échos, no 478, 25 novembre 2019
Photo: © Denis Oliveira Unsplash
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte