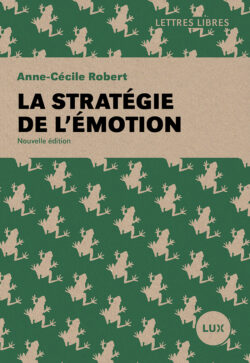Sous-total: $

«La société doit offrir d’autres perspectives que celle de pleurer ensemble»
Dans son dernier essai, « La stratégie de l’émotion » (Lux), la journaliste Anne-Cécile Robert dénonce l’invasion de l’espace public par l’émotion dans tous les aspects de notre société. Ce phénomène, dont nous avons trop peu conscience, nous garde tous, acteurs et spectateurs, dans une passivité coupable. Entretien avec l’auteur.
Quels sont les acteurs, nombreux, de cette invasion de l’espace social par l’émotion, que vous décrivez comme un danger pour la démocratie ?
Effectivement, c’est l’invasion de l’espace public par l’émotion, et non l’émotion en soi, qui est dénoncée dans le livre. Tous les secteurs de la société sont concernés : les médias, la justice, le monde politique, certains aspects de la recherche, les maisons d’édition, l’université… La société semble embarquée dans un mouvement général. L’objet du livre est alors d’alerter, de faire prendre conscience du phénomène. Les journalistes eux-mêmes ne se rendent pas forcément compte qu’ils sont partie prenante de ce mouvement. Le livre parle aussi des marches blanches : ces rassemblements de foule, qui renvoient à la non-violence et à l’idéal de paix, ont lieu quasiment tous les jours. Il faut s’interroger sur la signification de ce phénomène, car ces manifestations sont vraiment assumées comme un phénomène sensible. Il n’y a aucune banderole avec des revendications, on ne demande pas plus de moyens pour la police, la justice… On est vraiment dans le lacrymal, et cela illustre une tendance générale de la société.
Le côté cathartique de l’émotion n’est pas forcément néfaste en lui-même. Vous semblez dénoncer une manipulation finalement très rationnelle de l’émotion, plus que l’émotion en tant que telle.
Il y a deux extériorisations distinctes de l’émotion dont je parle : d’abord, celle qui fait l’objet d’une manipulation, quand les hommes et femmes politiques se mettent en scène et substituent des prêches à un discours rationnel. Il faut dénoncer ces manipulations pour retrouver une vie politique intéressante. L’hommage qui a eu lieu aux Invalides pour le décès de Charles Aznavour est un bon exemple : on est entièrement dans le « cirque » émotionnel. Par ailleurs, au regard de l’œuvre de Charles Aznavour, une œuvre assez sociale, politique – il a notamment défendu les homosexuels – il y aurait plein d’autres choses à dire, plutôt que de pleurer aux Invalides. Cette manipulation de l’émotion doit donc être dénoncée, pour retrouver une vie civique, politique, collective.
Ensuite, il y a effectivement quelque chose de plus subtil, de plus pervers, qui est la dimension cathartique de l’émotion. Certains pans de la société souffrent tellement que le registre de l’émotion les soulage : cela permet de lâcher prise, de se retrouver avec d’autres gens. Ce n’est pas vraiment de la manipulation, ou alors de l’auto-manipulation. Le citoyen s’offre une sorte de compensation, parce qu’il est maltraité dans son travail par exemple, qu’il n’a pas de perspective… C’est une manière de retrouver du lien social. Le problème est qu’il faut ensuite aller au-delà. Il faut y ajouter la citoyenneté digne de ce nom, pour que la société offre à nouveau à ses membres d’autres perspectives que celle de pleurer ensemble, ce qui finalement n’apporte pas grand-chose. On se fait du bien sur le moment, mais après on rentre chez soi, il y a toujours le chômage, etc. Je pourrais donner ici l’exemple du film de Pierre Schoeller, « Un peuple et son roi ». C’est un film sur la Révolution française, très bien joué, avec des acteurs remarquables, et qui appelle complètement à l’émotion : on y observe le peuple magnifié, qui prend la Bastille, avec des soleils couchants… C’est un appel à la Révolution, un appel révolutionnaire à l’émotion. Ce que je dénonce au contraire dans mon livre, c’est le recours fataliste à l’émotion – un recours qui va maintenir les citoyens dans une passivité – et donc par extension, le côté conservateur de cet appel.
Vous parlez d’une dérive symptomatique de notre époque, mais est-ce que l’émotion n’a pas toujours donné lieu à des instrumentalisations de la part du politique ?
Il y a toujours eu une manipulation de l’émotion, bien sûr. Les meetings nazis sont un exemple emblématique : l’émotion y était manipulée de manière collective, avec des mises en scène, de la musique… pour que les gens ne réfléchissent et n’agissent pas. La manipulation de l’émotion nous ramène ici aux années 1930, et à l’histoire de l’extrême droite. Néanmoins, que des secteurs de la société qui font normalement appel aux discours rationnels, aux débats raisonnés, puisent dans ce registre de « prise en otage » émotionnelle, c’est nouveau. Des hommes politiques tels qu’Emmanuel Macron, Tony Blair ou Barack Obama y ont recours. L’exemple type est le traitement des questions migratoires : les responsables politiques vont vous expliquer que tout ce que vivent ces gens est affreux, et dans le même temps, ils justifient leur impuissance. C’est ce tournant qui est préoccupant.
En outre, probablement depuis la chute du mur de Berlin et la fin des grands affrontements politiques, on assiste à une transformation politique. Les grands débats philosophiques s’essoufflent : auparavant il existait, indépendamment du clivage droite/gauche, des débats entre ceux qui étaient pour les Lumières, ceux qui étaient contre, ceux qui défendaient des grands philosophes, ceux qui étaient contre… Ces grands débats et affrontements qui structuraient la vie politique ont disparu. Or, cela s’est passé de manière douce, sans rupture brutale. Les débats politiques n’ont pas disparu, mais les termes qui les composaient des années 1950, 60 jusqu’aux années 80, ont été remplacés par des substituts. Or, ces substituts sont manichéens. Il faut être pour les gentils, contre les méchants : on nous demande d’être avec Emmanuel Macron, contre les méchants Viktor Orban, Vladimir Poutine et Donald Trump.
Contre cette dérive émotionnelle, vous appelez à renouer avec des philosophies rationalistes, notamment celles des Lumières, qu’on accuse parfois aujourd’hui d’un excès de raison. Pouvez-vous préciser leur manière de traiter l’émotion ?
Un faux procès limite les Lumières à un hyper rationalisme froid. En fait, les philosophes rationalistes – même avant les Lumières, si on pense à Descartes – n’ont jamais exclu les passions. Descartes, d’abord, était croyant, et a écrit un traité des passions. Les philosophes rationalistes puis ceux des Lumières disent que l’être humain a plusieurs moyens de communiquer avec les autres qui l’entourent : les sentiments, la passion, et la raison. Ces trois modes sont tout à fait légitimes et normaux. Dans la société politique, il faut toutefois donner une priorité à la raison, car c’est la seule que nous ayons tous en commun. Les passions sont par définition inégalitaires : tout le monde n’aime pas les mêmes personnes ni les mêmes choses. On est donc dans le terrain de la subjectivité. Si on en reste au terrain des passions, on va donc s’affronter immanquablement, parce que l’on ne pourra jamais s’accorder. Idem pour la foi : c’est quelque chose de très privé, qui ne se démontre pas. La raison est le seul mode d’appréhension de l’espace public qu’on a tous en commun et qui nous permet de communiquer. Parce qu’on a tous un cerveau, on peut construire avec la raison un espace public qui nous permet de discuter.
C’est cela qui est contesté aujourd’hui : les attaques contre les Lumières correspondent à des attaques contre l’universalisme, car il y a une domination – qui vient en grande partie des États-Unis – des pensées relativistes, communautaristes, qui veulent nous renvoyer à des identités que l’on n’a pas choisies par ailleurs. Vous êtes une femme, donc vous devez penser comme une femme, historiquement dominée, y ajouter éventuellement des caractères de douceur, etc. Si vous êtes un homme blanc, vous portez en vous toute l’histoire de la domination masculine blanche sur les femmes, sur le tiers-monde, etc. Il y a donc un côté ultra déterministe, séparatiste, clivant ; les gens sont assignés à des identités qu’ils n’ont pas choisies. Cela crée des communautés fermées, et au bout du compte, des espèces d’affrontements.
Toutes ces dérives sont-elles intentionnelles, selon vous ? En a-ton conscience ?
Je pense qu’elles sont portées par une forme de paresse, de laisser-aller. Mon livre, en amenant jusqu’au bout de l’interprétation ces constats parfois déjà opérés, s’y oppose de manière radicale par un effet « choc ». Par exemple, il existe depuis longtemps des philosophes qui ont travaillé sur le traitement des faits divers par les journalistes : Roland Barthes, Pierre Bourdieu… Cependant, j’illustre cela de manière inédite par le registre émotionnel. La dérive globale de la profession journalistique, accélérée par la paupérisation du métier, par des logiques ultra-concurrentielles, par la sous-formation des journalistes qui ne savent plus faire d’enquête, d’analyse… aboutit à une simplification du traitement de l’information. Il est plus facile d’aller pleurer dix minutes avec la famille de la victime, que d’effectuer une analyse sur la raison pour laquelle la police n’a pas pu trouver le coupable… C’est beaucoup plus simple de tendre son micro à la victime sur le terrain, de remplacer le raisonnement par l’émotion. Il y a donc une dérive pas forcément consciente mais portée par une paresse, par un laisser-aller général de la société. Nos sociétés sont de moins en moins exigeantes sur tout. Cela devient problématique quand ce manque d’exigence atteint les cadres sociaux, les leaders d’opinion, les universitaires, les hommes politiques, les médias, qui sont pourtant supposés tirer la société vers le haut. Là, ils contribuent à tirer la société vers le bas, et nous incitent à nous maintenir dans cette médiocrité, ce refus de pensée.
Comment peut-on se prémunir contre cela ?
D’abord, on a tous inconsciemment intégré cette injonction à l’émotivité qu’on voit très bien dans les marches blanches. Le premier acte, qui est l’objectif recherché par La stratégie de l’émotion, c’est de contribuer à une prise de conscience. Tout le système social est attaqué, et il me semble qu’on est arrivé à un point où chacun souffre inconsciemment de ce système.
Ensuite, il y a toute une reconstruction sociale à faire : les journalistes dans leur rédaction, les citoyens dans les associations, les militants dans les partis politiques. À partir du moment où on aura effectué cette prise de conscience, on pourra commencer à sortir de cela en recréant des liens. On est tous atomisés. L’une des solutions, c’est de retrouver des lieux et des liens pour reconstruire un espace public par l’échange d’idées, pas forcément par l’échange d’émotions. Les idées existent un peu partout, mais tout est éclaté, et chacun a le sentiment qu’il est isolé, le système l’incite à cultiver cet isolement. Pour retrouver des liens, il faut retrouver des lieux, dans les associations, les universités, dans la lecture, dans le fait de renouer avec l’histoire. L’histoire est une source d’inspiration. Abandonner le devoir de mémoire pour faire un devoir d’histoire, quitter l’appréhension émotionnelle des évènements qui ne nous permet pas de comprendre. L’épisode de la guerre de 14 est un exemple : on peut pleurer sur la situation des soldats dans les tranchées, mais cela ne nous permet pas de comprendre pourquoi a eu lieu cette guerre, qui était voulue par les puissances impérialistes, la France et l’Allemagne de l’époque. C’est l’une des raisons pour lesquelles aujourd’hui les gens se prennent encore à croire le discours démagogique de l’extrême droite. Sur la guerre 39-45, on est depuis 70 ans dans le devoir de mémoire, qui est extrêmement important par rapport à ce qu’il s’est passé. Mais si on en reste là, on n’arrive pas à conceptualiser et donc à éviter que cela ne se reproduise dans d’autres contextes.
Il me semble important pourtant d’avoir une note optimiste. J’ai été très frappée de la manifestation du 11 janvier 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo. Quatre millions de personnes au bas mot. Et au début, j’ai d’abord cru à une énième marche blanche. Mais je pense qu’il y avait plus que cela, la recherche quelque part de retrouver un lien, de refaire société. Cette manifestation, contrairement aux marches blanches que l’on a en ce moment, avait un soubassement politique, parce qu’une liberté fondamentale, la liberté de la presse, avait été attaquée. Il y a eu une volonté de la société, peut être inconsciente, de faire société et il me semble que la société française est très animée par une recherche de lien. Notre rôle, à nous journalistes, est de diffuser des idées qui peuvent contribuer à recréer ce lien.
Propos recueillis par Eugénie Bourlet.
Le Nouveau Magazine littéraire, 22 octobre 2018
Photo:
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte