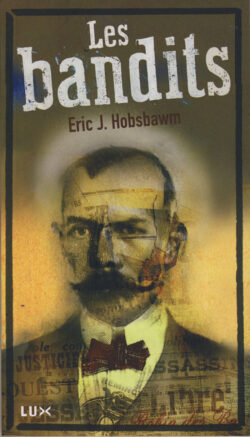Sous-total: $
Les Bandits contre l’État
Depuis la publication de son magistral Âge des extrêmes. Le Court Vingtième Siècle, l’historien Eric Hobsbawm n’a probablement plus besoin de présentation. Praticien soucieux de son art et chercheur engagé envers une idée forte de justice sociale, il s’est notamment intéressé à l’histoire de l’impérialisme du capitalisme, aux luttes politiques associées au mouvement ouvrier, et à l’histoire des révolutions européennes. Il s’est également penché, cherchant les faits sociaux et politiques derrière les chansons et légendes, sur l’histoire du banditisme. Lux offre une nouvelle édition révisée par l’auteur de ce texte désormais classique publié originellement en 1969.
Les bandits, tel que le rappelle d’emblée l’historien qui a été intrigué par ce fait, figurent en bonne place parmi les personnages mythiques qui peuplent l’imaginaire collectif. Ils sont corsaires et pirates, voleurs de grands chemins, criminels notoires, rebelles de tout acabit. Le grand criminel, parce qu’il défie l’État et sa loi, parce qu’il échappe à la violence destinale qui est le lot du sujet ordinaire, toujours fascine le peuple. C’est bien ce que rappelait Walter Benjamin dans sa Critique de la violence, réflexion sur l’arbitraire du droit qui trouve une sorte d’écho distante dans l’histoire comparée du banditisme proposée par Hobsbawm.
Les bandits, depuis longtemps rêvés, chantés et racontés par de nombreux peuples, sont souvent dépeints comme des bandits au grand coeur, volant aux riches pour donner aux pauvres, défendant la société traditionnelle contre l’État, et fidèles, tant par leur sollicitude que leur prodigalité, à la paysannerie qui les a vus naître. Ils sont alors des bandits sociaux, c’est-à-dire des bandits dont l’action comporte non seulement une dimension privée d’accumulation de richesse et de pouvoir, mais également une dimension politique. Ainsi de Robin des bois, de Billy the Kid ou de Pancho Villa—panthéon illustre auquel Hobsbawm ajoute au fil de son récit plusieurs noms.
L’historien propose un livre qui demeure avant tout une contribution scientifique à l’histoire des formes des révoltes sociales pré-capitalistes, dans lequel il procède essentiellement à la construction de cette catégorie du banditisme social. Le Bandito, telle que l’indique la signification de ce mot italien, «désigne un homme qui se trouve placé en dehors de la loi». C’est-à-dire qu’il s’agit d’une catégorie qui se comprend essentiellement en relation avec le pouvoir, dans un rapport d’extériorité par rapport à un certain ordre. Dans le cas du banditisme social, les groupes d’hommes libres que l’on nommait bandits ont essentiellement proliféré dans les campagnes, aux marges d’États naissants auxquels ils résistaient, protégeant un certain mode de vie et un certain usage, une certaine forme de propriété de la terre.
C’est ainsi, dans une dialectique territoriale avec les États en formation, que s’expliquerait selon Hobsbawm le phénomène du banditisme social : «Aucun État ne pouvait prétendre contrôler ses frontières avant le XIXe siècle, et aucun ne s’y essayait, à supposer que le tracé de ses frontières ait été clairement établi. Aucun État d’avant le XIXe siècle n’avait les moyens de maintenir une force de police rurale efficace, susceptible d’agir comme l’agent direct du gouvernement central, et couvrant l’intégralité du territoire».
À mesure que le pouvoir de l’État est consolidé sur un territoire donné, le banditisme social ou rural, cette forme de révolte sans projet de transformation de la société, tend historiquement à disparaître, bien que, invoquons Edouard Mallarmé, le squatter qui a pris sur lui la rage des expropriés de Mirabel dans un beau roman de Louis Hamelin, le bandit social persiste à exister dans l’imaginaire.
Dalie Giroux, Le Devoir, 22 novembre 2008
Voir l’original ici.
 Mon compte
Mon compte