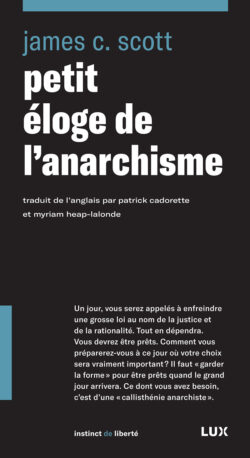Sous-total: $
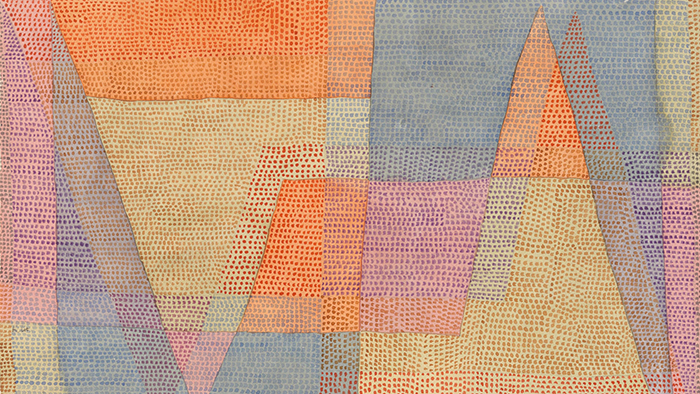
L’abécédaire de James C. Scott
Il y a un peu plus d’un an, on apprenait la mort de l’anthropologue James C. Scott. Cela faisait une quinzaine d’années que le public français avait découvert son œuvre, entamée pourtant dès les années 1980 en langue anglaise. Tenant, à l’instar de Pierre Clastres, Marshall Sahlins ou David Graeber, d’une anthropologie parfois qualifiée d’« anarchiste », Scott n’a cessé de remettre en cause les grands récits évolutionnistes, l’évidence et la désirabilité de l’État, tout en décryptant ses logiques et ses effets sur la structure des sociétés humaines, du néolithique à nos jours. Aux mécanismes de la domination, qui n’est jamais aussi féroce que centralisée et bureaucratique, il oppose ainsi les visages multiples de la résistance, ses formes souterraines comme les plus éruptives. Si sa pensée aura été constante et limpide, sa trajectoire n’est pas sans ambiguïté — en témoigne une collaboration avec la CIA en Birmanie durant ses années étudiantes1. D’« avant-garde » à « Zomia », 26 entrées pour découvrir un pilier des études subalternes.
Avant-garde : « Aucune expression ne renvoie mieux à l’image de quantité et de nombre sans ordre que le mot de masses
. Une fois que la base est décrite de la sorte, il est clair que sa contribution au processus révolutionnaire sera limitée à son poids numérique et à la force brute qu’elle pourra déployer si elle est dirigée avec fermeté. […] Lénine savait bien sûr parfaitement que la classe ouvrière avait bien une histoire et des valeurs, mais cette histoire et ces valeurs risquaient de la conduire dans la mauvaise direction si elles n’étaient pas remplacées par l’analyse historique et la théorie révolutionnaire avancée du socialisme scientifique. Dès lors, non seulement le parti d’avant-garde était essentiel afin d’assurer la cohésion tactique des masses, mais il devait aussi littéralement penser à leur place. » (L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 2021 [1998])
Bolcheviks : « Le fait le plus discordant à propos de la révolution russe est que celle-ci ne fut pas initiée de manière significative par le parti d’avant-garde, les bolcheviks. La plus grande réussite de Lénine fut de s’emparer de la révolution une fois celle-ci accomplie. […] Ce qui suivit dans les années précédant 1921 peut être au mieux décrit comme la reconquête de la Russie par l’État bolchevik naissant. Cette reconquête ne fut pas seulement une guerre civile contre les Blancs
, il s’agissait aussi d’une guerre contre les forces autonomes qui s’étaient emparées de pouvoirs locaux lors de la révolution. Elle fut avant tout un long combat voué à détruire le pouvoir indépendant des soviets et à imposer aux travailleurs le travail à la pièce, le contrôle du travail et l’abrogation du droit de grève. » (L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 2021 [1998])
Coulisse : « En coulisse, là où les dominés peuvent se réunir à l’abri du regard inquisiteur du pouvoir, une culture politique tout à fait dissonante peut émerger. » (La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Éditions Amsterdam, 2019 [1992])
Dignité : « Je privilégie les questions de dignité et d’autonomie, généralement considérées comme secondaires par rapport à l’exploitation matérielle. L’esclavage, la féodalité, les systèmes de castes, le colonialisme et le racisme engendrent toujours des pratiques et des rituels de dénigrement, des insultes et des atteintes au corps. […] De telles formes d’oppression privent les dominés du luxe ordinaire de la réciprocité négative qui vaudrait l’échange d’une gifle pour une gifle, d’une insulte pour une insulte. Même les membres de la classe ouvrière contemporaine semblent accorder une place au moins aussi importante dans leur expérience de la domination aux brimades faites à leur dignité et à la surveillance étroite et au contrôle dont ils font l’objet sur leur lieu de travail qu’à des préoccupations plus directement liées au travail en soi ou au salaire. » (La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Éditions Amsterdam, 2019 [1992])
État : « Comment l’État en est-il peu à peu venu à mieux connaître ses sujets et leur environnement ? Soudain, des processus aussi disparates que la création de patronymes permanents, la standardisation des unités de poids et de mesure, l’établissement de cadastres et de registres de population, l’invention de la propriété libre et perpétuelle, la standardisation de la langue et du discours juridique, l’aménagement des villes et l’organisation des réseaux de transports me sont apparus comme autant de tentatives d’accroître la lisibilité et la simplification. Dans chacun de ces cas, des agents de l’État se sont attaqués à des pratiques sociales locales d’une extrême complexité, quasiment illisibles, comme les coutumes d’occupation foncière ou d’attribution de noms propres, et ils ont créé des grilles de lecture standardisées à partir desquelles les pratiques pouvaient être consignées et contrôlées centralement. » (L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 2021 [1998])
Futur : « N’importe quelle idéologie prêchant ainsi sur l’autel du progrès privilégiera certes pareillement le futur, mais le haut-modernisme porte cette tendance à son paroxysme. Le passé est une entrave, une histoire ancienne dont la seule vocation est d’être transcendée. Le présent est la rampe de lancement de projets porteurs d’un meilleur futur. […] Ce choix stratégique de privilégier le futur est lourd de conséquences. Plus le futur est susceptible d’être connu et réalisé, comme la foi dans le progrès encourage à le croire, moins ses avantages à venir sont pensés en intégrant une part d’incertitude. En conséquence, la plupart des haut-modernistes sont convaincus que la certitude d’un meilleur futur justifie les nombreux sacrifices à court terme qui se révéleront nécessaires pour y arriver. » (L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 2021 [1998])
Guerre : « Le lien étroit entre appropriation et domination fait qu’il est impossible de séparer les idées et le symbolisme de la subordination du processus d’exploitation matérielle. De la même manière, il est impossible de séparer la résistance symbolique voilée à la domination des luttes matérielles visant à soulager ou interrompre l’exploitation. Tout comme la domination, la résistance mène ainsi une guerre sur deux fronts. » (La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Éditions Amsterdam, 2019 [1992])
Haut-modernisme : « Qu’est-ce que le haut-modernisme ? […] En son cœur se trouve une confiance absolue en la possibilité de faire advenir un progrès linéaire et continu, le développement des savoirs scientifiques et techniques, la croissance économique, la planification rationnelle de l’ordre social, la satisfaction croissante des besoins humains et, surtout, un contrôle de plus en plus accru sur la nature (y compris la nature humaine) à mesure qu’augmenterait la compréhension scientifique des lois naturelles. Le haut-modernisme incarne ainsi une vision notoirement exubérante de la manière dont les bénéfices des progrès scientifiques et techniques peuvent être investis – en général par le biais de l’État — dans tous les champs de l’activité humaine. » (L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 2021 [1998])
Infrapolitique : « Il existe tout un domaine que je nomme infrapolitique
parce qu’il se situe hors de l’éventail visible de ce que l’on considère habituellement comme de l’activité politique. L’État a de tout temps contrecarré l’organisation des classes subordonnées, sans parler des épisodes de contestation publique. Pour les groupes subalternes, ce type d’activité politique est dangereux. Ceux-ci ont en grande partie compris, comme les guérillas, que la divisibilité, les petits nombres et la dispersion les aident à échapper aux représailles. Par infrapolitique, j’entends les actes tels que le ralentissement délibéré, le braconnage, le chapardage, la dissimulation, le sabotage, la désertion, l’absentéisme, l’occupation illégale et la fuite. […] [L]a somme de milliers, et même de millions, de petits actes peut entraîner des effets majeurs sur la guerre, le droit à la terre, les impôts et les rapports de propriété. » (Petit éloge de l’anarchisme, Lux, 2013 [2012])
Jumelle : « Chaque domaine de résistance publique à la domination est suivi de près par l’ombre d’une sœur jumelle infrapolitique qui s’efforce d’atteindre les mêmes objectifs stratégiques, mais dont la discrétion est mieux adaptée pour résister à un adversaire qui remporterait probablement toute confrontation ouverte. » (La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Éditions Amsterdam, 2019 [1992])
Kolkhoze : « Si le kolkhoze a certes lourdement échoué à générer d’immenses surplus de denrées alimentaires, il a relativement bien servi à l’État à déterminer des modes de cultures, fixer les salaires réels dans les campagnes, s’approprier une large portion de la quantité de céréales effectivement produites et réduire politiquement les campagnes au silence. La grande réussite, si l’on peut employer ce terme, de l’État soviétique dans le secteur agricole fut de s’emparer d’un terrain social et économique singulièrement défavorable à l’appropriation et au contrôle et de mettre en place des formes institutionnelles et des pratiques de production mieux adaptées à la surveillance, à la gestion, à l’appropriation et au contrôle par en haut. » (L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 2021 [1998])
Luxemburg : « À l’encontre de la préférence de Lénine pour l’ordre et le contrôle, [Rosa] Luxemburg juxtaposait le tableau inévitablement désordonné, tumultueux et vivant de l’action sociale à grande échelle. […] Lénine procédait comme si le chemin vers le socialisme avait déjà été balisé en détail et comme si la tâche du parti consistait à employer une discipline de fer afin que le mouvement révolutionnaire maintienne son cap. Au contraire, Luxemburg croyait que le futur du socialisme restait à découvrir et à inventer par le biais d’une réelle collaboration entre les ouvriers et l’État révolutionnaire. » (L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 2021 [1998])
Masque : « Plus la disparité est grande entre le pouvoir du dominant et celui du subordonné et plus ce pouvoir est exercé de manière arbitraire, plus le texte public joué par le subordonné aura un caractère stéréotypé et ritualisé. En d’autres termes, plus le pouvoir est menaçant, plus le masque se fait épais. » (La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Éditions Amsterdam, 2019 [1992])
Nomadisme : « Loin d’être la matière première originale qui aurait servi à construire les États et les civilisations
, les sociétés des hautes terres sont pour l’essentiel un produit dérivé du processus de formation de l’État, conçu pour offrir aussi peu de prise que possible aux logiques d’appropriation. On considère désormais que le nomadisme pastoral représente un processus d’adaptation secondaire de la part de populations qui souhaitaient abandonner l’État agraire tout en tirant avantage des opportunités commerciales et des possibilités de pillage. Il en va de même pour la culture sur brûlis : comme le pastoralisme, elle contribue à disperser les populations et elle est dépourvue de tout centre névralgique
— place que pourrait occuper un État. La nature furtive
de ses productions agricoles déjoue les tentatives d’appropriation. » (Zomia ou l’art de ne pas être gouverné. Une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est, Seuil, 2013 [2009])
Ordre : « Les relations de domination sont aussi des relations de résistance. Une fois établie, la domination ne se maintient pas par sa seule force intrinsèque. Dans la mesure où elle implique le recours au pouvoir afin d’extraire, contre le gré des dominés, travail, production, service ou impôts, elle engendre une grande forme de résistance et ne peut se maintenir que grâce à des efforts continus pour la renforcer, la préserver et l’ajuster. Une grande partie de ces travaux de maintenance est ancrée dans le symbolisme de la domination, par le biais de manifestations et de mises en scène du pouvoir. Chaque manifestation publique et affichée du pouvoir — chaque ordre, chaque acte de déférence, chaque liste et chaque classement, chaque disposition cérémoniale, chaque punition publique, chaque mention d’un terme honorifique ou péjoratif — constitue un geste symbolique de domination qui à la fois exprime et renforce l’ordre hiérarchique. » (La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Éditions Amsterdam, 2019 [1992])
Pouvoir : « Avoir le pouvoir, c’est n’être pas dans l’obligation d’agir, ou, plus précisément, avoir la capacité de se comporter de manière négligente ou informelle lors d’une transaction donnée. […] Le dédain associé à la possession du pouvoir peut bien au sens physique renvoyer à un moi qui ne serait pas sur ses gardes, alors que la servilité nécessite presque par définition une observation attentive de l’humeur et des exigences du détenteur du pouvoir, suivie des réponses appropriées. » (La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Éditions Amsterdam, 2019 [1992])
Quadrillage : « Le capitalisme à grande échelle est tout autant porteur d’homogénéisation, d’uniformité, de quadrillage et de simplifications extrêmes que l’État, avec néanmoins une différence : du point de vue des capitalistes, la simplification doit rapporter. » (L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 2021 [1998])
Spontanées : « La plupart des révolutions ne sont pas l’œuvre de partis révolutionnaires, mais bien le précipité d’actions spontanées et improvisées (l’aventurisme
dans le jargon marxiste), […] les mouvements sociaux organisés sont habituellement le produit, et non la cause, de protestations et de manifestations non coordonnées et […] les grands acquis émancipateurs et porteurs de liberté pour l’humanité ne sont pas le fruit de procédures institutionnelles ordonnées, mais bien d’actions désordonnées, imprévues et spontanées qui ont fissuré l’ordre social de bas en haut. » (Petit éloge de l’anarchisme, Lux, 2013 [2012])
Tribu : « La tribu
constitue un module de gouvernement
. J’entends par là le fait que désigner des tribus était une technique permettant de classer et, éventuellement, d’administrer ceux qui n’étaient pas ou pas encore des paysans. Une fois la tribu désignée comme telle et rapportée à un territoire, elle pouvait faire office d’unité servant à établir un tribut en hommes et en marchandises, d’entité à laquelle il était possible d’assigner un chef officiel […]. Les États et les empires créent des tribus afin, précisément, de mettre un terme au caractère fluctuant et informe des relations sociales vernaculaires. […] Leur existence n’a pour seul but que de mettre un terme administratif aux flottements en tous genres, en instituant des unités de gouvernance et de négociation. » (Zomia ou l’art de ne pas être gouverné. Une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est, Seuil, 2013 [2009])
Utilitariste : « Parce qu’elle en était arrivée à percevoir la forêt comme une marchandise, la foresterie scientifique entreprit de la remodeler comme une machine produisant cette marchandise. La simplification utilitariste de la forêt constitua certes une manière efficace de maximiser la production de bois à court et moyen terme. Toutefois, au bout du compte, son insistance sur les quantités et les profits comptables, son horizon temporel relativement court et le vaste ensemble de conséquences qu’elle avait résolument décidé d’ignorer revinrent la hanter. […] La forêt simplifiée constitue un système plus vulnérable, en particulier sur le long terme, car ses effets sur les sols, l’eau et les populations parasites deviennent manifestement négatifs. » (L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 2021 [1998])
Violence : « Dans un système de domination, il ne s’agit pas seulement de dissimuler ses sentiments et de produire les gestes attendus à la place. Il est plutôt souvent question de contrôler l’impulsion naturelle poussant à la rage, aux insultes, à la colère et à la violence que ces sentiments font naître. […] Pour tous ceux qui au cours de l’histoire ont connu la servitude, […] la clé de la survie, de loin pas toujours maîtrisée, a été de ravaler sa bile, d’étouffer sa rage et de dominer l’impulsion de violence physique. » (La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Éditions Amsterdam, 2019 [1992])
W. E. B. DuBois : « Afin de comprendre les fantasmes les plus luxuriants du texte caché, il faut les considérer non pas isolés mais en tant que réaction à la domination […]. L’inventivité et l’originalité de ces fantasmes s’expriment dans la manière dont ils inversent et annulent une domination particulière. Personne ne perçut ceci avec autant d’acuité que W. E. B. DuBois, qui écrivit à propos de la double conscience du Noir américain provenant de la ségrégation raciale : Une telle double vie avec des pensées, des devoirs et des classes sociales dédoublées doit nécessairement donner naissance à des paroles et à des idéaux dédoublés , et tenter l’esprit vers les faux-semblants ou la révolte, vers l’hypocrisie ou vers le radicalisme.
» (La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Éditions Amsterdam, 2019 [1992])
XIXe siècle : « Au moins jusqu’au début du XIXe siècle, les difficultés de transport, l’état de la technologie militaire, et par-dessus tout les réalités démographiques, imposaient de sévères limites à l’extension des États, y compris des plus ambitieux. » (Zomia ou l’art de ne pas être gouverné. Une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est, Seuil, 2013 [2009])
Yeux : « L’histoire de la propriété est celle de l’incorporation inexorable au sein d’un régime foncier de ce qui était précédemment perçu comme des cadeaux de la nature : forêts, gibier, friches, prairies, minerais souterrains, eau et cours d’eau, droits aériens (concernant l’espace situé au-dessus de bâtiments ou d’une surface donnée), air respirable et même séquences génétiques. Dans le cas de terres arables détenues en commun, l’imposition de la pleine propriété apportait une clarification non aux habitants de la localité — la structure du droit coutumier avait toujours été suffisamment claire à leurs yeux —, mais au percepteur et au spéculateur foncier. Le cadastre apporte aux pouvoirs publics une mine de renseignements et fournit ainsi la base de la vision en surplomb de l’État et le fondement d’un marché foncier supralocal. » (L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, La Découverte, 2021 [1998])
Zomia : « Ce qui fait de la Zomia2 une région ne réside donc pas tant dans une unité politique, qui lui fait cruellement défaut, mais dans des formes comparables de divers types d’agriculture collinéenne, dans la dispersion et la mobilité, et dans un égalitarisme brouillon incluant — cela n’est pas accessoire — un statut relativement plus élevé pour les femmes que dans les vallées. […] Les populations des collines de la Zomia ont activement résisté à l’incorporation au sein de la structure de l’État classique, de l’État colonial et de l’État-nation indépendant. […] La Zomia n’est pas simplement une région de résistance aux États des vallées : elle est aussi une zone-refuge
. Par refuge
, je veux signifier qu’une bonne partie de la population des collines est venue s’y installer, durant plus d’un millénaire et demi, afin d’échapper aux diverses souffrances qui résultaient des projets de construction étatique des vallées. Loin d’être des laissés-pour-compte du progrès de la civilisation des vallées, ces populations ont, sur le long terme, choisi de se placer hors de portée de l’État. » (Zomia ou l’art de ne pas être gouverné. Une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est, Seuil, 2013 [2009])
1. « Je n’ai donc pas su quoi faire et j’ai demandé à rejoindre la CIA. J’avais posé ma candidature à la faculté de droit de Harvard et j’avais été accepté, et sur une sorte d’éclair d’audace, j’ai posé ma candidature pour une bourse du Rotary pour la Birmanie, et j’ai obtenu la bourse du Rotary pour la Birmanie. Je me suis dit : Je peux reporter la faculté de droit de Harvard, je peux toujours aller à la faculté de droit, mais quand aurai-je l’occasion d’aller en Birmanie ?
J’ai donc décidé d’aller en Birmanie et j’y ai passé un an. Entre-temps — cela ne figure pas dans beaucoup de mes documents — les gens de la CIA m’ont demandé de rédiger des rapports sur la politique étudiante birmane et ainsi de suite, ce que j’ai fait. Ensuite, ils se sont arrangés avec l’Association nationale des étudiants pour que j’aille à Paris pendant un an et que je sois le représentant à l’étranger de l’Association nationale des étudiants. » Interview menée par Todd Holmes en 2018 dans le cadre du Yale Agrarian Studies Oral History Project.
2. « Cet immense espace montagneux situé à la périphérie de l’Asie du Sud-Est continentale, de la Chine, de l’Inde et du Bangladesh s’étend sur environ 2,5 millions de kilomètres carrés. […] Des calculs approximatifs estimeraient les populations minoritaires de la Zomia à environ 80 à 100 millions de personnes. Ses populations sont fragmentées en centaines d’identités ethniques et au moins cinq familles linguistiques qui défient toute classification simple. »
Ballast, 27 août 2025.
Illustration: Paul Klee
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte