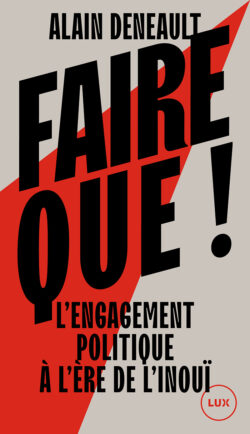Sous-total: $

«Biorégion»: cinquante ans de préparation à l’autonomie politique
Alain Deneault est un philosophe québécois, auteur de nombreux essais comme « La médiocratie, Politique de l’extrême centre », ou encore « Faire que ! L’engagement politique à l’ère de l’inouï », à l’occasion duquel il avait accordé un entretien à Blast. Dans ce texte exclusif, l’intellectuel retrace le parcours du concept de « biorégion » et démontre les raisons pour lesquelles il est un instrument central pour les luttes de demain.
Il y a cinquante ans naissait le concept de biorégion. Ce concept, plus complexe qu’il n’y parait, vise à outiller les communautés qui se choisissent libres de s’organiser en fonction des dynamiques propres à leur territoire, dans un esprit universel. Non plus plaquer sur les lieux ses propres visées mais apprendre à composer avec eux du point de vue de la politique, de la science et de la culture. C’est une révolution, mais elle s’impose par la force des choses, ici et maintenant, où qu’on soit. L’effondrement de la biodiversité, les bouleversements climatiques, la pollution massive, la production de déchets multiples, l’assèchement des eaux, l’érosion des sols, la surpêche, l’épuisement des réserves énergétiques et l’éradication minière rendent impérative l’organisation biorégionale.
Non pas partir du concept de biorégion, mais de l’histoire qui nous y conduit inexorablement. Plutôt qu’une vague utopie ou une option de plus offerte à la carte du restaurant électoral, voir en la « biorégion » le nom d’une réponse à donner à une situation impérative, source historique d’angoisse : la contraction annoncée de la géopolitique de la mondialisation à la région.
Comme à Mayotte, comme à Valence, comme à La Nouvelle-Orléans, Clova au Québec ou Lytton dans l’ouest canadien, des communautés entières secouées par des déluges ou des incendies de forêts sont appelées à redécouvrir crûment deux vérités anthropologiques : elles dépendent en dernière instance d’elles-mêmes, de leur entregent, de leur sens de la solidarité. Puis, elles se découvrent redevables du territoire qu’elles foulent, de ses sols, de son air, de ses eaux. « Vous nous avez abandonnés », clame-t-on de part et d’autre. Pour se résigner : c’est aussi à partir de cette échelle qu’on organisera désormais la politique. Et cette nouvelle approche appelle des concepts politiques adéquats.
Nous traversons comme société des moments inouïs. In-ouïs, jamais entendus, inédits. Il suffit d’entendre comment les instances politiques et/ou scientifiques exposent les menaces réelles qui pèsent sur la biodiversité, le climat, l’économie de la nature pour s’en convaincre. Jamais depuis des millions d’années n’a-t-on vu autant se transformer l’équilibre entre les espèces. Jamais depuis ce nombre insaisissable d’années n’en a-t-on vu s’éteindre. Jamais depuis 10 000 ans l’évolution du climat n’a été aussi rapide et radicale. Les phénomènes tels que les inondations, les ouragans et les sécheresses sont appelés à s’accentuer, car le processus de réchauffement climatique se révèle autonome et exponentiel : la fonte des glaciers a cours désormais d’elle-même puisque les surfaces réfléchissantes se réduisent, tout comme les étendues forestières, et menacent de se fissurer, laissant ainsi se libérer un méthane naturellement enfoui, un puissant gaz à effet de serre. De plus, rien n’arrête l’industrie dans son empoisonnement agrochimique des espèces.
À cela s’ajoute la raréfaction annoncée des énergies fossiles de même que des minerais censés garantir une prétendue « transition » énergétique (1). Puis les incertitudes géopolitiques relatives aux guerres et au commerce international.
Or, le caractère inédit de la situation peut aussi passer pour indicible. Comment penser encore cette conjoncture nôtre, sans précédent, sans pareil dans l’histoire, inouïe. Est-ce que penser reste une chose possible ? L’historien et essayiste Paul Veyne aurait indiqué que non. Chez lui, comparaison est raison, et c’est dans un va-et-vient entre des situations occurrentes et passées qu’on en vient à se donner une conception précise sur la singularité de ce qu’on traverse. Il nous est ainsi donné de penser l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un nouveau virus ou des actes génocidaires d’un pays d’occupation comme au Moyen-Orient… Nous connaissons (hélas) des précédents.
Mais la déstabilisation du système Terre lui-même ? Faire le deuil de l’expression Ceteris paribus sic stantibus (toute chose étant égale par ailleurs), afin d’isoler des variables quant à ce sur quoi faire fond. Considérer désormais que rien n’est stable, tout bouge, tout s’altère…
Ce n’est pas sans raison que l’angoisse apparaît comme un mal psychique partagé. L’angoisse, c’est l’épreuve d’affects insistants, déstabilisants et troublants qui ne s’accompagnent d’aucune cause, image ou représentation précises. Contrairement à l’anxiété qui explique un malaise par le surinvestissement d’un objet (réel ou fictif), l’angoisse exprime la souffrance de qui n’en a guère.
Face à l’angoisse, les plus démunis, indépendamment de leur profil sociologique (classe sociale, diplomation, statut professionnel…), en proie à des émotions sans nom ni symbole, cherchent désespérément des objets de substitution, soit un paratonnerre sur lequel projeter son trouble. Arrivent alors une multitude de boutiquiers de l’extrême droite, avec leur offre de boucs émissaires. Tout va bien, ou tout irait bien, si… Si on faisait ablation avec telle ou telle catégorie sociale ou culturelle. Nous ferions ensuite Un avec nous-mêmes, dans le formol de l’histoire, ne constituant plus qu’une seule cellule, pour nous vautrer une fois pour toutes dans la jouissance de la pulsion de mort.
Mais face à l’angoisse, les plus aguerris, là aussi de toute provenance sociale, mobilisent cette énergie psychique au service de desseins adaptés, de concepts adéquats, de principes opportuns. Certains sont mis à disposition et nous font avancer : celui de « chimère » chez Baptiste Morizot (2) qui nous outille quant à un temps où tout change, où le terrain vague devient un marais et ailleurs le marais, un terrain vague; où l’ours brun apprend à monter vers le nord en temps de canicule, mais où l’ours blanc, ayant lui perdu sa banquise, découvre les chemins du sud. Ils déjouent les prétendues « lois de la nature » de l’épistémologie humaine, se rencontrent et découvrent une nouvelle espèce. Politiquement aussi, des chimères sont de rigueur. Par exemple, la biorégion.
Un concept lucide et joyeux
En tant que concept, la « biorégion » a aujourd’hui cinquante ans. Allen van Newkirk lui donnait son acte de naissance en le proposant dans un court texte de la revue Environnemental Conservation à l’été 1975. Depuis le repaire historique du mouvement coopératif en Amérique, à Heatherton dans la région d’Antigonish (Nouvelle-Écosse, partie atlantique du Canada), cet artiste d’origine états-unienne devenu militant écologiste cherchait à fonder une géopolitique tout autre, dans laquelle le préfixe géo– serait aussi déterminant que la racine politique (3). Il ne s’agissait plus de faire de la politique sur le territoire, en fonction de son exploitation et dès lors contre lui, mais d’intégrer radicalement la politique aux dynamiques territoriales elles-mêmes.
Partant de la notion de région biotique, non loin des mouvements de retour à la terre ou du municipalisme libertaire, sans s’y restreindre, il perçoit d’abord la biorégion en fonction de sa portée biologique. Autrement dit, la politique ne s’imprime plus sur le territoire à la manière d’espaces qu’il faut rendre conformes aux cartes et aux intérêts dictés par l’exploitation industrielle et commerciale, mais elle s’intègre aux réalités biologiques et territoriales d’un lieu. La flore, la faune, les sols, les eaux, le climat, les bassins versants… sont ce à partir de quoi les citoyens d’un espace politique savent amorcer leurs pratiques. La signification du lieu commence par l’histoire, pas seulement celle, sociale, des sciences humaines, mais l’histoire même qui a rendu possible la gestation millénaire du lieu qu’on occupe. Comprendre ce qu’il en a fallu de contributions de la part des insectes, des oiseaux, des grands mammifères, y compris des humains, pour qu’un lieu perdure comme il l’est, le cas échéant où il ne faudrait pas chercher à tenter de le restaurer, afin d’envisager la façon de s’y fondre pour les temps à venir.
Science, culture et politique
Cela implique une approche à la fois interdisciplinaire et, à ce titre, égalitaire. Aucune discipline, c’est-à-dire pas plus les sciences exactes que les autres, contrairement à ce qui se produit maintenant au titre du discours écologique, n’occupe de fonction hégémonique. Certes, la modélisation, la biologie, l’océanographie et la climatologie sont prisées, tout comme le devient également la sapience, c’est-à-dire les savoirs populaires accumulés indépendamment des titres de diplôme. L’historien des sciences Dominique Pestre invite ses collègues scientifiques à « apprendre à faire confiance aux solutions que le social invente (4) ». Il se peut que ceux-là mêmes qui dépendent du territoire sachent en défendre les modalités agricoles et les normes escomptées, surtout dans un contexte où il s’agit d’en vivre plutôt que de les exploiter aux fins de pratiques commerciales coloniales.
À cela s’ajoute la culture, la littérature et les arts : se redonner de nouveaux récits, s’expliquer par la fiction des situations semblables à la sienne pour suppléer l’absence de référence historiographique relative à la période inouïe qu’on traverse, réorganiser la façon de découper le réel. Un exemple dans le domaine du landart, les œuvres d’Andy Goldsworthy. En traçant des lignes dans l’espace à partir d’éléments qu’il y trouve (brindilles, feuilles, pierres…), il nous persuade de la pertinence d’une autre forme de tracé dans l’espace, non plus celui des frontières qui consiste pour le plus fort à circonscrire un lieu pour clamer que ce qui s’y trouve lui appartient, mais celui qui marque à l’intérieur d’un cadre symbiotique déterminé par lui-même (on sait en suivant ses dynamiques quand un lieu s’arrête et cède à un autre) quel en est l’axe de vie, la ligne symbiotique, exemplairement une rivière ou une bande cultivable…
Enfin, la politique. La biorégion ne se « développera » pas parce qu’on la désire, vote pour elle ou la choisit. Elle s’imposera, là où une avant-garde en aura prédit la nécessité, dans des contextes historiques de bris, de drames ou de crises où on se découvrira dépendant de soi-même. Dans de tels désarrois, des petits-chefs vociféreront pour ameuter une catégorie de soumis face aux autres à qui ils déclareront la guerre. Les plus fins opteront pour l’entraide. Ils trouveront à fonder des communs autour d’éléments (fours à pain, terres arables, caveaux, compétences diverses…) favorisant le rapport de la communauté aux épreuves, urgences et aspirations qui deviendront les siennes. De nouvelles organisations politiques, à partir de ce que les zones à défendre, collectifs, associations et coopératives génèrent déjà, prendront le pas pour être à la hauteur du changement de paradigme qui ne manquera pas de s’imposer en ce siècle.
En cela, la biorégion ne procède pas d’un parfait renversement. Ce n’est pas tout à fait une révolution, si elle n’est pas de celles qui s’accomplissent par « la force des choses » comme l’écrivait Hannah Arendt, et non pas par la seule volonté sociale. Elle peut encore cohabiter dans le mille-feuille institutionnel avec les différents pouvoirs institués, ceux qui, impuissants, en ont déjà plein les bras avec les mutations historiques du siècle et se retournent parfois contre les communautés pour les coloniser à nouveau. Elle n’est pas passéiste au sens où des architectes imaginent par quelles nouvelles techniques habiter grâce à des matériaux environnants et recyclables, et où des permaculteurs conçoivent des formes adaptées d’agriculture sans recourir aux laborieuses méthodes des anciens. Elle est universelle au sens où elle croit que l’Afrique doit venir au secours de l’Occident (5), et lui permettre de partager des expériences agricoles et sociales provenant d’un monde qui a pu se passer d’un capitalisme aujourd’hui vacillant, tout comme les peuples premiers des Amériques.
La biorégion est surtout un concept vitaliste et affirmatif qui permet de surmonter l’angoisse occasionnée par les discours accablants de l’époque, pour avancer, à tâtons, frayant un chemin vers ce qui s’impose comme nécessaire.
(1) Matthieu Auzanneau, Pétrole. Le déclin est proche, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Reporterre », 2022 ; Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Paris, Les Liens qui libèrent / Acte Sud, 2019, et Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition : une nouvelle histoire de l’énergie, Paris, Seuil, coll. « Écocène », 2024.
(2) Baptiste Morizot, Raviver les brasiers du vivant, Arles, Actes Sud/Wildproject, coll. « Domaine du possible », 2020.
(3) Allen van Newkirk, « Bioregions: Towards Bioregional Strategy for Human Cultures », Environmental Conservation, no 2, vol. 2, Été 1975, p. 108. Lire aussi Mathias Rollot et Marin Schaffner, Qu’est-ce qu’une biorégion ?, Marseille, Wildproject, 2021.
(4) Dominique Pestre, À Contre-science. Politiques et savoirs des sociétés contemporaines, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées, 2013, p. 84. Selon le beau titre du livre d’ Anne-Cécile Robert, L’Afrique au secours de l’Occident, Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 2006.
Alain Deneault, Blast, 10 août 2025.
Photo/illustration: Thibault Inglebert
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte