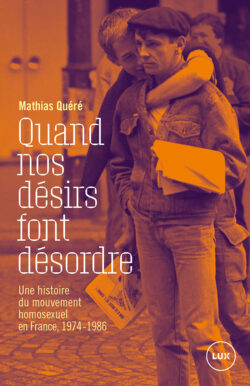Sous-total: $
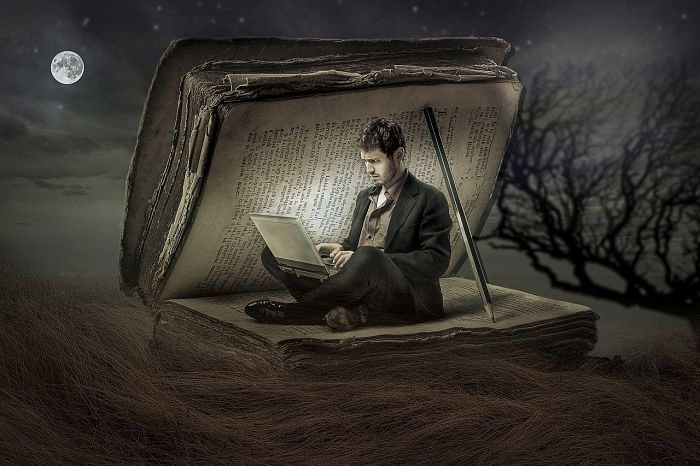
Mai, ou, et, donc, le rat noir?
Il sera beaucoup question d’Histoire en ce mois de mai. Avec tout d’abord en Grèce, avec la découverte du monde des manguès et du rébétiko avec l’autobiographie de Markos Vamvakaris : Moi Markos. Italie : retour fascinant sur l’histoire romaine avec La véritable histoire des douze Césars de Virginie Girod. Enfin, arrêt en France avec deux histoires homosexuelles qui malgré le temps, se font écho. La première : celle de Bruno et Jean au XVIIIème siècle, racontée par Pauline Valade et la seconde plus récente : Quand nos désirs font désordre de Mathias Quéré, durant les années 1970/80.
[…]
Dans Quand nos désirs font désordre (éd. Lux), l’historien Mathias Quéré nous propose « une promenade historique sur les traces du mouvement homosexuel en France, d’environ 1974 à 1986 ».
Cet essai est sans doute à ce jour, le plus consistant et exhaustif qu’il m’ait été permis de lire sur la question, c’est du moins mon point de vue. D’où la longueur inhabituelle de cette recension qui n’a d’autre but que de tenter de donner un petit aperçu de tous les sujets abordés et développés.
A commencer par l’idée de prétendre que la lutte homosexuelle a pris ses racines à New-York (Stonewall) dans la nuit du 28 juin 1969, durant laquelle des femmes trans, des homo, travestis et des lesbiennes affrontèrent la police pendant des heures. Et que par ricochet, Stonewall déclencha le début des mouvements d’émancipation homosexuelle en France au début des années 70. Or, après avoir entrepris dix années de recherches poussées à fouiller dans les documents, archives privées et publiques, l’auteur va nous montrer qu’il n’en est rien. Et qu’une variété de groupes occupa le terrain avant la naissance du mythique Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR) au printemps 1971, et pendant ET après la disparition du Comité d’urgence anti-répression homosexuelle (CUARH), en 1986.
« Mon travail a surtout consisté à rendre tous les aspects d’une réalité d’une histoire complexe avec ses erreurs et ses errances, afin d’écarter une vision exemplaire mais illusoire qui rendrait le présent plus terne »
Ceci est tout à son honneur. Son récit commence par un regard jeté sur la société française durant les XIX et XXème siècles où les pouvoir policier et judiciaire « réprimèrent à cœur joie les homosexuels », alors que le crime de sodomie fut aboli en 1791. Mais, en août 1942, Philippe Pétain réintroduisit la pénalisation de certaines relations homosexuelles. Elle fut maintenue et même renforcée en 1960, par l’amendement Mirguet – qui qualifia l’homosexualité de « fléau social », au même titre que l’alcoolisme et la tuberculose ! – et fit en France, plus de 10 000 personnes jugées coupables et condamnées à la prison, ceci jusqu’à la dépénalisation en 1982 …
Comme il se doit, Mathias Quéré commence par nous narrer l’histoire du mouvement pionnier Arcadie fondé en 1953, par un ancien séminariste mais qui resta dans la mémoire collective homosexuelle, « comme le symbole d’une organisation réactionnaire, réformiste, normative et pyramidale ». Petit saut dans le temps : pourquoi faudra-t-il attendre mai 1974, pour qu’une branche de jeunes dissidents d’Arcadie forme le Groupe de Libération Homosexuelle (GLH) ? Quelle furet son histoire et ses scissions ?
Retour à mai 68, quand le premier mouvement révolutionnaire « une étincelle » selon l’auteur, le Comité d’Action pédérastique [note] révolutionnaire (CAPR) voit le jour à la Sorbonne, seulement animé par deux individus ! Et il faudra encore attendre trois ans la naissance du FHAR « créé par des lesbiennes et des féministes ce que beaucoup de gens ne savent pas et qui propagera l’incendie homosexuel » …
Mathias Quédé va nous promener à travers son histoire et nous expliquer le mouvement en trois actes. L’intervention énergique de militants dans l’émission radiophonique de Ménie Grégoire, puis l’occupation du devant de la scène par Guy Hocquenghem et Françoise d’Eaubonne et enfin, la participation du FHAR à la manifestation du 1er mai 1971, aux côtés des féministes du MLF, etc.
L’auteur qui ne souhaite rien négliger nous rappellera également, la mésaventure de l’association religieuse David et Jonathan, souvent oubliée. Après « la mort du cygne » FHAR, l’auteur sautera les années pour en venir à la naissance des premières petites annonces dans Libération, où sont entrés plusieurs anciens militant.es du FHAR. Puis les évènements qui suivirent, la semaine homosexuelle au cinéma Olympic en 1977, la première grande marche autonome à Paris avec le slogan : « Le ghetto c’est foutu, les pédés sont dans la rue », etc. Mathias Quéré élargit son champ sur la sur la réalité quotidienne des homosexuel.les à l’époque à Paris et leur combat contre la répression. Il nous livre ensuite des témoignages venus de province où « les homosexuel.les sont éparpillés sur le territoire, refoulés dans des ghettos et crèvent de solitude ».
On avance dans le temps, tandis que l’auteur pointe du doigt les divergences qui se font jour vers la fin des années 70. Entre les groupes féministes et les lesbiennes, entre les féministes et les groupes de garçons homos, mais aussi entre ces derniers et les lesbiennes qui refusent de « jouer le rôle de faire valoir et subir la misogynie dans les groupes mixtes ».
Et quid de leurs rapports avec les organisations de gauche et d’extrême-gauche ? Nous allons être surpris par les premières positions du PCF et de la CGT, mais aussi par celles des trotskistes, maoïstes et mêmes anarchistes. Encore autant de témoignages édifiants à découvrir. Comment réagir alors ? Nous verrons ici les GLH s’immiscer de force dans les grandes marches antimilitaristes, en solidarité avec les soldats emprisonnés (on peut lire à ce sujet, Contingent rebelle de Patrick Schindler), antinucléaires, au sein des Comités Prison. Passage intéressant sur la dimension européenne sous le slogan issu du FHAR « Prolétaires de tous les pays caressez-vous » !
Changement de ton à partir de 1979 où une répression musclée, policière et de l’extrême-droite sévie dans les lieux culturels parisiens. Quid de la perception des homosexuels.le au sein de l’Education nationale ? Là encore nous ne laisserons pas d’être ébahis ! C’est en réaction que font le créer les Comités Homosexuels d’Arrondissement (CHA) dont certains membres vont par provocation se présenter aux élections locales (non sans quelques réticences) pour affirmer leur visibilité.
On est une fois encore surpris par l’étendue du travail de Mathias Quéré qui nous entraîne dans les aventures des revues Masques et Gai Pied, des radios pirates ou de l’Association des Médecins Gais (AMG). Devant les nouvelles attaques juridiques, c’est au tour des Comités Urgence Anti-répression homosexuelle (CUARH) de voir le jour ayant pour objectif majeur de lutter pour l’abrogation de l’article 331-alinéa 3, toujours en vigueur et sa longue agonie entre les deux Chambres … L’auteur s’arrête longuement et sans concessions sur la problématique des lesbiennes « exaspérées par l’invisibilité où elles sont condamnées dans les orgas féministes et homosexuelles garçons » et leur mobilisation pour trois cas vécus par des lesbiennes voulant obtenir la garde de leurs enfants.
L’approche des élections présidentielles de 1981 verra-t-elle jaillir un espoir ? C’est ici que nous allons assister à la mobilisation homosexuelle « donner de la voix contre une législation homophobe ». Arrêt sur « la plus grande manifestation jamais vue en Europe » qui rassemble à Paris, plus de 15.000 homosexuels et gay-friendly (pour l’anecdote sur la photo page 106, on aperçoit un Rat noir (entre le lapin et le sarouel) dont le Gai Pied fera sa Une…). Quid une fois François Mitterrand élu le 10 mai 1981 ? Sept ans de bonheur, comme le titre Gai Pied ? Pas si sûr, la suite va nous le prouver… Mais auparavant, l’auteur va nous promener à travers les dernières heures du CUARH (à découvrir) et le long de la première Pride, organisée en 1982. Début d’une marchandisation de l’homosexualité ? Mais aussi nous faire découvrir les premières heures de Fréquence gay, la première radio homosexuelle à émettre 24/24, 7 jours sur 7. Et en province quels sont alors ces espaces associatifs qui fleurissent un peu partout ? Arrêt sur Lesbia, le magazine lesbien, les bars gays qui se multiplient à Paris comme en province et les premiers saunas ? Hauts lieux à risques ?
Mais l’euphorie des premiers jours du socialisme n’a qu’un temps. Quels vont être les retours de bâton ? Quels sont ces milliers de policiers qui défilent à Paris en juin 83, hurlant des slogans antisémites, homophobes et qui ratonnent les immigrés sur leur passage ? Pourquoi ces rafles dans bars gays de l’Hexagone ? Au passage quel est ce nouveau « bloc homosexuel de droite » qui sort du tableau ? Et comme par hasard, pourquoi l’affaire du Coral éclate-t-elle à ce moment précis ? Mathias s’y s’arrête longuement avec une attention juridique toute particulière, essayant de remettre quelques pendules à l’heure et de comprendre les raisons de la confusion qui va en résulter. Cependant le pire est encore à venir avec les débuts de l’épidémie du sida dans le monde occidental, qualifiée de « cancer gay » !… Comment va réagir le corps médical ? A quand les premiers dépistages, les premiers traitements ? Une fois les populations hétérosexuelles, hémophiles et toxicomanes touchées, pourquoi l’image première d’une « punition divine » pour les homosexuels va-t-elle prédominer dans l’opinion – y compris dans les milieux homos ? C’est en farfouillant dans les archives que Mathias va tenter de trouver les réponses à ces questions, mais aussi aux suivantes : à quelle date, la recherche, la direction de la Santé et les militants gays vont-ils réagir ? Pour quelle mobilisation ? Quid à l’international, tandis que l’épidémie progresse et que les morts se multiplient à partir de 1984 ? Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour qu’une première association de malades d’envergure comme AIDES voit le jour ? Pour que la première permanence téléphonique bénévole soit opérationnelle et les premiers traitements commencent à agir après l’hécatombe ? Enfin, faudra-t-il attendre 1989 et la naissance d’Act Up Paris pour que le combat politique homosexuel ressurgisse avec le début d’une autre histoire ?
Celle de ce livre qui fera sans doute référence s’achève, elle, en 1986. Dans l’épilogue, Mathieu Quéré nous met en garde et nous rappelle judicieusement que c’est justement cette année-là qu’est né le magazine d’extrême-droite Gaie France (avant d’être interdite en 1993), « alors que les idées d’extrême-droite prolifèrent toujours plus dans une communauté qui n’en a que le nom. Et que faire à présent que l’extrême-droite est aux portes du pouvoir et que les attaques fascistes se multiplient » ?
On ne saurait mieux conclure !
Patrick Schindler, groupe de Rouen, ancien militant du FHAR et d’Act-Up Paris, Le Monde libertaire, 1er mai 2025.
Lisez l’article complet ici.
 Mon compte
Mon compte