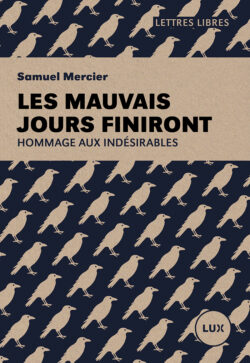Sous-total: $
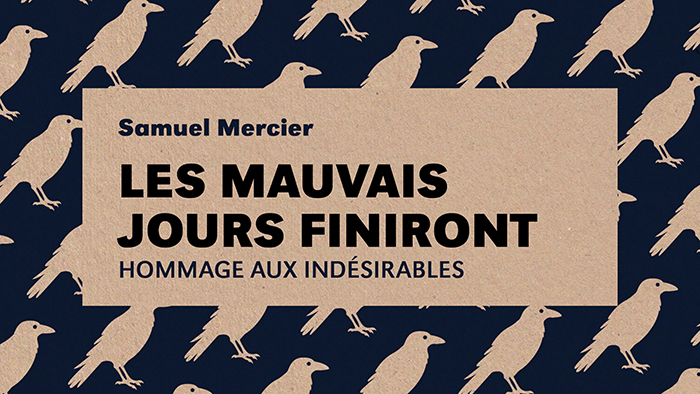
La viande a toujours une histoire
Ce texte est un extrait de l’ouvrage Les mauvais jours finiront, hommage aux indésirables de Samuel Mercier publié aux éditions LUX dans la collection Lettres libres. Pour en savoir plus et pour continuer la lecture, vous pouvez vous procurer cet ouvrage chez votre libraire préféré ou encore directement sur le site web de l’éditeur.
« Le succès de l’extrême droite en France, celui de Trump aux États-Unis et des conservateurs au Canada réside en partie dans ces zones dévitalisées à qui l’on ne promet rien, sinon de survivre en recevant en prime le mépris des urbains. »
– Un extrait de Les mauvais jours finiront de Samuel Mercier publié chez LUX.
La chasse au chevreuil est un art de l’invisibilité. Tous les sens du chevreuil sont meilleurs que les nôtres. Il sent mieux, voit mieux le mouvement et entend mieux que nous. Il faut donc laver nos vêtements avec du savon sans odeur, les laisser à l’extérieur pour ne pas les imbiber d’odeurs de cuisine, les enfiler dehors, entrer dans une cache soigneusement choisie d’après la direction du vent en pleine nuit sans faire trop craquer les branches ou le sol gelé, puis s’armer de patience. En novembre, le matin est glacial. Dès que le soleil se lève, l’évaporation fait tomber la température. Aussi bien habillé qu’on soit, le froid finit par gagner sur nous à cause de l’immobilité. On utilise des chauffemains et des chauffe-pieds qu’on essaye de coincer dans ses gants ou dans ses bottes. Il y a quelque chose de prenant dans le devenir- invisible. Chaque craquement de doigt, chaque bruissement d’enveloppe retentit comme une catastrophe.
Samedi matin, deux coyotes sont passés, un des deux s’est arrêté à quelques mètres de ma cache sans me voir. Il avait la taille d’un berger australien et son pelage, qui tirait sur le roux, avait déjà la touffeur de l’hiver. Dès qu’ils entendent les premiers coups de feu de la saison, les coyotes deviennent fous. Ils sortent en plein jour et patrouillent dans l’espoir de trouver les entrailles des chevreuils abandonnés par les chasseurs. J’avais choisi la bordure du champ de maïs parce que les moissonneuses- batteuses s’activaient plus loin. Les deux autres chasseurs qui m’accompagnaient étaient dans la forêt à côté, l’un dans l’érablière, l’autre dans une cédrière. Les chevreuils mâles se cachent souvent dans les champs durant l’été pour y manger et y dormir et j’avais espoir que la moisson en fasse fuir un jusque devant ma .270.
Le territoire sur lequel je chasse est situé à quelques kilomètres du site Droulers-Tsiionhiakwatha, un village iroquoien redécouvert par les archéologues. Aujourd’hui, la région de Saint-Anicet et de Godmanchester est recouverte de champs de maïs. Elle l’était aussi, quoique différemment, avant l’arrivée des colons. Les champs des Iroquoiens étaient sans doute plus modestes, mais plus beaux que les rangées droites taillées au GPS du maïs-grain moderne. On y cultivait les courges et les pois aussi bien que le blé d’Inde. Chez les Iroquois, qui sont en partie leurs descendants, la tradition était de planter toujours au moins un champ de plus pour nourrir les chevreuils. Les épis devant moi étaient donc peut-être les descendants de ces nobles plantes, devenues aujourd’hui une variété portant un numéro et modifiée génétiquement pour résister au glyphosate. Évidemment, on ne plante plus pour nourrir les chevreuils, mais surtout pour alimenter des vaches Holstein ou des cochons enfermés 24/7 dans de grands bâtiments gris. Cette année, on récolte un peu tard à cause des pluies. Il faut imaginer des hectares et des hectares de terres plates, plantées d’épis jaunis par l’automne… un paysage à la Fargo plus qu’à la Moissons du ciel.
-_-_-_-
C’est un problème qui existe au moins depuis Marx, mais la vie rurale et celles des petites villes sont les grandes absentes du discours de gauche, qui s’adresse aujourd’hui principalement à ce que Piketty appelait dans Capital et idéologie la « gauche brahmane », urbaine, scolarisée, employée dans le secteur public et tertiaire. Le succès de l’extrême droite en France, celui de Trump aux États-Unis et des conservateurs au Canada réside en partie dans ces zones dévitalisées à qui l’on ne promet rien, sinon de survivre en recevant en prime le mépris des urbains.
L’agriculteur qui faisait son champ ce jour-là travaillait seul, conduisant lui-même tour à tour la moissonneuse- batteuse et le tracteur dont il remplissait la remorque de grains de maïs pour aller le porter ensuite au séchoir. Être agriculteur, c’est travailler 80 heures par semaine et devoir son âme à la financière agricole. La ville la plus proche du lot, Huntingdon, a été frappée par le malheur en 2004 quand ses cinq usines textiles ont fermé le même jour. La petite ville, prospère au début du XXe siècle, ne s’en est jamais tout à fait remise. Huntingdon est ce qui ressemble le plus à la rust belt du Québec. Au centre-ville, le bâtiment O’Connor, un immeuble patrimonial du début du dernier siècle, gît abandonné. En face, l’ancien moulin textile est une masse grise échouée au bord de la rivière Châteauguay.
La députée de la région est Carole Mallette, de la Coalition avenir Québec (CAQ). Quarante pour cent de la population de Huntingdon est anglophone. Ce ne sont pas les patrons d’usine du folklore québécois, mais les restants de race abandonnés là par les plus riches de leurs congénères, qui eux sont partis en Ontario dans le temps du Parti québécois et des référendums. Le restaurant grec est placardé. Plus loin, à Sainte-Barbe, le seul magasin de chasse du coin est « fermé pour inventaire » depuis des mois. Sur mon lot, situé à distance de marche de la frontière américaine, non loin de Trout River, où les miliciens canadiens ont arrêté les fenians en 1870, j’ai croisé le voisin qui a un jour essayé de me vendre un de ses lapins, m’offrant de me le tuer et de me le vider pour trente dollars. Il se promenait sur son terrain avec un téléphone filaire muni d’un très long câble parce qu’il était en prison à domicile et que son agent de probation pouvait l’appeler à tout moment. Il a été pris, disait-il, pour avoir géré une serre de marijuana. « L’esti de Trudeau a pas eu sa cut », qu’il m’a expliqué. Le gars avec qui il faisait affaire pour la revente s’était fait prendre à vendre des amphétamines dans une école, et la police était remontée jusqu’à ses fournisseurs.
Il y a un tirage pour chasser la biche, et je ne l’ai pas gagné. Les deux autres chasseurs avec moi sur le lot, Nicolas et Fred, ont gagné le tirage, mais ils ont passé la journée à regarder des biches sans tirer. L’abattage du cerf de Virginie fonctionne un peu comme la députation de Québec solidaire, il faut idéalement qu’il soit paritaire : la moitié des permis pour les mâles, l’autre pour les femelles. Le deuxième jour, nous n’étions plus que deux, Fred et moi. Fred conduit toujours sa Subaru à une main en tenant une cigarette électronique dans l’autre. Il avait passé la veille à regarder une vieille biche que j’avais fini par appeler « Suzanne » parce que c’était un bon nom de boomer. On s’était dit qu’on tirerait sur la vieille Suzanne si aucun mâle ne se pointait. Le problème, c’est que Fred commençait à s’attacher. J’avais brisé la règle non écrite qui stipule qu’on ne doit jamais donner un nom à ce qu’on s’apprête à tuer.
Je me souviens, quand je travaillais au CHSLD durant la COVID, qu’une infirmière avait pris soin de me raconter la vie d’une de ses patientes sur le point de mourir. Elle avait un trop-plein à déverser, le traumatisme qu’elle était en train de vivre sans doute, de voir la moitié de son étage mourir d’un coup, mais je ne voulais pas savoir que la patiente avait travaillé dans une maison pour personnes âgées un jour ni qu’elle avait une fille quelque part. La patiente est partie dans un sac le lendemain ou le surlendemain, je ne me souviens plus. La cruauté du monde, c’est que la viande a toujours une histoire.
La biche Suzanne est arrivée le dimanche soir pour aller aux pommes. Fred a hésité, mais j’ai entendu le coup de feu tonner depuis mon champ de maïs. Elle est tombée nette dans ses traces. Fred était un peu sonné par ce qu’il venait de faire, mais il y aurait du cuissot pour Noël. Je lisais cet article d’un architecte qui explique comment l’armée israélienne appuie sa doctrine militaire sur la French Theory 1. Entre autres, un officier expliquait comment les soldats utilisaient les concepts d’espace lisse et d’espace strié développés par Deleuze et Guattari dans Mille plateaux. Une opération comme celle de Gaza consiste, par exemple, à lisser l’espace. Le Airbnb que nous avions loué à Ormstown se trouvait dans ce qu’il serait possible d’appeler un espace lisse : un quartier où on avait pris soin d’enlever chaque arbre. Le voisin d’en arrière possédait un grand manoir de plastique. Espace lisse. C’était visiblement un des rares riches du coin, mais rien de ce qu’il possédait ne semblait valoir quelque chose.
En montant le chevreuil dans la remorque, j’ai levé les yeux vers le ciel pour voir la grosse croix d’argent d’Orion avec Canis Major à son pied. Les étoiles perçaient du haut de leurs millénaires dans la nouvelle lune et j’en oubliais presque le ronronnement constant des séchoirs. Dans le ciel, j’ai vu apparaître une lumière, puis une deuxième, puis cinq, puis dix en file. Starlink d’Elon Musk passait au-dessus de nos têtes, relayant depuis le vide intersidéral les communications creuses de la technocratie globalisée. C’était novembre, toujours une petite fin du monde, comme dans le Chant d’automne de Baudelaire : « Il me semble, bercé par ce choc monotone, / Qu’on cloue en grande hâte un cercueil quelque part ». Nous venions de tuer un être vivant. C’était un moment solennel.
[1] Eyal Weizman, «The Art Of War», Frieze, no 99, mai 2006.
Vaste programme, 4 mars 2025.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte