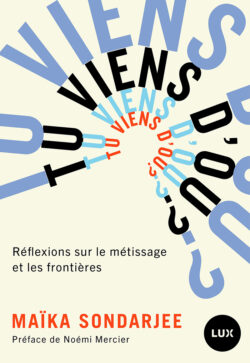Sous-total: $

Métissage et fierté
Maïka Sondarjee a un nom «pure laine» d’étrangère, c’est-à-dire un nom qui fait qu’automatiquement on lui demande d’où elle vient, tout le contraire d’une Tremblay ou d’une Simard ici au Québec.
Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, Maïka aime qu’on lui pose cette question. C’est l’occasion d’affirmer sa fierté et son appartenance indo-malgache. Son père est issu d’une famille malgache d’origine indienne, tandis que sa mère est tout ce qu’il y a de plus québécois (au Québec, le taux des naissances issues de deux parents nés à l’étranger est passé de 7 % en 1980 à 25 % en 2023). Curieusement, sa mère blanche a dû attendre au moins une décennie avant d’être acceptée par la famille malgache de son père installée à Sherbrooke.
Une nouvelle conscience
Rassurez-vous, Maïka n’écrit pas cet ouvrage pour se plaindre ni pour accuser les Québécois de racisme systémique. Non, comme elle le dit, elle se sent à l’aise aussi bien à Madagascar dans le village de son père, ou dans le Gujarat indien, dans le village de ses ancêtres, ou à Ascot Corner, en Estrie où est née sa mère, ou encore dans sa maison, près du parc de la Gatineau.
Elle veut simplement témoigner de ce statut particulier qui est le sien, comme pour des milliers d’autres au Québec, celui de la mixité qui n’a pas vraiment de nom.
«Il n’existe d’ailleurs pas de terme universellement accepté pour décrire la mixité. Ce manque de vocabulaire affecte la façon dont on s’identifie», précise-t-elle.
Pourtant, l’Amérique compte des centaines de milliers de meztisas/meztisos, «un mélange entre Latinos/ Latinas, Autochtones et personnes blanches ou noires ».
Finalement, rien de nouveau sous le soleil : ces migrations répondent à des impératifs économiques. Des gens traversent la frontière de leur mère patrie pour fuir la pauvreté ou les guerres, en quête d’une vie meilleure, d’un chez-soi sécuritaire.
«L’appartenance ne se limite pas au registre de naissance ou à une ligne sur un passeport, explique-t-elle. « Chez soi » représente l’endroit où l’on se sent à l’aise, en sécurité, un lieu qui est familier.»
Bien sûr, notre histoire personnelle, nos origines teintent notre façon d’expliquer le monde, notre récit de vie. Cette mixité, ces migrations donnent lieu à une nouvelle conscience, dit-elle. «Ce qui nous lie n’est pas notre homogénéité, mais nos différences.»
Cette vision peut être questionnable, car une patrie ne peut être une accumulation de différences. Il faut une matrice commune, un ciment qui aide à maintenir l’édifice en construction. Un projet commun de société. Une langue commune dans le cas du Québec. Le contraire serait une société multiculturelle chère à Justin Trudeau. Mais, au bout du compte, conclut Maïka, «nous appartenons tous à la même famille, que nous mangions la tourtière de ma mère ou le poulet au curry de ma tante Soucila».
Fièrement métissés
Maîka rappelle comment, au siècle dernier, en Saskatchewan et en Ontario, le Ku Klux Klan (KKK) est intervenu pour empêcher les unions mixtes. On vota aussi des lois qui interdisaient cette mixité, et ces lois ne visaient pas seulement les Noirs, mais aussi les travailleurs chinois, japonais et philippins. En revanche, les hommes blancs avaient le droit d’épouser des femmes d’origine asiatique. Leur viol demeurait généralement impuni. La Loi sur les Indiens de 1876 est tout aussi discriminatoire pour les femmes autochtones. Si une femme autochtone épouse un homme blanc, elle perd tous ses droits. Elle n’a plus le droit d’habiter dans une réserve et ne peut voir ses enfants nés d’une union précédente. Ce n’est qu’en 1985 que cette loi sera modifiée, mais il y a encore des réserves où elle n’est pas respectée.
Avec Tu viens d’où ? Maîka nous entraîne dans une incursion intimiste chez les métissés. Il en ressort un grand sentiment de fierté, car, nous aussi, Québécois, sommes fièrement métissés. Un seul bémol : elle fait fausse route lorsqu’elle affirme que ses ancêtres français ont volé les terres des autochtones et placé de force leurs enfants dans des familles allochtones, «entraînant ainsi une éventuelle mixité forcée». Cette barbarie appartient au conquérant anglais.
Jacques Lanctôt, Le Journal de Montréal, 9 novembre 2024.
 Mon compte
Mon compte