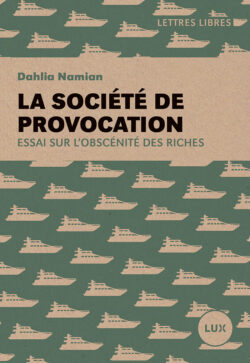Sous-total: $

Trump et Musk au stade suprême de la société de provocation
Souvenez-vous de cette scène : en 2018, Tesla propulsait une voiture électrique dans l’espace depuis Cap Canaveral, en Floride. Une décapotable rouge, coiffée d’un cosmonaute factice surnommé Starman, s’élevait dans le vide sidéral au son de Space Oddity de David Bowie. Elon Musk, p.-d.g. de Tesla, déclarait qu’il « adorait l’idée qu’une voiture dérive à l’infini dans l’espace, pour être découverte, dans des millions d’années, par une race extraterrestre ».
Cette scène loufoque avait trouvé sa place dans l’introduction de mon essai sur « l’obscénité des riches » et la « société de provocation » — un ordre social où une caste de milliardaires, fascinée par la conquête spatiale, pousse à son paroxysme un capitalisme prédateur, quitte à sacrifier une planète en agonie. Ce qui s’apparentait encore, il y a quelques années, à un fantasme excentrique se présente aujourd’hui comme le symptôme d’un empire au bord du gouffre.
Le duo Elon Musk et Donald Trump incarne un monde où l’on en vient presque à espérer l’intervention d’extraterrestres pour nous sauver.
La destruction comme spectacle
Trump et Musk ont été qualifiés de « psychopathes » ou d’« autistes », réduisant leurs actions à des diagnostics psychiatriques. Mais cette psychologisation passe à côté de l’essentiel : ils ne sont pas des anomalies, mais les expressions les plus cohérentes d’un système économique fondé sur l’accumulation prédatrice et l’exaltation de la violence. Ils incarnent le stade suprême de la société de provocation, où la glorification de l’excès et de la haine se déroulent dans un renoncement quasi généralisé, comme si le spectacle de leurs outrances avait anesthésié toute velléité d’opposition.
Walter Benjamin écrivait dans les années 1930 que « l’humanité s’est aliénée au point de pouvoir vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de premier ordre. » Près d’un siècle plus tard, dans une aliénation qu’il avait prophétisée, l’humanité contemple sa disparition comme un spectacle. Obnubilée par une quête de croissance dans un monde aux ressources limitées, elle avance, hypnotisée par sa propre chute.
L’année écoulée fut faste pour les milliardaires : leur fortune a crû trois fois plus vite que l’année précédente. Aujourd’hui, les 5 % les plus riches contrôlent près de 70 % de la richesse mondiale. Même Joe Biden, qui multiplie les déclarations contre les dangers de l’oligarchie, ne peut dissimuler l’implication de sa caste — démocrates comme républicains — dans l’effondrement progressif de la classe moyenne et la désintégration du rêve américain mué en cauchemar.
Derrière les discours impérialistes et les illusions de grandeur, les États-Unis exhibent les stigmates d’une nation rongée de l’intérieur par les inégalités, le racisme, la dépression, l’itinérance, les maladies chroniques, l’incarcération de masse et la chute dramatique de l’espérance de vie. Dans un pays où le fentanyl tue une personne toutes les sept minutes, ce désespoir de masse est le produit d’un système qui sacrifie les plus vulnérables au nom de la préservation des privilèges d’une élite insatiable.
Les élites et leur exutoire numérique
Aujourd’hui, la nouvelle ruée vers l’or s’appelle intelligence artificielle (IA). Étrange écho à la course à l’armement du siècle dernier, cette quête mêle compétition géopolitique, discours ethnonationaliste, avidité capitaliste et foi aveugle dans le progrès technologique. Cette quête a été décrite comme l’ascension d’une nouvelle forme de fascisme, ou, selon Jonathan Durand Folco, d’une révolution « techno-fasciste ».
Or, comme l’a bien noté Chris Hedges, il s’agit moins d’un tournant que l’aboutissement d’un processus commencé il y a des décennies : « La perte des normes démocratiques fondamentales a commencé bien avant Trump, ouvrant la voie à un totalitarisme à l’américaine. » Ce processus s’inscrit dans 40 années de néolibéralisme, une idéologie corrosive qui a sanctifié la croissance, la dérégulation et l’austérité tout en érigeant la surveillance généralisée et le racisme structurel en piliers d’un système conçu pour enrichir les élites au détriment des masses.
Musk, Zuckerberg, Bezos et consorts se présentent comme des prophètes de l’IA, selon l’expression de Thibault Prévost. Pourtant, leur obsession pour la domination numérique ne fait que perpétuer les vieilles dynamiques de pouvoir qui ont marqué les empires coloniaux et militaires. Le dernier rapport d’Oxfam, largement passé inaperçu, affirme que le colonialisme continue de structurer l’économie mondiale, permettant une accumulation obscène de richesses au Nord grâce à l’extraction massive des ressources et à l’exploitation d’une main-d’œuvre bon marché au Sud.
La prétendue transition verte, telle que proposée par l’oligarchie mondiale, ne fait que renforcer cet ordre colonial. Par ailleurs, le retour en force des discours et des partis d’extrême droite légitime ces disparités structurelles tout en détournant l’attention des périls environnementaux et sociaux au profit de visions libertariennes dystopiques.
Vers une rupture radicale
La société de provocation ne se contente pas de nous choquer : elle nous désoriente, favorise la quête de boucs émissaires pour canaliser notre colère et alimente les passions tristes, comme l’angoisse et l’abattement. Pourtant, face à ce sombre tableau, je reste convaincue que nous sommes à un moment charnière. L’heure n’est plus aux réformes cosmétiques ni aux taxes symboliques sur les grandes fortunes. Une transformation radicale s’impose : il faut rompre avec un modèle économique, politique et social fondé sur la croissance infinie.
Là où ce système échoue à répondre aux besoins essentiels, là où il détruit des mondes pour en fabriquer d’autres, artificiels et éphémères, émergent des poches de résistance, porteuses de modes de vie plus justes et plus durables. Comme l’écrivait Stefan Zweig dans Le monde d’hier, même dans les nuits les plus sombres, nous sommes incapables d’imaginer jusqu’où l’humanité peut se montrer redoutable — ni la force immense qu’elle déploie pour affronter les périls et surmonter les épreuves.
Dahlia Namian, Le Devoir, 31 janvier 2024.
Photo: Brandon Bell / Getty Images via Agence France-Presse
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte