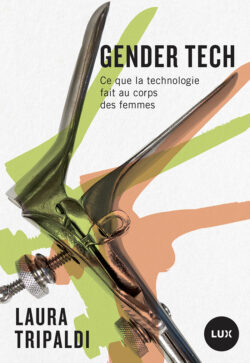Sous-total: $
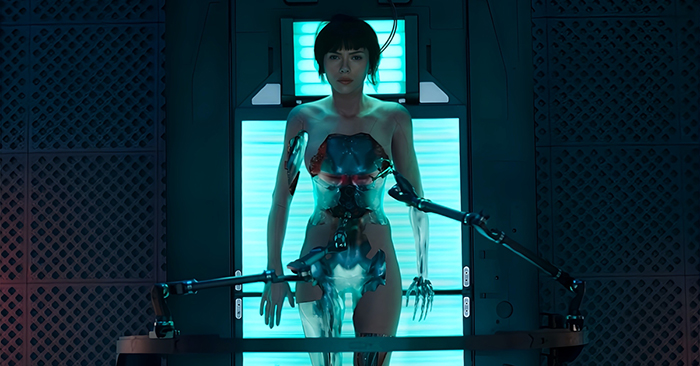
Pilule, spéculum, appli menstruelles… Les « technologies de genre » sont-elles aussi émancipatrices qu’on le pense ?
Dans son dernier essai, la chercheuse italienne Laura Tripaldi relate l’histoire ambivalente des « technologies de genre » qui, bien qu’elles aient contribué à l’émancipation des femmes, portent en elles les traces oppressives du patriarcat. Une histoire dont elle nous livre les grandes lignes dans cet entretien.
Injonctions à la beauté, propagandes anti-avortement, monétisation de nos données reproductives… Dans son essai Gender Tech, traduit aux éditions Lux le 13 septembre dernier, la chercheuse italienne Laura Tripaldi examine en détail la manière dont les « technologies de genre » sont utilisées pour contrôler le corps des femmes.
Persuadée que la technologie a le potentiel de transformer radicalement notre compréhension du genre, Laura Tripaldi appelle à dépasser une vision techno-béate des gender tech afin de mieux saisir leur complexité et imaginer un futur débarrassé des normes sociales qu’elles véhiculent. Entretien.
Usbek & Rica : Dans votre essai, vous soutenez que les « technologies de genre », parmi lesquelles le spéculum, la pilule et l’échographie, sont loin d’être neutres. Ces outils, imprégnés de la culture patriarcale, véhiculent au contraire des préjugés qui encarcanent les femmes. L’histoire de ces instruments médicaux est-elle moins émancipatrice qu’on le pensait ?
Vous dites de la pilule que sa construction pharmacologique et culturelle a fait du corps féminin un artefact, « un dogme culturel avant d’être une donnée biologique ». Comment s’est opéré ce basculement ?
Le corps féminin a toujours été considéré comme quelque chose d’incontrôlable, d’obscur et de sombre. Au XIXe siècle, le corps des femmes était considéré comme un lieu habité par des fantômes. Cet héritage perdure encore aujourd’hui et reste intériorisé par bon nombre d’entre nous. Au-delà de l’individu, ce désir de contrôle se manifeste également en politique, comme en témoignent les campagnes anti-avortement aux États-Unis, en Pologne ou encore en Hongrie, où le corps des femmes est traité comme un élément reproductif qui doit être discipliné de l’extérieur.
Née dans les années 2010 avec l’émergence des applications menstruelles, la femtech cherche à se démarquer des autres technologies en créant des produits « faits par des femmes pour les femmes ». Ces gender tech 2.0 augurent-ils un réel changement dans notre rapport au corps ?
On pense à tort que, parce qu’elles ont été créées par des femmes, ces applications nous permettront de reprendre le pouvoir en toute sécurité sur notre corps. Mais la réalité est plus complexe. On ne peut pas considérer une technologie comme féministe simplement parce que son inventrice est une femme. Beaucoup de ces startups de femtech ne font que reproduire le modèle capitaliste et néolibéral du monde de l’innovation, en exploitant par exemple nos données personnelles pour proposer des publicités ciblées.
Plusieurs enquêtes (notamment du quotidien britannique The Guardian et du groupe de médias Bloomberg, ndlr) révèlent que, pendant l’ovulation, les utilisatrices d’applications de suivi de règles se voient suggérer des articles cosmétiques ou de la lingerie. À l’inverse, pendant la phase prémenstruelle, les publicités se focalisent sur des produits de bien-être ou d’entretien de la maison. D’une certaine manière, ces technologies sont plus subtiles, ce qui les rend aussi plus envahissantes et difficiles à identifier.
Ces femtech sont également les instigatrices d’un nouveau rapport au corps que vous nommez le « wetware ». Quel est ce phénomène ?
Le terme « wetware », popularisé dans la littérature cyberpunk des années 1980, évoque ce lien de plus en plus étroit entre les technologies artificielles et le corps humain. Le corps humain, n’étant plus aux commandes de la technologie, en devient une des composantes. En fin de compte, c’est la technologie qui a recours à notre infrastructure biologique pour fonctionner et non l’inverse.
Cette connexion, qui s’établit tant sur le plan cognitif que physique, risque de faire de nos corps le simple réceptacle de technologies qui exploitent nos données. Dans ce cas, nous ne sommes que des sujets passifs où s’ancrent ces innovations, et non des participants actifs à leur évolution. Cela transforme la technologie en une sorte de parasite.
Toutefois, le « wetware » est aussi une source de bonheur voire de libération pour bien des gens. Les hormones, par exemple, peuvent constituer un outil d’émancipation, en particulier pour les personnes transgenres qui ont recours à un traitement hormonal.
Dans votre ouvrage, vous citez régulièrement deux chercheuses féministes : la philosophe Donna Harway et la théoricienne Zoë Sofoulis. L’une voit dans la figure mythologique du cyborg un moyen de dépasser la dualité oppressive entre nature et culture. L’autre juge les technologies contemporaines responsables de l’aliénation progressive du corps. De quel côté penchez-vous ?
Pour ma part, je m’inscris dans la lignée de Donna Haraway. Je perçois dans la technologie un potentiel immense pour nous affranchir des carcans de la nature. La pensée de Haraway a été pour moi une source de libération. Cependant, j’ai progressivement pris conscience que les technologies ne sont pas seulement des outils de libération, mais qu’elles comportent une complexité bien plus grande.
Il est souvent nécessaire de s’intéresser aux histoires et significations propres de chaque innovation pour comprendre comment en tirer parti d’une manière qui nous soit réellement bénéfique, nous rendant ainsi plus libres et émancipés. D’une certaine manière, j’ai l’impression d’avoir désormais une position plus équilibrée sur ce sujet, notamment en ce qui concerne les technologies de reproduction. Mais au fil des ans, je suis restée convaincue que les technologies de genre jouent un rôle actif dans la définition de nos identités, notamment féminines.
Vous dites, en conclusion de votre essai, préférer la figure de l’ectoplasme à celle du cyborg. Que vous évoque cette image ?
L’ectoplasme est une figure à laquelle je suis souvent revenue durant l’écriture de mon ouvrage. Il symbolise quelque chose d’impossible à contrôler, quelque chose qui échappe continuellement au regard de la science et de la technologie, qui ne peut être complètement compris ou représenté. Bien que la figure de l’ectoplasme génère de la peur, j’ai le sentiment que nous pourrions nous réapproprier cette image pour nous protéger du regard omniprésent de la science et de la technologie.
Quelles nouvelles « technologies de genre » pourraient émerger à l’avenir ?
C’est une question fascinante mais à laquelle il est difficile de répondre de façon tranchée. La technologie dépasse constamment notre compréhension, évoluant à un rythme qui nous échappe et qui surpasse notre capacité à la conceptualiser.
Dans le domaine de la biotechnologie, des processus comme l’ectogenèse ouvrent la voie à un futur – de plus en plus tangible – où l’on pourra dissocier la grossesse du corps féminin. La pilule contraceptive pour les hommes est également en cours de développement et je suis curieuse de savoir quand elle verra le jour, à quoi elle ressemblera et quelles seront ses implications sociales et politiques. On pourrait aussi imaginer la conception d’une pilule unisexe… Ce n’est pas impossible d’un point de vue technologique.
La meilleure chose que nous puissions faire à l’avenir est de créer un environnement propice au développement de ces technologies, loin des contraintes patriarcales et capitalistes qui projettent sur elles des visions oppressives.
Emilie Echaroux, Uzbek & Rica, 7 octobre 2024
Photo: Scène du film ‘Ghost in the Shell’ de Rupert Sanders © Paramount Pictures
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte