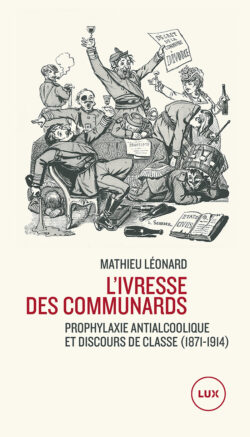Sous-total: $

Soiffards, les communards?
Le mouvement ouvrier et la picole
Avec la légende des pétroleuses incendiaires, celle des communards alcoolos a été un grand standard de la propagande réactionnaire après la révolution de 1871. Comme le montre l’historien vigneron (et compagnon de route de CQFD) Mathieu Léonard dans son dernier bouquin, L’Ivresse des communards (Lux, mars 2022), ce discours s’ancre dans un climat hygiéniste qui dépasse largement le contexte de la Commune. La lutte antialcoolique traverse ainsi toute l’histoire du mouvement ouvrier. Entretien.
Pendant et après la Commune, la propagande réactionnaire décrit les communards comme un ramassis de pochetrons. C’est une réalité ?
« Le photographe Nadar, témoin des événements de 1871, qualifiait de “légende intéressée” le mythe d’une Commune sous l’emprise de l’alcool. Certes, on peut sans doute documenter les consommations de vin et d’eau-de-vie par les gardes nationaux dès le siège de l’hiver 1870, les pillages de cave occasionnels ou encore les états de delirium tremens de certains fédérés lors de la Semaine sanglante (21-28 mai 1871). Mais ces effets de loupe ne nous apprennent rien sur la Commune. Les poncifs qui présentent les communards “ivres de vin et de sang” servent le discours versaillais et bourgeois et, d’une manière générale, le registre contre-révolutionnaire. Il s’agit d’avilir une population insurgée affamée, que d’odieux chefs révolutionnaires auraient maintenue dans une ivresse permanente pour prendre les rênes du pouvoir. 150 ans plus tard, personne ne défend plus cette thèse. J’ai voulu néanmoins remonter le fil de la légende et saisir ses usages politiques et prophylactiques au-delà de l’événement même. »
Tu montres comment ce discours antialcoolique se greffe à une idéologie hygiéniste et se charge d’un discours politique…
« Le discours hygiéniste s’inscrit dans un siècle hanté par les épidémies (variole, typhus, syphilis, choléra) et par un mythe fondateur : celui de la dégénérescence, la somme des tares qui se transmettent et menacent toute l’espèce. Les problèmes politiques et sociaux sont perçus comme autant de menaces de contagion. Et ça vaut pour l’alcoolisme comme pour les idées révolutionnaires, les “déviances sexuelles” ou les maladies mentales. Ainsi s’opère la tentation de passer de l’étiologie [l’étude des causes des maladies] à la biopolitique, autrement dit à un pouvoir sanitaire au service du capitalisme libéral. La prophylaxie antialcoolique qui suit la Commune imagine qu’on résoudra la question sociale par l’abstinence et l’épargne… sans bien sûr toucher à la propriété capitaliste ni à l’exploitation. Avant tout, il s’agit de régénérer la nation après une coûteuse défaite contre la Prusse et une guerre civile. »
Jusqu’au XXe siècle, les cafés sont un important lieu de socialisation ouvrière. Quel rôle jouent-ils pour le mouvement ouvrier ?
« C’est le lieu de sociabilisation par excellence, car avant la création de lieux d’entre-soi ouvrier comme les bourses de travail, il n’en existe pas d’autres ! Il faut aussi garder en mémoire que l’habitat ouvrier est souvent insalubre, exigu, surpeuplé. Le cabaret offre à l’ouvrier – masculin, faut-il le préciser –, une respiration et une distraction. Balzac en parlait déjà comme le “parlement du peuple”. Mais le discours hygiéniste le désigne comme le lieu de tous les vices et toutes les contagions : “La tuberculose s’attrape au comptoir”, dit-on. La IIIe République est l’âge d’or des cafés (on en compte 1 pour 80 habitants vers 1914). Certains discours républicains ménagent la profession, non sans arrière-pensées électoralistes : “Lorsqu’on décrie cette profession, on fait le procès même de la démocratie laborieuse”, s’exclame Gambetta, alors président de la Chambre des députés, dans un discours au banquet du syndicat des marchands de vin de la Seine.
Mais au sein du mouvement ouvrier, le rôle du bistrot est peu à peu décrié. La fréquentation des cabarets nuit non seulement au bien-être ouvrier, mais aussi à l’organisation de classe. Dans leur livre Marchands de folie (1913), les frères Bonneff dépeignent ainsi la dépendance des ouvriers à leur créancier-marchand de vin et dénoncent l’hypocrisie des pouvoirs publics qui n’osent pas combattre l’industrie des alcooliers. »
Des penseurs socialistes dénoncent très tôt l’effet anesthésiant de l’alcool sur les ouvriers, qu’il empêcherait de s’engager dans les luttes. Pourtant, le mouvement socialiste peine longtemps à s’emparer de cette question…
« Le discours socialiste a rarement fait l’apologie de l’alcoolisme, mais on y voit d’abord une compensation face à la dureté de la condition prolétaire, notamment dans certains secteurs particulièrement pénibles (docks, bâtiment, métallurgie) où les journées dépassent les 12 heures. Le petit blanc du matin n’a-t-il pas pour nom “la consolante” ? Il faut croire que la croisade contre l’alcoolisme, ce “mal qui ronge la nation”, est devenue tellement hégémonique à la fin du XIXe siècle que tous se rallient à la raison hygiéniste. Personne n’ose défendre publiquement la dimension de plaisir de la boisson… exception faite du vin, véritable fétiche national. C’est aussi l’ère des produits falsifiés, à commencer par les boissons servies au prolo : vin trafiqué, tord-boyau toxique et absinthe frelatée. un empoisonnement industriel qui indigne l’anarcho-syndicaliste Émile Pouget dans [son journal] Le Père peinard : “Il faudrait, nom de dieu, de la bonne boustifaille, du bon picolo, pour nous refaire du sang. Mais pour bouffer quelque chose de naturel, il faut être à la campluche ; dans les villes y a plus moyen.”
Pourtant, les syndicats et les partis socialistes n’ont pas vocation à remplacer les ligues de tempérance. En attendant le Grand soir, l’objectif de la lutte des classes est de rogner l’emprise du capital sur le travail : par l’augmentation des salaires, la diminution du temps de travail et l’extension des services sociaux. Les luttes syndicales pour le repos hebdomadaire (1906) et pour la journée de huit heures intègrent le principe que les cadences infernales poussent à l’alcoolisme et rendent la famille malheureuse. Mais ce n’est pas un objet de négociation ou programmatique en soi. »
Début XXe, on voit apparaître un ouvriérisme antialcoolique ainsi qu’une prise en compte du « problème » chez les anarchistes, les individualistes en particulier. Quelle influence exerceront-ils sur le mouvement ouvrier ?
« Il existe des mouvements antialcooliques ouvriers, cooptés par des médecins bourgeois comme le docteur Paul-Maurice Legrain, figure majeure de la lutte pour l’abstinence, qui soutiendra toutes les initiatives ouvrières et anarchistes contre l’alcoolisme. Cet antialcoolisme ouvrier spécifique se fait avaler dans une forme d’union nationale par la Ligue nationale contre l’alcoolisme au moment de la Première Guerre mondiale.
Le purisme du discours anarchiste sur l’alcool, considéré comme un instrument de soumission, est quant à lui un cas intriguant. Certes, à la base, on comprend la logique de faire feu de tout bois contre cette société bourgeoise honnie, source des inégalités les plus haïssables, et de voir derrière l’alcool “la main du maître”. Chez les naturiens, le rejet de la société industrielle inclut l’alcool. Les anarchistes individualistes vomissent les deux malédictions d’une classe ouvrière soumise : le vote et l’alcoolisme. Pour eux, “le règne de la IIIe République, c’est le règne du poivrot !” Plutôt que de réclamer des mesures sanitaires interventionnistes, ces milieux anarchistes prônent l’éducation et la reconquête de son propre corps par une forme d’autodéfense hygiénique vitaliste.
Incontestablement, le désir de régénération emprunte au scientisme des théories de la dégénérescence, avec le cas troublant des néomalthusiens qui, en plus de défendre la procréation choisie et la contraception, vont aussi alimenter un certain eugénisme. Bien entendu, il ne s’agit pas de confondre les discours réactionnaires ou darwinistes sociaux, qui reposent sur la hiérarchie et la sélection sociale avec les idées anarchistes qui, à l’inverse, recherchent l’horizontalité et l’entraide. Toutefois on peut s’interroger sur la porosité d’un certain déterminisme biologique sur les idées de cette époque. »
Propos recueillis par Laurent Perez, CQFD, no 7, mars 2022
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte