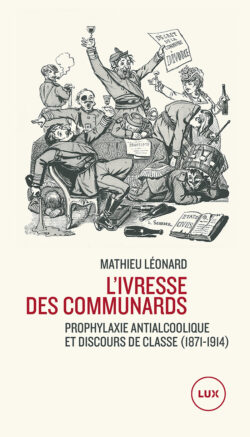Sous-total: $

«L’ivresse» des communards: archéologie d’un mythe vivace
Plus de 150 ans après la Commune, sa « légende alcoolique » perdure. Quelle est la réalité de cette supposée alcoolisation des communards et, plus largement, des ouvriers révolutionnaires au XIXe ? Entretien avec Mathieu Léonard, auteur de L’Ivresse des Communards, qui livre une minutieuse archéologie de ce mythe.
RetroNews : Au cours du « siècle imbibé » qu’est le XIXe, l’alcoolisation des Français, et en particulier de ceux issus des classes populaires, est dénoncée comme un fléau social. Quelle est la réalité de cette consommation d’alcool ?
Mathieu Léonard : Les statistiques publiées par la ligue nationale contre l’alcoolisme dans sa revue L’Étoile bleue (février 1909) montrent que la consommation d’alcool pur (vin excepté) par habitant et par an a plus que doublé entre 1850 et 1910. Quant à la consommation de vin par habitant, elle passe de 140 litres par adulte entre 1830-1839, à 222 litres entre 1870-1879 et 208 litres entre 1900-1913, après la fin de la crise du phylloxéra.
Au tournant du siècle, la problématique alcoolique est devenue transpartisane et transclassiste. L’écrivain anarchiste Georges Darien écrit ironiquement dans La Belle France en 1900 : « L’alcoolisme aussi est une réforme, et une belle ; car, ainsi que le disait récemment un ministre, il donne au travailleur l’illusion des forces dont il a besoin. Comme, sur trente-sept millions de Français, il y a au moins quatre millions d’alcooliques, on peut dire que les travailleurs ont beaucoup d’illusions, dans la Belle France. » On ne sait pas exactement ce que définit ici un alcoolique : si cela se rattache à des pathologies particulières ou à la simple consommation quotidienne de vin. À titre de comparaison, les chiffres récents de la Santé publique considèrent qu’en moyenne 10 % des adultes consomment quotidiennement de l’alcool, ce qui n’est pas très éloigné du rapport que fait Darien. Concernant le diagnostic plus précis d’abus ou de dépendance à l’alcool, il concernait 4,3% de la population française âgée de 18 ans et plus (7,3 % des hommes et 1,5 % des femmes).
Il va de soi que l’on boit dans toutes les classes, même si les budgets – et par conséquent la qualité des vin et des alcools – sont différents. Aux bourgeois, les grands crus et les spiritueux correctement rectifiés ; aux classes moyennes les apéritifs industriels ; aux classes populaires, le « bleu » (vin médiocre trafiqué au sel de plomb), les « tords-boyaux », « casse-pattes » et autres alcools frelatés. On retrouve une tentative de classification selon les types d’alcools consommés chez le psychiatre Legrand du Saulle, reprise dans La Vie ouvrière en France (1900) par les frères Pelloutier : « consommateurs de vin blanc (femmes, cochers, chiffonniers), consommateurs d’absinthe (artistes déclassés, irréguliers de la Bourse, de la presse et des théâtres, poètes incompris, etc.), consommateurs de vin rouge (la masse des travailleurs) ». L’industrialisation des alcools fait que les usages circulent parfois entre les classes. À la fin du XIXe siècle, un médecin hygiéniste observe l’invasion de l’apéritif dans toute la société, notant que l’ouvrier et le paysan ont voulu « imiter la classe bourgeoise, le commerçant, le commis voyageur, l’employé qui, eux-mêmes, avaient imité l’officier » (Raoul Brunon, « L’alcoolisme ouvrier en Normandie », Revue d’hygiène et de police sanitaire, 1899). En effet, à partir de 1875, la saturation publicitaire des marques de spiritueux entraîne toutes sortes de catégories sociales vers l’apéritisme et l’absinthisme.
Mais l’attention des hygiénistes, qui se doublent de moralistes et de réformateurs sociaux, se focalise depuis longtemps sur les classes populaires, désignées comme potentiellement « dangereuses et vicieuses » par Honoré Frégier, chef de bureau à la préfecture de la Seine (Honoré Frégier, Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures, 1840.)
L’alcoolisme ouvrier est stigmatisé car en plus de dévier l’ouvrier de ses responsabilités familiales et du sens de l’épargne, il peut être aussi facteur de désordres sociaux. L’ordre bourgeois insiste sur les vices de l’ouvrier plutôt que sur ses vertus. Il s’agit de moraliser, discipliner la classe ouvrière et la détourner de la « noce éternelle » (Victor Hugo), sans pour autant remettre en cause les fondements de l’exploitation économique. Le cabaret, distraction quasi-exclusive de l’ouvrier, où l’on dépense jusqu’à la moitié de son salaire, a remplacé l’Église, se lamente-t-on. Mais, c’est avant tout un lieu de plaisir, d’échange, où l’on peut jouer au billard, lire le journal, etc., pas forcément un lieu de débauche alcoolique, d’autant qu’il fait l’objet d’une surveillance particulière. Mais sous l’influence des clichés de l’époque, repris par Zola dans L’Assommoir notamment, le café devient dans l’imaginaire de l’époque le lieu privilégié de la déchéance ouvrière.
Il est évident que l’alcool joue un rôle de consolation pour les classes exploitées. On donnait d’ailleurs le nom de « consolante » au petit blanc sec avalé le matin avant de sacrifier sa journée à un rude labeur. Bien entendu, une étude plus approfondie permet d’apporter quelques nuances à un tableau trop monochrome de la griserie prolétaire. Les professions les plus dures où les corps-machines ont besoin d’être stimulés sont plus sujettes à l’alcoolisation quotidienne que d’autres, qui sont réputées plus sobres.
En décembre 1871, l’Académie de médecine qualifiait l’insurrection de « monstrueux accès d’alcoolisme aigu ». Que sait-on aujourd’hui de la consommation réelle d’alcool pendant la Commune – et de ses effets ?
Les intenses mouvements de population compliquent la mesure précise de la consommation d’alcool durant le Siège de 1870 et de la Commune de la Paris. Les 254 bataillons de la garde nationale rassemblent environ 300 000 hommes en septembre 1870, mais par la suite, ils connaîtront de nombreuses désertions et beaucoup de Parisiens quittent la ville durant le siège et après l’insurrection. L’économiste Armand Husson, chef de division de la Préfecture de la Seine, rend compte des consommations de la capitale de manière détaillée : pour le vin, on aurait consommé 3 millions d’hectolitres en 1870-1871, contre 3,6 millions en 1868-1869 et 3,9 millions en 1872-1873. Même tendance à la baisse pour la bière, qui provient en grande partie d’Alsace et des pays germaniques. En revanche, l’eau-de-vie est quantifiée à la hausse : 17,24 litres par an et par habitant pour 1870-1871, contre 14,83 litres pour la période 1866-1869 et 9 litres pour 1872-1873 (Armand Husson, Les Consommations de Paris, 1875). L’usage militaire de l’eau-de-vie contenu dans les petits tonneaux des cantinières pourrait expliquer cette inflation.
Lors d’une séance de l’assemblée nationale du janvier 1872 qui examine la proposition d’une loi réprimant l’ivresse, le député de l’Oise Albert Desjardins avance que durant les cinq mois de siège et de Commune la consommation d’alcool « s’est élevée au chiffre qui suffit ordinairement pour une année », un chiffre repris ensuite par l’écrivain Maxime Du Camp. De fait, avant même le déclenchement de l’insurrection, les autorités de Versailles s’inquiètent de mauvaises habitudes de « l’oisiveté et la vie de bivouac [qui amènent] l’ivrognerie » (Martial Delpit, Le Dix-huit mars. Récit des faits et recherche des causes de l’insurrection, rapport fait à l’Assemblée nationale au nom de la commission d’enquête sur le 18 mars 1871, 1872.) Un historien de Paris, Louis Lazare estime à 25 000 le nombre de débits de boisson légaux et clandestins durant la Commune. En novembre 1870, il en a lui-même recensé 147 entre Filles-du Calvaire et Ménilmontant. Pourtant ces chiffres ne révèlent pas grand-chose sur la consommation réelle des fédérés. Si l’on peut penser que durant la Semaine sanglante, l’alcool a effectivement joué un rôle d’anesthésiant face au massacre annoncé, il y a assez peu d’élément pour affirmer que l’ivrognerie a été extraordinaire sur la durée.
En 1902, la question est encore débattue dans le courrier des lecteurs de La Chronique médicale, « revue bimensuelle de médecine historique, littéraire et anecdotique », entre plusieurs médecins, témoins des événements et l’écrivain Lucien Descaves. Les échanges offrent d’ailleurs un panel représentatif des opinions et des impressions sur le moment. Descaves estime que « la Commune sous l’empire de l’alcoolisme est une légende intéressée, comme celle des repris de justice qui, au dire de Thiers, Jules Favre et tutti quanti, composaient en grande partie l’armée fédérée » (Chronique médicale, 9e année, n° 3, 1er février 1902). Le Dr Michaut, vieux Parisien qui s’est rangé du côté de la Commune à l’époque, va jusqu’à affirmer que « jamais on ne vit moins de scènes d’ivrognerie publique » que sous la Commune, accréditant l’idée d’une « révolution morale » selon les termes de l’historien Jacques Rougerie. (« L’alcoolisme pendant la Commune », Chronique médicale, 5 mars 1902). Bref, considérant la fréquence des épisodes alcooliques sous la Commune, tout dépend où se porte le regard et du regard qu’on porte.
Reste que le pouvoir communaliste n’a jamais entretenu une quelconque mansuétude envers l’ivrognerie ou les pillages de cave, elle a même plutôt tenté d’en limiter la contagion par plusieurs décrets municipaux répressifs. Dans cette période, un des seuls témoignages un peu complaisant sur l’alcool est un article du journal Le Père Duchesne, daté du 20 avril, qui incite avec truculence les « braves sans-culottes » à faire main basse sur les grands crus du cellier impérial au Palais des Tuileries. Maxime Vuillaume reconnaîtra dans ses souvenirs que le journal avait « brodé », et que pour ne pas perdre la face vis-à-vis des fédérés, il avait fait porter à ses frais un panier de vin de choix au siège de plusieurs bataillons (M. Vuillaume, Mes cahiers rouges au temps de la Commune, 1910).
Comment s’est créée puis diffusée la « légende alcoolique » de la Commune ?
La presse joue un rôle de premier plan dans la diffusion de cette représentation mal intentionnée. Le 24 mars 1871, un article du Courrier du Havre intitulé « Ivres de vin et de sang » prétend avoir trouvé la véritable cause du basculement :
« Ils sont misérables, criminels, infâmes, ces hommes sans nom qui promènent dans Paris, depuis une semaine, le meurtre, l’assassinat, la terreur. Mais ils ne sont tout cela que parce qu’ils sont ivres : ivres du matin au soir et du soir au matin. »
La petite musique peut se diffuser pour dénigrer les insurgés et le pouvoir communaliste. Aussi, immédiatement après la Semaine sanglante, Le Figaro du 1er juin, réclame une loi réprimant l’ivresse publique en ces termes :
« Si cette loi que nous demandons eût existé il y a quelques mois, nous n’eussions pas subi la honte de voir siéger à la Chambre une collection d’hommes qui tenaient leurs mandats de tous les pochards de la capitale, et qui nous ont conduits tout droit à la Commune. »
La déposition extravagante du général Cremer, dépeignant les orgies de la Commune à l’Hôtel-de-ville devant la commission d’enquête parlementaire sur les causes de l’insurrection, va sans doute contribuer à alimenter la légende. L’historien de la Commune, Edmond Lepelletier, défera une à une les affabulations de Cremer, général en disgrâce qui espère par le zèle de sa délation réintégrer son grade dans l’armée régulière :
« Qu’il y ait eu, dans les compagnies, des gardes ayant bu un coup de trop, c’est probable et même certain. L’inaction durant le siège, la privation d’aliments et le désir de soutenir leurs forces et leurs nerfs avec le vin, qui n’a jamais fait défaut, avaient développé des penchants à l’alcoolisme, malheureusement trop fréquents, mais ce n’étaient là que des tares accidentelles et des désordres restreints. »
Aussi dans toute la littérature anticommunarde qui va proliférer dans les mois et les années suivantes, le cliché de l’ivrogne vient en renfort à celui de la pétroleuse, comme un lieu commun disqualifiant. En témoigne ce passage des souvenirs de la comtesse Pia de Saint-Henri visitant les prisons de Versailles :
« Rien n’égale l’expression abrutie de ces ivrognes sanguinaires. Maintenant que les vapeurs de l’ivresse se sont dissipées, leurs physionomies montrent une telle dégradation, un hébétement si complet, que l’on se demande si ce sont là des êtres raisonnables. Les femmes ne manquent pas dans leurs rangs. Elles soulèvent encore davantage le cœur de dégoût et d’aversion. » (Comtesse Pia de Saint-Henri, Souvenirs du régime communard à Paris, 1871.)
Bref, il n’a pas manqué de calomniateurs pour répandre cette « légende intéressée », à travers des pamphlets obscurs ou les écrits d’écrivains réputés, tels Maxime Du Camp et Zola. Globalement, il s’agissait de montrer les excès de la Commune comme le résultat d’une « folie morale » poussée à son paroxysme par l’alcool et d’écarter toute explication politique à l’événement.
C’est ce que résume l’historienne Susanna Barrows dans son étude pionnière « After the Commune: Alcoholism, Temperance, and Literature in the Early Third Republic » : « En assimilant la révolution à l’alcoolisme, les partisans de Thiers pouvaient contourner entièrement toute discussion embarrassante sur les causes sociales et économiques qui avaient déclenché la révolte, et renvoyer l’objectif de justice sociale des communards à des hallucinations sauvages de dipsomanes. Le bain de sang final pouvait être ainsi justifié comme une indispensable œuvre nationale de salubrité publique. »
Dans quelle mesure certains médecins ont-ils contribué à la « pathologisation des communards » ? Quelles théories, quels arguments scientifiques utilisent-ils à l’appui de leur thèse ?
L’imprégnation de certains discours médicaux dans la réfutation de la Commune est de plusieurs ordres selon moi. Il s’exprime dans les revues médicales après la Commune à la fois sous forme de témoignages subjectifs et de rapports d’évaluation clinique sur les blessés et les morts au combat. Tel chirurgien affirme que tous les blessés fédérés qu’il recueille étaient « dans un état d’ivresse aiguë, et la plupart n’ont pas hésité à nous avouer leurs habitudes alcooliques invétérées » (Paul Redard, « L’abaissement de la température dans les grands traumatismes par armes à feu », Archives générales de médecine, vol. 1, 6e série, t. 19, 1872, p. 29-60.) En dépit de ce regard qui se veut celui du physiologiste, on peut s’interroger sur la part de parti-pris. Durant une décennie, il y a peu de personnes pour opposer un contre-discours à ces points de vue exclusivement à charge. S’il a existé des médecins engagés du côté de la Commune, la plupart aspiraient au retour de l’ordre et ont réprouvé les incendies et les exécutions d’otages sans y trouver d’autres explications que celles de la folie morale et de l’alcoolisme. « Pour l’honneur de l’humanité, j’aime encore mieux attribuer ces assassinats à l’alcoolisme qu’à des actes commis de sang-froid », affirme encore en 1902, le Dr Malhéné dans la revue La Chronique médicale (9e année, n° 10, 15 mai 1902).
D’autre part, la lecture psychiatrique de l’événement reprend des classifications des aliénistes les plus vus (Augustin Morel, Moreau de Tours, Brierre de Boismont) qui analysaient déjà l’insurrection de juin 1848 en termes de « maladie démocratique » recouvrant « le champ entier de la déviance mentale, permettant d’inclure l’ensemble du personnel émeutier dans le quadrillage nosologique », comme le souligne l’historien Emmanuel Fureix. Les diagnostics du Dr Laborde (Les Hommes et les actes de l’insurrection de Paris devant la psychologie morbide, 1872), qui sera un fer de lance avec le Dr Magnan de la lutte contre l’absinthe, calquent sur la Commune cette grille préétablie, mélange de théories de médecine mentale qui habillent de manière savante une idéologie réactionnaire structurée par sa position de classe. En gros, les hommes de la Commune sont atteints d’une hérédité morbide qui les poussent à une « folie collective ».
Enfin, plusieurs membres éminents de l’Académie de médecine vont trouver dans la dénonciation de la Commune et « le mauvais spectacle de l’ivresse », selon l’historien Damien Gros, l’occasion opportune d’une avancée législative dans la croisade contre l’alcoolisme. Le 29 décembre 1871, les bases de la Société française de tempérance, sont jetées lors d’une réunion au domicile du Dr Barth, médecin personnel d’Adolphe Thiers. Ainsi les travaux initiés par le Dr Bergeron qui présente la Commune comme un « monstrueux accès d’alcoolisme aigu » aboutiront à l’adoption de la loi sur l’ivresse publique du 29 janvier 1873, portée par le député de Lozère, le Dr Théophile Roussel.
Comment le terme dégénérescence a-t-il glissé du lexique médical à celui de l’homme politique puis de l’homme de la rue ? Quelles peurs cela reflète-t-il ?
Là encore, la diffusion du mythe de la dégénérescence au XIXe siècle n’a pas manqué d’occuper les travaux historiques – on peut citer, entre autres, l’ouvrage d’Anne Carol sur l’histoire de l’eugénisme en France ou le livre récent du psychiatre Jacques Hochmann. Malgré cela, on peut se demander si nous mesurons suffisamment son influence sur les milieux scientifiques des XIXe-XXe siècles et les sociétés occidentales dans leur ensemble. Selon moi, le glissement est constitutif même de cette théorie « buvard » (Jean-Jacques Yvotel), qui veut expliquer tous les problèmes sociaux, en premier lieu la ruine de l’espèce, par la transmission des tares dans la descendance et conduit à classifier les indésirables, les révoltés, les hystériques, les anormaux, les déviants pour mieux les isoler.
Le Dr Lucas écrit en 1850 dans son Traité de l’hérédité naturelle : « L’hérédité de nature devient la raison primordiale et la source réelle de l’hérédité d’institution. » En quelque sorte, après la mise à mal des fondements politiques de l’hérédité (monarchique et aristocratique) par la Révolution française qui proclame l’égalité des droits, la biologie offre une revanche idéologique aux théories inégalitaires. L’aliéniste et à sa suite le criminologue, le darwiniste social, l’eugéniste, mais aussi le littérateur, offrent au politique la possibilité de légitimer les hiérarchies sociales, voire raciales, comme des principes civilisationnels opposés à la hantise de l’ensauvagement et du collectivisme. La théorie de la dégénérescence vient en renfort à l’explication de la défaite face à la Prusse, de la guerre civile, de la dénatalité, bref de la décadence du pays. Avec sa saga des Rougon-Macquart, où plusieurs personnages sont frappés d’hérédité morbide, Zola offre l’exemple classique de la vulgarisation et la dramatisation de la théorie de la dégénérescence dans la littérature.
L’exemple de la lutte contre l’alcoolisme montre comment une fois celui-ci défini par les savants et l’Académie de médecine comme « fléau social » et cause majeure de la dégénérescence, cette problématique s’est diffusée et imposée à toute la société de l’époque.
Jusqu’à quand perdurera cette forme d’antialcoolisme vis-à-vis de la population ouvrière ? Comment sera-t-il nourri ?
Dans la troisième partie de mon livre, j’ai voulu suivre l’influence de cette prophylaxie antialcoolique au sein du mouvement ouvrier à la fin du XIXe siècle. Certains milieux français internationalistes n’ont pas attendu le discours médical pour adopter des mœurs tempérantes. Dans ses mémoires, le géographe russe Kropotkine se souvient de l’impression de droiture que lui renvoyaient les communards réfugiés en Suisse :
« Je fus également frappé de l’influence moralisante exercée par l’Internationale. La plupart des internationalistes parisiens s’abstenaient presque complètement de boire et tous avaient renoncé à fumer. “Pourquoi nourrir en moi cette faiblesse ?” disaient-ils. La vulgarité, la trivialité disparaissaient pour faire place à des aspirations nobles et élevées. » (Pierre Kropotkine, Autour d’une vie, Paris, Stock, 1902).
Mais il faut attendre le second élan de la croisade antialcoolique à partir de 1895, pour voir se développer un discours ouvrier spécifique sur l’alcool. Avec la IIIe République, l’hygiénisme se républicanise en même temps que la question sociale s’hygiénise. Les militants ouvriers commencent à considérer les mœurs alcooliques comme des facteurs d’aliénation et des freins au combat social. La question est discutée au Congrès de la CGT à Rennes en 1898. Le belge Émile Vandervelde est un des premiers à énoncer un objectif d’abstinence totale dans les rangs socialistes (Émile Vandervelde, Essais socialistes. L’alcoolisme, la religion, l’art, 1906). Les enquêtes sociales des frères Bonneff mettent en cause le rôle des cabarets, à la fois bureau d’embauche et société de crédit, dans l’exploitation des ouvriers. L’alcool en soi est un moyen de gouvernement et de résignation : « En tout buveur sommeille un jaune qui s’ignore », écrivent-ils dans Le Réveil, janvier 1912. Ainsi émerge un antialcoolisme ouvrier spécifique, libertaire et néomalthusien, qui ne cache ses nombreux emprunts aux travaux du Dr Legrain, l’âme du combat pour l’abstinence et théoricien de la « dégénérescence alcoolique ».
Ainsi à la veille de la Première Guerre Mondiale, on voit le journal de Fédération ouvrière antialcoolique, Le Réveil du peuple, reprendre la devise prolétarienne : « L’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes », en y accolant le commandement abstème : « Au nom de l’humanité future, tu ne boiras pas d’alcool ». Une partie de cet antialcoolisme ouvrier, mené par Gustave Cauvin, va être absorbée par la Ligue Nationale contre l’alcoolisme dans une stratégie d’union sacrée interclassiste.
Un antialcoolisme ouvrier anarchiste, plus résiduel, va conserver sa virulence à dénoncer à la fois les lobbys alcooliers (fabricants de spiritueux ou marchands de vin), le militarisme « école de l’alcoolisme », et l’hypocrisie des républicains bourgeois qui auraient tout intérêt à perpétuer les habitudes d’ivrognerie des prolétaires : « Généralement l’alcoolique est un parfait citoyen, un automate entre les mains de l’autorité. Il est doux et rampant devant ses maîtres et brutal et autoritaire envers sa femme et ses enfants. Que lui importe que ceux-ci n’aient rien à se mettre sous la dent pourvu qu’il ait, lui, son petit verre le matin, ses trois absinthes avant ses repas et son café après chaque repas. Nul métier ne lui répugne : policier, soudard, mouchard, tout lui est bon. Il s’est bien fondé un peu partout des Ligues “antialcooliques” mais leur effet a été absolument nul. Ceux qui les composent sont, d’ailleurs, de bons bourgeois qui ont tout intérêt à ce que les prolétaires s’alcoolisent. » (« L’Alcoolisme », Alfred Loriot. in Le Libertaire, n°46, 1907).
Après la Première Guerre mondiale, ce sont encore des plumes anarchistes, qui dénonceront le degré d’abêtissement dans lequel serait tombé le peuple français :
« Par les larges distributions de vin et d’eau-de-vie aux martyrs des tranchées de guerre, la déchéance s’accrut dans une proportion formidable et pèse à l’heure actuelle sur les enfants conçus dans cette période de collective folie toxique. Les maîtres des écoles primaires s’accordent unanimement à reconnaître un abaissement considérable du niveau intellectuel de leurs élèves, dont les facultés de compréhension et d’assimilation sont bien moindres qu’avant-guerre. » (« Alcoolisme », Dr F. Elousu, Encyclopédie anarchiste, La Librairie internationale, 1925-1934 (tome 1, p. 35-47).
D’une certaine façon, la propagande antialcoolique s’était diffusée dans tous les camps avec des arguments propres à chacun, mais toujours sous l’influence plus ou moins marquée de la « dégénérescence alcoolique ».
Mathieu Léonard et Marina Bellot, RetroNews, 22 février 2022.
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte