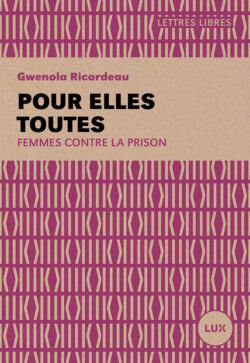Sous-total: $
Recension de «Pour elles toutes»
Pour elles toutes est, comme son titre l’indique, résolument féministe tout en proposant une avenue peu explorée dans une grande majorité de cercles féministes : l’abolition de la prison. C’est à partir de son expérience comme proche d’une personne incarcérée et de son engagement militant tout autant que de sa posture de sociologue que Gwenola Ricordeau s’adresse à son lectorat. Elle propose un outil pédagogique accessible à un large public tout en ne sacrifiant pas l’aspect scientifique de son travail. Elle ne prétend pas pour autant faire le tour complet de ce sujet complexe qu’est l’abolitionnisme et ses notes de bas de page détaillées ainsi que sa bibliographie bien fournie guident vers des lectures complémentaires. Sa démarche intellectuelle se fait également dans le respect et la solidarité envers les femmes – victimes, accusées et proches de personnes incarcérées – qu’elle place là où elles ont rarement été : au coeur des enjeux de l’abolitionnisme. Par son essai, Ricordeau réconcilie abolitionnisme pénal et féminisme en démontrant comment le système pénal dans son ensemble (et pas seulement la prison) ne répond pas aux besoins des femmes, quelle que soit leur position dans ce système. Tout au long du texte, Ricordeau porte une attention particulière aux situations vécues par les femmes racisées et les femmes trans. Une autre originalité de Pour elles toutes : l’ouvrage a été écrit aux États-Unis en français puis publié au Québec, et il offre des données et exemples provenant de la France, du Canada et des États-Unis – ce dernier pays ayant connu depuis une quinzaine d’années un regain d’intérêt pour les études carcérales et pour l’abolition, de même qu’une remise en question du phénomène d’incarcération de masse. Malheureusement, le court format de l’essai limite l’approfondissement de certaines idées, ce que le prochain ouvrage de Ricordeau (Crimes et peines. Penser l’abolitionnisme pénal, Caen : Éditions Grevis, 2021), propose de faire.
Pour elles toutes est composé de six chapitres qui répondent à des questions récurrentes sur l’abolitionnisme pénal et aux arguments de ses détracteur·trice·s, et démontrent les contradictions du système pénal contemporain. Dans le premier chapitre, Ricordeau expose les grands principes qui régissent le système pénal ainsi que ses écueils, par exemple le fait qu’il « capture » souvent des personnes déjà marginalisées. Elle y présente brièvement les concepts clés de l’abolitionnisme, ses courants ainsi que quelques-unes de ses figures marquantes dont la Canadienne d’adoption Ruth Morris. Elle fait valoir que l’abolitionnisme est ancré dans la volonté de proposer des solutions collectives non punitives aux conflits inévitables en société.
Partant du constat que les violences faites aux femmes sont généralisées et systématiques même si toutes les femmes n’y sont pas également exposées, Ricordeau établit clairement dans le deuxième chapitre que le système pénal ne les protège pas, ni ne répond aux besoins de reconnaissance, de réparation et de justice de celles qui ont connu la victimation. Les troisième et quatrième chapitres examinent respectivement ce que le système pénal fait aux femmes judiciarisées, puis à celles qui sont proches de personnes incarcérées. Alors que le grand public et le milieu de la recherche se désintéressent généralement des femmes car elles ne représentent que quelques points de pourcentage des personnes judiciarisées et incarcérées, Ricordeau remarque justement que le faible taux de criminalité chez ces dernières s’explique par la socialisation genrée, un constat confirmé par l’historiographie récente en Occident (voir par exemple le dossier « Crime and Gender » du Journal of Social History, vol. 51 no. 4, 2018, particulièrement l’introduction des historiennes Manon van der Heijden et Marion Pluskota). Comme leurs homologues masculins, les femmes judiciarisées appartiennent davantage à des groupes marginalisés (populations racisées, minorités sexuelles et de genre, personnes précaires économiquement, etc.). Plus que les hommes, les femmes arrivant en prison ont souvent eu une trajectoire marquée par la victimation, notamment sexuelle. Elles sont aussi fréquemment impliquées dans des activités criminelles par association avec un partenaire masculin, par exemple dans le trafic de stupéfiants (incidemment, c’était déjà le cas pour le trafic d’alcool au temps de la prohibition, comme le montre la sociologue canadienne Chris M. Smith dans son Syndicate Women: Gender and Networks in Chicago Organized Crime, Oakland : University of California Press, 2019). Ricordeau évoque aussi les impacts de l’incarcération sur les femmes et leur entourage, en particulier leurs enfants, et aborde les problématiques particulières vécues par les personnes trans emprisonnées, notamment la stigmatisation, le risque de préjudices sexuels et la privation de traitements hormonaux. Elle souligne que le Canada est en la matière un pionnier puisque depuis 2017, les personnes trans condamnées ont le choix d’aller dans un pénitencier masculin ou féminin (voir à ce sujet les travaux de l’anthropologue William Hébert), ce qui n’est pas encore possible pour les sentences provinciales. Ricordeau soulève les paradoxes de l’institution carcérale dans son traitement des femmes alors qu’elle a été créée surtout pour enfermer des hommes. Toutefois, elle n’est pas favorable à l’implantation d’institutions carcérales sexospécifiques qui étendraient le contrôle étatique sur les femmes, tout comme le faisaient les maisons de réforme des 19e et 20e siècles. Les proches de personnes incarcérées, dont Ricordeau a partagé l’expérience douloureuse, sont majoritairement des femmes, souvent mères, soeurs, ou compagnes, qui assument une partie non négligeable du poids matériel, financier et émotionnel de l’incarcération. Les multiples formes de solidarité dont ces « victimes secondaires de l’incarcération » (130) font preuve jusqu’après la libération de leurs proches sont souvent ignorées quand elles ne sont pas instrumentalisées par l’institution.
Le cinquième chapitre permet de développer la réponse de Ricordeau à la question suivante : « Faut-il inscrire les luttes féministes dans le système du droit? ». La sociologue constate que la prison est « un angle mort » (146) de ces luttes, les mouvements féministes contemporains ayant pris un tournant de plus en plus punitif en réclamant la judiciarisation des auteur·ice·s de violences faites aux femmes. Critiquant ce féminisme qu’elle qualifie de carcéral, elle suggère plutôt qu’on s’intéresse à la pensée des abolitionnistes du pénal, au premier rang celle des Black feminists Angela Y. Davis, Ruth W. Gilmore ou Beth Richie et, plus récemment, aux propositions de groupes queer qui offrent des solutions alternatives collectives répondant mieux aux besoins des femmes et des groupes marginalisés. Quelques-unes de ces pratiques alternatives sont présentées dans le sixième et dernier chapitre qui conclut l’essai. L’autrice y décrit les grands principes des approches de justice réparatrice, de justice restaurative et de justice transformative. Médiation, réconciliation et guérison y sont centrales, et la mobilisation du collectif est cruciale pour répondre aux besoins des victimes, sans pour autant punir les auteur·rice·s de préjudices.
Dans ce court essai, Ricordeau parvient à « détricoter » (pour reprendre ses mots) notre dépendance au système pénal et à articuler comment l’abolitionnisme pénal doit élargir sa focale pour inclure les femmes, qu’elles soient incarcérées, proches de personnes incarcérées ou bien victimes, car le genre structure le pénal (Angela Y. Davis, La prison est-elle obsolète?, Vauvert : Au diable vauvert, 2014). Ricordeau nous invite à inscrire la lutte abolitionniste dans nos mouvements militants tout comme dans nos réflexions intellectuelles, et surtout à oser penser un monde sans prisons.
Nathalie Rech, Labour / Le Travail, vol. 88, automne 2021
 Mon compte
Mon compte