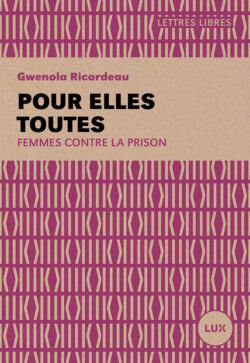Sous-total: $

Pourquoi la prison pose problème: Gwenola Ricordeau sur l’abolitionnisme
Les statistiques concernant la prison sont affolantes, et la réponse carcérale est une forme de régression pour une société déjà fondée sur les inégalités.
En Belgique, entre 1985 et 2015, 57% des personnes condamnées étaient récidivistes. En France, d’après l’Observatoire International des Prisons, le taux de récidive serait de 63% dans les cinq ans suivant une première sortie du ballon. Et ça fait un bail que le système pénal est pointé du doigt pour sa propension à favoriser la récidive et à contourner les sources des problèmes structurels.
On est beaucoup à trouver la prison coûteuse, inhumaine et dépassée ; elle n’est pas efficace pour lutter contre la criminalité, pas plus qu’elle ne protège les gens. Au contraire, comme la police, la justice pénale maintient les inégalités sociales et les prolonge au sein des taules, dans lesquelles se trouvent des personnes davantage susceptibles de subir les oppressions systémiques. On parle ici de personnes peu qualifiées, précaires, racisées que l’État se charge de punir, en dépit de l’attention accordée aux victimes – des punitions qui peuvent paraître ciblées quand on sait que, par exemple, loin des crimes en col blanc, un peu plus de la moitié des condamnations en Belgique concernent des faits de drogue (50,8% en 2018).
Pour l’instant, le mouvement pour l’abolition des prisons est surtout répandu aux États-Unis, où vivent près de 4,3% de la population mondiale mais dont les prisonnier·es représentent près d’un quart de la population carcérale mondiale. En Europe, alors que les inégalités s’accentuent et les discours de droite et d’extrême-droite qui leur laissent place se renforcent, le débat ne semble présent que dans les milieux libertaires ; absent de l’espace politique dominant. Ça stagne pas mal alors que les chiffres alarmants de diverses études s’accumulent et interrogent la légitimité du système pénal depuis une plombe ; c’est notamment en 1975 que Michel Foucault avait écrit Surveiller et punir.
À l’heure où les gens peinent à saisir la nécessité du principe pourtant simple des réunions en non-mixité choisie, comment faire comprendre que le système pénal est à revoir ? Que nous manque-t-il pour tendre vers la justice sociale ? Il semble qu’il est plus que jamais nécessaire de dépasser le stade de réflexion afin de voir émerger différentes formes de voies non-carcérales.
Parce qu’on est conscient·es des problèmes que posent les prisons mais qu’on en sait encore peu sur le mouvement abolitionniste, on a parlé de tous ces trucs qui nous dépassent à Gwenola Ricordeau, professeure assistante en justice criminelle à la California State University de Chico, qui sort son nouveau livre, Crimes & Peines. Penser l’abolitionnisme pénal (éditions Grévis), dans lequel elle présente des traductions en français inédites des textes de Nils Christie, Louk Hulsman et Ruth Morris – trois auteur·es dont les réflexions ont profondément marqué l’abolitionnisme pénal.
VICE : Le mouvement pour l’abolition des prisons ne s’est développé que dans les années 1970. Pourquoi si tard ?
Gwenola Ricordeau : C’est en effet à cette période que le terme « abolitionnisme » a commencé à être utilisé pour désigner des réflexions et des mouvements qui avaient en commun le projet d’abolir la prison ou, plus largement, le système pénal. Mais cela ne veut pas dire que la légitimité de l’existence de ces institutions n’a pas été contestée avant cette période, notamment par les anarchistes. En outre, les résistances au système pénal et à sa diffusion ont toujours été assez nombreuses.
Les années 1970 ont permis une dynamique politique entre des réflexions académiques, en particulier d’universitaires travaillant sur le droit ou la criminologie, et des mouvements d’extrême gauche. La filiation politique de l’abolitionnisme pénal est complexe, mais les mouvements anarchistes et autonomes ont joué un rôle primordial en Europe. En Amérique du Nord, l’histoire de l’abolitionnisme est davantage marquée par les luttes de libération afro-américaine.
Comment expliquer, qu’un demi-siècle plus tard, il y ait aussi peu de textes à ce sujet traduits en français ?
À quelques exceptions près, comme certains textes de Catherine Baker (Pourquoi faudrait-il punir ?) ou de Jacques Lesage de La Haye (L’Abolition de la prison), les publications autour de l’abolitionnisme pénal demeurent largement de type académique. Ensuite, il est vrai qu’en dehors d’Angela Davis (La Prison est-elle obsolète ?), beaucoup d’auteur·es majeur·es de l’abolitionnisme pénal, comme le norvégien Thomas Mathiesen (The Politics of Abolition), n’ont pas encore été traduit·es en français.
Il y a sans doute des raisons propres au monde de l’édition et que je serais donc bien en peine d’expliquer, mais il me semble qu’il faut aussi chercher du côté de l’histoire politique : l’abolitionnisme en France – et peut-être en Belgique ? – s’est tenu assez éloigné du monde académique (et réciproquement), alors qu’ailleurs, l’abolitionnisme est à la fois un champ de réflexion académique et un mouvement social.
« Le tour de force du système pénal, c’est bien de détourner l’attention des innombrables formes de victimation que créent la prison, la police et donc le système pénal dans son ensemble. »
En quoi les propos de Christie, Hulsman et Morris restent pertinents aujourd’hui ?
Les réflexions de ces trois auteur·es portent sur divers aspects du système pénal et le sens politique à donner à leurs travaux peut être l’objet de discussions. Mais on peut commencer par Nils Christie et son analyse de la manière dont le système pénal, en prenant en charge le traitement des crimes, dépossède les auteur·es d’infractions et leurs victimes, mais aussi le corps social dans son ensemble, de la « richesse des conflits ». Cette analyse de l’expropriation des conflits à laquelle procède le système pénal est très fructueuse et elle résonne fortement avec l’expérience qu’on peut avoir aujourd’hui si on est confronté·e au système pénal, que l’on soit auteur·e d’une infraction ou victime.
Louk Hulsman fait une critique de la catégorie de « crime » et invite à réfléchir en termes de « situations-problèmes » – tout en rappelant qu’il est impossible de penser une vie sociale sans « situations-problèmes ». Pour sa part, Ruth Morris a réfléchi aux besoins des victimes et aux manières de répondre à ces besoins. Elle a aussi dénoncé ce qu’elle appelle la « dépendance au pénal ». Bref, ces auteur·es me semblent très actuel·les, tant au niveau de leurs analyses que dans leur invitation à penser des manières de s’autonomiser du système pénal.
Quelles sont les grandes différences entre leurs textes et les réflexions d’Angela Davis ?
C’est une question compliquée car les réflexions d’Angela Davis, de Nils Christie, de Louk Hulsman et de Ruth Morris ne s’inscrivent pas dans les mêmes disciplines et les contextes politiques et historiques de leurs écrits sont assez différents. Par exemple, Nils Christie et Louk Hulsman étaient respectivement des professeurs de criminologie et de droit. Leurs réflexions sont très marquées par leurs disciplines. Mais le travail de Nils Christie sur l’« industrie de la punition » (L’Industrie de la punition. Prison et politique pénale en Occident, 2003) rejoint par certains aspects ceux d’Angela Davis sur le « complexe carcéro-industriel ».
« La prison, la police, et donc le système pénal dans son ensemble, sont au service de l’État. Il serait illusoire de penser qu’ils peuvent être utilisés pour lutter contre le capitalisme, le patriarcat ou le racisme systémique. »
D’ailleurs votre livre évoque les débats autour du rapport entre capitalisme et système carcéral qui ont alimenté les débats dans les cercles abolitionnistes.
La prison, la police, et donc le système pénal dans son ensemble, sont au service de l’État. Il serait illusoire de penser qu’ils peuvent être utilisés pour lutter contre le capitalisme, le patriarcat ou le racisme systémique. Le tour de force du système pénal, c’est bien de détourner l’attention des innombrables formes de victimation que créent ces systèmes. D’ailleurs, dans son travail, Ruth Morris met en lumière comment les besoins des victimes de crimes interpersonnels rejoignent ceux des victimes de crimes systémiques.
Quelles sont alors les alternatives à la prison qui vont permettre aux victimes de se « réapproprier les conflits » ?
Le terme « alternative » a été abondamment critiqué par l’abolitionnisme et je pense qu’il y a un large consensus pour dire qu’il ne s’agit pas de chercher des « alternatives », mais des « solutions ». Se « réapproprier les conflits », expression qui fait référence au travail de Nils Christie, peut se faire de différentes manières et les propositions de Christie ne sont pas celles de tous les mouvements abolitionnistes. En bref, ce qu’il propose ressemble à des procédures qui seraient plus proches du droit civil que du droit pénal, avec une dé-professionnalisation de la justice. Aujourd’hui, il est rarement apporté une réponse pénale aux viols, par exemple ; je ne vois pas ce qui nous empêcherait de penser qu’il peut être apporté des réponses non-punitives pour d’autres crimes graves.
« En faisant appel à plus de peines de prison, en s’appuyant sur le système pénal, il ne peut y avoir une véritable émancipation collective. »
Donc le mouvement abolitionniste vise à se détacher d’un État qui a le monopole de la punition en misant sur le changement structurel des conditions sociales qui peuvent être les sources des crimes. C’est là-dessus que se penche la justice transformative ?
La justice transformative est une formulation beaucoup plus récente et elle a une forme de filiation avec les propositions de Nils Christie, et aussi avec la justice restaurative. Mais on peut dire qu’elle s’inscrit surtout dans une approche communautaire. On pense souvent les « crimes » comme des catégories d’évènements à part, ce qui nous empêche de voir que nous sommes capables, quotidiennement, de résoudre des conflits sans recourir au système pénal. C’est également vrai au niveau de l’histoire des sociétés humaines qui ont eu de nombreuses façons de faire face à des actes jugés préjudiciables. D’ailleurs, des approches de réconciliation ont été prônées dans des circonstances des plus tragiques comme les crimes de masse. Le développement actuel en Amérique du Nord des pratiques de justice transformative me semble très prometteur, car il permet de répondre aux besoins des victimes et de s’autonomiser du système pénal. Mais dès qu’on formule des propositions de réformes, on se retrouve pris dans le piège du réformisme.
Pourquoi le réformisme serait-il un piège ?
Les analyses du système pénal ne font pas l’objet de beaucoup de désaccords et il est difficile de trouver des personnes qui ne critiquent pas ce système, mais le projet des abolitionnistes n’est pas de réformer le système pénal ou la prison. On cite souvent Michel Foucault qui écrit, dans Surveiller et punir, que « la “réforme de la prison” est à peu près contemporaine de la prison elle-même. Elle en est comme le programme ». Or, si l’abolitionnisme est traversé par des débats et même des controverses (par exemple au niveau de la stratégie), il y a un accord sur le fait que c’est le système lui-même qui pose problème, pas son fonctionnement. En d’autres termes, les abolitionnistes pensent que le système pénal fonctionne très bien au regard de ce qui est attendu de lui : protéger l’État, le système capitaliste, le racisme structurel et le patriarcat. Les réformistes pensent qu’il fonctionne mal et que s’il fonctionnait bien, il serait socialement utile, voire qu’il pourrait être mis au service d’une plus grande justice sociale.
Comme beaucoup d’abolitionnistes, je pense que le réformisme permet d’entretenir l’idée de la légitimité du système pénal. Qu’il s’agisse de la prison ou de la police, on assiste à un cycle sans fin « dénonciation de dysfonctionnements »/« proposition de réformes ». C’est par exemple ce que j’ai dénoncé il y a quelques mois dans « Autant en emporte le vent réformiste » à propos de la police.
« On pense souvent les “crimes” comme des catégories d’évènements à part, ce qui nous empêche de voir que nous sommes capables, quotidiennement, de résoudre des conflits sans recourir au système pénal. »
D’un autre côté, certaines personnes trouvent incompatibles lutte anti-carcérale et lutte contre les violences faites aux femmes. Mais dans Pour elles toutes. Femmes contre la prison, vous écrivez que vous êtes « abolitionniste parce que féministe ».
D’abord parce que le système pénal ne protège pas les femmes et qu’il répond très mal aux besoins des victimes. Face à l’ampleur des crimes contre les femmes, l’enfermement de certains auteurs de viols n’est pas une réponse à la hauteur du problème. Or c’est la principale proposition qui est faite : enfermer plus de gens, pour des durées de plus en plus longues… Mais rien ne prouve que le taux d’incarcération ait le moindre effet sur le nombre de crimes commis. C’est souvent présenté comme une évidence que le système pénal pourrait être au service de la cause des femmes. Mais la cible du système pénal, ce sont les hommes pauvres et ceux issus de l’immigration ou de l’histoire coloniale. En faisant appel à plus de peines de prison, en s’appuyant sur le système pénal, il ne peut y avoir une véritable émancipation collective. D’autant qu’on oublie souvent que, quand des hommes sont envoyés en prison, les femmes de leur entourage sont aussi punies d’une certaine manière, car c’est à elles que revient d’assurer les visites au parloir, de prendre en charge les dépenses du foyer, etc.
Mais en attendant d’éventuelles réformes ou le renversement des évidences, comprenez-vous qu’on sollicite le système pénal actuel pour que les violeurs assument leurs actes ?
L’abolitionnisme n’est pas un code de comportement qui dit aux victimes de ne pas recourir au système pénal, mais tout recours au système pénal est un échec collectif à mes yeux. Justement, la punition et l’enfermement sont le contraire d’« assumer ses actes ». Dire que la punition d’un auteur aide sa victime, c’est en partie inexact : Ruth Morris évoque justement ce besoin de sécurité des victimes, l’enfermement d’un auteur n’apporte pas toujours un sentiment de sécurité, et puis on laisse ainsi dans l’ombre tous les autres besoins des victimes. Cela reste une solution pour seulement certaines victimes : il y a des auteurs qui ne sont jamais retrouvés, qui sont morts ou pas en état d’être jugés.
« L’abolitionnisme n’est pas un code de comportement qui dit aux victimes de ne pas recourir au système pénal – mais tout recours au système pénal est un échec collectif à mes yeux. »
La relation directe entre condition sociale et crime n’est plus à démontrer et c’est donc à la société entière de se repenser, mais au-delà de la phase de réflexion, comment les luttes anti-carcérales peuvent-elles s’organiser ?
Au sein de l’abolitionnisme, il y a eu de nombreux débats sur la stratégie. Certains courants prônent la « stratégie gradualiste », c’est-à-dire de procéder par étapes, en décriminalisant de plus en plus de types d’actes et en réduisant de plus en plus le recours à l’enfermement. D’autres proposent de soutenir des luttes qui permettent d’affaiblir la prison (par exemple en s’opposant à la construction de nouvelles prisons) ou la police (c’est le sens de la revendication « Defund the police » aux États-Unis).
On peut aussi œuvrer à créer des espaces d’autonomie du système pénal, des manières de résoudre des problèmes sans recourir à la police par exemple. Mais comme un certain nombre d’abolitionnistes, je pense qu’il n’y aura pas de véritable abolition sans processus révolutionnaire, car c’est de l’État qu’il s’agit quand on parle du système pénal.
Le livre Crimes & peines. Penser l’abolitionnisme pénal de Gwenola Ricordeau, avec Nils Christie, Louk Hulsman, Ruth Morris est sorti le 14 mai 2021 aux Éditions Grevis. Traductions des textes originaux par Pauline Picot et Lydia Amarouche.
Gen Ueda, Vice, 14 mai 2021
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte