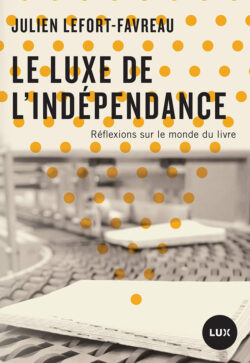Sous-total: $

Julien Lefort-Favreau: «Les luttes politiques actuelles ne peuvent faire l’économie d’une défense de l’indépendance»
Passionnant : tel est le mot qui vient à l’esprit pour qualifier le fort et bel essai que Julien Lefort-Favreau consacre à l’édition indépendante qu’il vient de faire paraître chez Lux sous le titre de Le Luxe de l’indépendance. Dans ses Réflexions sur le monde du livre, Lefort-Favreau réfléchit à ce que signifie être indépendant, de nos jours, dans le monde du livre, à savoir comment s’élabore au quotidien mais aussi dans le long terme une indépendance esthétique, politique et économique. Qu’en est-il de l’engagement de l’éditeur ? Comment se construit le récit de cette indépendance ? Comment trouver un équilibre financier qui tienne compte du désir d’avant-garde ? Autant de questions que Diacritik a désiré poser au professeur de littérature française et d’études culturelles à l’Université Queen’s au Canada.
Ma première question voudrait porter sur la genèse de votre fort essai, Le Luxe de l’indépendance qui vient de paraître et qui, comme son sous-titre, l’indique sans détours propose une somme de réflexions sur le monde du livre. Comment vous en est venue précisément l’idée ?
Vous proposez, en introduction, un faisceau de faits qui mettent en avant l’indépendance de l’édition, notamment l’interpellation d’Eric Hazan de La Fabrique au moment de l’affaire de Tarnac : cette affaire est-elle précisément à l’origine même de votre réflexion ? Plus largement, vous indiquez également d’emblée que vous avez songé à intituler votre essai, Les Ruines de l’édition tant, pour vous l’édition indépendante, doit se comprendre en articulation étroite avec les grands groupes : pourquoi avoir renoncé à ce titre ?
Ce livre a plusieurs commencements. Il se nourrit d’abord de mon passé de libraire, métier pratiqué à temps partiel lorsque j’étais jadis étudiant. Il naît également d’un engagement à titre d’éditeur dans la revue québécoise Liberté. Voilà pour ce que l’on pourrait désigner comme une expérience de terrain, une lente immersion dans l’univers des discours et des pratiques de l’édition québécoise.
Je ne suis pas sociologue patenté : je suis littéraire de formation, et j’ai approché ce travail avec des outils bricolés. J’ai, par ailleurs, dans le cadre de recherches universitaires, après avoir consacré une thèse de doctorat à Pierre Guyotat, travaillé sur les rapports historiques entre politique et édition (j’ai par exemple commis un article sur l’engagement de François Maspero en Mai 68). Si l’aspect politique de l’écriture de Guyotat ne relevait pas en propre du travail éditorial, déjà à ce moment m’intéressait son implication dans des revues littéraires et la manière dont Gallimard l’a défendu et « mis en marché ». En somme, graduellement s’est imposé à moi avec force l’hypothèse que les politiques de la littérature ne naissent pas dans le ciel des idées, ne sont pas uniquement le résultat de transactions symboliques : elles s’incarnent aussi dans des rapports matériels de circulation des livres (ou d’autres objets culturels), dans des institutions — en somme, je veux observer non seulement la portée politique des textes eux-mêmes, mais également des médiations par lesquelles ils transitent. Mon idée était donc d’attirer l’attention sur une chose qui me semble cruciale : les luttes politiques actuelles ne peuvent faire l’économie d’une défense de l’indépendance de ces lieux de médiation. Et cette indépendance n’est pas toujours définie dans des termes très clairs ce qui, à terme, me semble avoir des effets délétères. Mon intention était aussi de recadrer très légèrement les débats sur la liberté d’expression qui font souvent l’impasse sur les paramètres économiques qui l’encadrent (ou en l’occurrence, la briment). Et ces « contraintes » économiques, je vous le donne en mille, viennent restreindre l’expression minoritaire et divergente. Comme vous le voyez, je n’adhère pas à l’idée d’une censure dont seraient responsables les minorités tyranniques.
Au fil de mes recherches, l’incroyable flou autour de la notion d’indépendance m’est apparu comme un filon riche pour l’analyse. La notion me semblait présenter une jonction intéressante entre les valeurs de désintéressement et de gratuité qui caractérisent le pôle restreint de diffusion (ou de l’avant-garde) et une organisation socioprofessionnelle du monde de l’édition. Ce livre est donc, pour le dire presque à la manière d’une boutade, l’expression naïve de l’imaginaire révolutionnaire de la littérature qui cohabite chez moi avec un fort tropisme matérialiste qui s’accommode bien des disciplines de la sociologie de l’édition et de l’histoire du livre. Quelle est la matérialité des idées ? Quelles sont les conditions de circulations des livres et des idées ? Mon propos n’est pas totalement engagé dans Le luxe de l’indépendance ; il n’obéit pas non plus à une absolue neutralité axiologique. Je suis un acteur (à temps partiel, disons), du monde du livre.
J’ai changé de titre pour ne pas être complètement pessimiste. Car je ne le suis pas ! Il n’est pas impossible d’envisager des économies alternatives de la culture qui permettraient aux ruines de renaître ! Plus sérieusement, l’édition indépendante me semble à la fois foisonnante et précaire, et ce n’est pas l’un des moindres paradoxes du capitalisme avancé. Les progrès technologiques des 30 dernières années ont grandement favorisé la petite édition en la rendant plus légère et flexible. Toutefois, il semble que le virage algorithmique du capitalisme pourrait avoir des effets funestes sur la diffusion de la culture hors des énormes plates-formes.
Pour en venir au cœur actif de votre fort propos, l’essentiel de votre essai se concentre sans attendre sur la définition de l’indépendance éditoriale qui vous apparaît comme triple : esthétique, politique et économique. Si vous en développez la portée et les conséquences, vous prenez cependant soin d’emblée de dire avec Olivier Alexandre, Sophie Noël et Aurélie Pinto que, dans la bouche des éditrices et des éditeurs, l’indépendance se construit et se conçoit avant tout comme un récit. Ce récit se donne toujours dans un double pôle ou répond à une double postulation : toujours entre argent et art.
Diriez-vous ainsi que ce récit de l’indépendance peut lui-même se faire double, pouvant, selon les éditeurs, être le récit d’une épopée ou inversement une construction marketing, un véritable storytelling ? Vous parlez également d’un pacte faustien que les éditeurs indépendants passent : ce pacte doit-il se lire comme l’alliance contre-nature du radicalisme et du pragmatisme ?
Bonne question à laquelle il n’y a pas de raison simple. Je dirai d’abord que le fait que l’indépendance soit un récit n’est pas forcément à déplorer, même si les épopées peuvent être pompeuses et les constructions marketing obscènes. Ces discours qui soutiennent les pratiques sont aussi essentiels : ils participent à ces politiques de la littérature que j’ai évoquée plus tôt. Les idées existent dans l’espace public parce qu’on en défend l’importance et qu’on débat de leur légitimité. Ainsi, il n’est pas surprenant que les éditeurs ressentent le besoin d’accompagner leur pratique d’un discours. Mon interrogation serait plutôt : à qui et à quoi servent ces récits ? L’automythification se voit à gauche et à droite. Mais on peut néanmoins observer que les plus radicaux, cette mythification est aussi le lieu d’un retour critique sur le milieu du livre, d’une objectivation des moyens de production. Chez les plus commerciaux, l’indépendance devient, comme le signale Tanguy Habrand, un simple branding superficiel.
Ce pacte faustien, il est un écueil à la fois inévitable et fertile. En des termes théoriques, je remarque que certains éditeurs sont extrêmement satisfaits de leur position marginale. C’est un discours que l’on voit à l’œuvre chez bon nombre de petits indépendants, notamment ceux établis en périphérie. Ils occupent une niche et adoptent une posture plus proche de celle de l’artisan. Mais il me semble, et il ne s’agit là que de mon modeste avis, qu’il est plus intéressant d’observer ceux qui produisent des objets culturels relativement en marge, et néanmoins, qui tentent d’avoir une influence sur le centre des discours. Appelons cela une stratégie contre-hégémonique plus qu’une position strictement avant-gardiste. Il s’agit donc, oui, vous avez raison, d’une sorte d’alliance contre-naturelle entre pragmatisme et radicalité (c’est comme cela que la chercheure Sophie Noël nomme les choses) — mais je crois aussi que ce mariage paraît improbable en ce moment à cause d’une uniformisation des milieux culturels et intellectuels. Sans entrer dans une forme de nostalgie qui serait saugrenue venant d’un homme né dans les années 1980, il faut observer que dans les années 60 et 70, plusieurs textes radicaux ont néanmoins eu une large diffusion sous l’impulsion de l’action d’éditeurs indépendants. Il est donc des contextes sociaux et des configurations économiques qui rendent possible cette alliance.
Les rapports entre art et argent peuvent être pensés, comme le font par exemple Jean-Pierre Cometti et Nathalie Quintane dans leur ouvrage du même publié aux éditions Amsterdam, comme, sous le prisme de la réification de l’art sous la pression du marché. Mais ce qui m’intéresse ici, ce n’est pas tant le statut de l’artiste comme producteur artistique dans un contexte néolibéral (même si cette question m’intéresse au plus haut point) : je cherche plutôt à identifier comment il est possible de mettre des moyens de production au service d’idées radicales. Peut-on passer du pacte faustien au cheval de Troie ?

Dans Le Luxe de l’indépendance, vous insistez avec raison sur l’indépendance éditoriale comme une manière de dimension politique sinon militante de l’autonomie : comme si s’affirmer éditeur indépendant, c’était comprendre qu’il fallait faire commerce même de textes qui, politiquement, s’opposent à l’économie de marché. Au-delà de cette intime contradiction, le milieu de l’édition indépendante vit, depuis la vision politique de soi-même, dans une manière peut-être d’héroïsation qui mobilise un capital non financier mais culturel : s’affirmer comme l’avant-garde.
Cependant, et ce sera ma question, être à l’avant-poste de la pensée et de la création, n’expose-t-il pas également ici à un discours forcément double, où l’avant-garde exige des sacrifices financiers et expose à une manière de martyrologie de l’éditeur ?
Je suis fasciné par ces paradoxes propres aux moyens de productions des objets culturels qui sont, ou qui peuvent être, des outils de contestation des moyens de production. Je note au passage que si mon livre se penche sur des phénomènes d’édition relativement mainstream, j’aurais pu m’intéresser, et ce sont des projets qui me tiendront occupé dans le futur, à l’indépendance dans l’édition de masse, dans l’édition savante, ou dans l’édition artisanale. Chaque fois, ce sont des tensions différentes qui se jouent entre les moyens de production, les discours qui légitiment les choix commerciaux, les publics fantasmés et réels.
Je crois que ce paradoxe que vous exposez est juste, il correspond à une position sociologique : l’éditeur indépendant (le masculin ici n’est pas anodin) doit sacrifier la fortune pour pouvoir asseoir son capital culturel. Plus encore, rejoindre un large public serait vu comme une trahison. Il m’est toutefois d’avis que cette conception des choses ne correspond certainement pas à l’ensemble du sous-champ de l’édition indépendante. Nombreux et nombreuses sont ceux qui créent des structures d’édition avec la ferme ambition de rejoindre un large public et qui rencontrent des barrières systémiques. Ainsi, si mon livre peut parfois être légèrement narquois, comme vous l’êtes vous-mêmes, devant certaines postures héroïques et auto-mythificatrices, il existe également des menaces qui ne naissent pas de simples contradictions sociologiques. C’est là qu’il est une urgence d’une action collective. Je donnerai un exemple, que j’évoque dans le livre, mais qui devrait apparaître comme paradigmatique des périls qui menacent l’édition indépendante.
La maison québécoise Écosociété fut poursuvie il y a une dizaine d’années pour plusieurs millions dollars par deux compagnies minières à la suite de la parution du livre Noir Canada, mettant en péril la survie de l’entreprise, et par conséquent, la survie de ces artisans. Cela montre bien comment l’indépendance éditoriale (économique et idéologique, car Écosociété est une structure collective qui publie des essais contestant avec vigueur le système capitaliste) est une position offensive, et que son coût réel et symbolique est élevé.

Donc, pour résumer, la martyrologie de l’éditeur est réelle, et je pense qu’il est nécessaire de l’objectiver pour parvenir à définir avec plus d’acuité quelles sont les menaces extérieures au monde du livre (mutations technologiques, appareil judiciaire, politique) qui viennent entamer la liberté d’expression, notamment celles de ceux qui n’ont pas les moyens de se défendre. Et c’est sans compter la censure du commerce qui réduit graduellement la visibilité des œuvres exigeantes qui ne sont pas explicitement politiques, mais dont la simple existence apparaît comme une anomalie dans l’univers néolibéral.
Avec force, votre essai saisit très concrètement des exemples d’éditeurs indépendants afin d’en scruter la stratégie discursive. Vous vous intéressez notamment avec précision au cas très ambivalent d’Actes Sud qui, de petite structure arlésienne, s’est, en 40 ans, imposé comme un groupe économique, une holding éditoriale employant plus de 200 personnes mais qui, dans sa mythologie, notamment relayée par sa P-DG, Françoise Nyssen, se rattache toujours à un petit groupe éditorial. Vous n’hésitez pas à notamment qualifier Actes Sud de « miroir aux alouettes de l’indépendance » : pourriez-vous nous dire pourquoi ? N’est-on pas, devant une telle maison aux intérêts économiques florissants, devant une classique stratégie managériale qui fait du terme d’indépendance son branding, une manière classique d’instrumentalisation du concept d’indépendance afin de présenter une certaine image de marque ?
Je suis peut-être sévère avec Actes Sud en la qualifiant de miroir aux alouettes. J’ai néanmoins l’impression qu’il est une taille et un fonctionnement (nombre d’employés, chiffres d’affaires, politique de rachats de plus petits éditeurs) à partir duquel les défis rencontrés ne sont plus ceux de l’indépendance. Une actualité récente montrait avec éloquence qu’Actes Sud, sans considération ni assomption aucune sur la qualité de leur catalogue (tout est question de goût, n’est-ce pas), n’a pas les problèmes de trésorerie de la majorité des joueurs indépendants. La propriété du capital immobilier a une incidence directe sur la structure du sous-champ indépendant. Le coût du loyer pour un éditeur, la gentrification des quartiers centraux pour les libraires, etc. Actes Sud est, pour le dire trivialement, de l’autre côté de la clôture, et son rapport à la spéculation immobilière en est le signe indéniable. Et la preuve irréfutable, à mon sens, que pour bien comprendre l’indépendance du monde du livre, il faut parfois être attentif à des facteurs exogènes (à tout le moins, un peu périphériques en apparence), en l’occurrence ici : la part de la trésorerie réservée à l’immobilier.
Soyons clairs : les grands éditeurs publient des textes très intéressants, et ils ont une importance capitale dans l’écosystème éditorial. Mais la revendication de l’étiquette indépendante par ces acteurs m’apparaît comme un long shot conceptuel. D’ailleurs, ce paradoxe est souvent lié à un nationalisme : un géant de l’édition français serait-il de facto indépendant ? Au Québec, le groupe Québecor Média (qui est à la fois fournisseur d’accès, propriétaire de réseaux de télévision, de journaux, de magazines, de maisons d’édition) n’utilise pas nommément le mot indépendance, mais leur rhétorique s’appuie néanmoins sur un nationalisme de proximité. Faire des affaires en français dans le contexte québécois apparaît comme une valeur de résistance. Accepter ce discours signifierait toutefois de fermer les yeux sur leurs pratiques de concurrence déloyale, de contrôle policier des discours, de mauvais traitement des employés. On peut donc observer une sorte d’independance washing, comme on parle de green washing pour l’environnement. L’indépendance éditoriale doit, à mon avis, être une valeur politique avec un certain tranchant, sans quoi elle n’est d’aucune utilité pour la mobilisation contre les grands maux de notre époque que sont les algorithmes et les plates-formes.
Pour revenir plus directement à votre question : oui, avec Actes Sud, nous avons un cas tout particulièrement exemplaire de l’indépendance utilisé comme signe de distinction et comme outil de marketing. Observer les discours tenus par les acteurs d’Actes Sud depuis la fin des années 1970 permet bizarrement de voir à l’œuvre une incroyable stabilité dans le discours : tout se passe comme si la maison conservait toujours la même taille ! Et cette image, c’est celle d’une petite entreprise familiale, régionale de surcroît, entretenant un rapport antagoniste (et forcément un peu envieux) aux grandes maisons parisiennes, faisant la promotion d’une sorte d’écologie ésotérique (l’écosophie). L’image a d’abord été largement focalisée autour de la figure d’Hubert Nyssen, pour être habilement transférée à Françoise Nyssen. La mythologie du monde éditorial aime bien les dynasties. Image étonnamment stable qui m’amène donc à ce constat, qui mériterait sûrement d’être nuancé : parfois, le mot « indépendance » désigne la position initiale de l’éditeur et semble faire abstraction de sa trajectoire. Je précise encore une fois que cela ne change rien à la qualité du catalogue : on pourrait certainement féliciter Actes Sud pour son engagement continu dans la diffusion du « catalogue étranger » en France, de son extraordinaire investissement dans le livre jeunesse, dans le théâtre — autant de secteurs qui ne sont pas automatiquement rentables. Mais au final, je tranche : tout cela n’a plus rien à voir avec l’indépendance comme valeur politique.
S’agissant de l’édition indépendante, dans ses fondations désormais historiques, vous évoquez l’importance d’André Schiffrin, notamment dans la manière dont l’éditeur indépendant est également le plus souvent le théoricien, pour ne pas dire le poéticien, de sa propre pratique éditoriale. Est-ce l’une des caractéristiques mêmes de l’édition indépendance que d’avoir un regard critique sur sa propre pratique ? Plus largement, est-ce que l’édition indépendante doit être celle de la prise de position politique pour être qualifiée d’indépendante ? Un éditeur indépendant doit-il forcément être un éditeur engagé ?
Je ne crois pas qu’un éditeur doit être engagé pour être indépendant. Ce serait preuve d’un héroïsme aux relents sartriens, où l’engagement apparaîtrait presque comme une ontologie, à tout le moins comme une exigence morale. Je privilégierais une valse plus subtile de compromis, de négociations.
Oui, un éditeur doit être apte à produire un discours objectivant sur sa propre pratique et sur le milieu pour être indépendant. Mais il peut néanmoins publier des textes détachés des questions politiques brûlantes. C’est même essentiel pour moi que l’indépendance ne soit pas associée à un type spécifique de contenu, sans quoi elle est réduite à une responsabilité individuelle, ce qu’elle n’est pas. Je pense à un éditeur très important au Québec : L’Oie de Cravan. Son animateur, Benoît Chaput, construit depuis 1992 un catalogue principalement constitué de poésie et de bandes dessinées. Son catalogue n’est pas explicitement politique. Ses moyens de production, eux, le sont, et sa manière d’engager une communauté découle directement de la tradition du Do It Yourself et de la contre-culture. Farouchement indépendant, clairement politique dans les intentions, dans le positionnement — aucune trace du politique (ou si peu) dans les œuvres elles-mêmes. Idem en France pour José Corti, Minuit : sont-ils moins indépendants qu’Amsterdam ou La Fabrique ? Bien sûr que non.

André Schiffrin est une figure intéressante, tout comme d’Eric Hazan d’ailleurs, parce qu’ils représentent en quelque sorte des cas de transfuges si l’on peut dire. Ils ont appartenu à l’ancien monde, celui où, selon leurs dires (je n’y étais point), on se satisfaisait d’une moins grande rentabilité du secteur de l’édition. Schiffrin est donc un peu l’équivalent dans l’édition d’un whistle blower : lorsqu’il publie sa trilogie au tournant des années 2000, il sonne l’alarme en passant du centre de l’édition pour migrer vers sa périphérie (quand il fonde The New Press, c’est en adoptant le modèle de la fondation à but non lucratif). C’est ainsi qu’il peut devenir le porte-étendard d’une cause et d’un mouvement dont les ramifications sont internationales. Cette défense de la bibliodiversité et de l’exception culturelle permet de nommer un problème de taille, soit les effets de la mondialisation sur les cultures précaires.
Mais ce modèle de l’éditeur indépendant à la fois activiste, poéticien et théoricien ne saurait être universalisé. L’indépendance doit inclure un ensemble de pratiques assez diverses. Le seul engagement de l’éditeur indépendant serait celui de trouver des manières politiquement adéquates de défendre la liberté d’expression et la pensée critique, que celles-ci se manifestent dans un ouvrage sociologique sur la violence raciale ou dans une nouvelle traduction de Virginia Woolf, et de ce fait, participer au maintien d’un écosystème éditorial dont les moyens et les fins ne sont pas réductibles à l’argent.
Une des caractéristiques majeures de l’édition indépendante au regard des grands groupes éditoriaux s’affirme dans une somme de valeurs : le courage, le risque, et l’exigence intellectuelle. Outre le discours politique, peut-on dire que l’édition indépendante jette également un regard moral sur la production et sur ce qu’elle produit ? Vous évoquez le courage et le risque éditorial presque uniquement pour un seul éditeur auquel vous consacrez une large réflexion : Paul Otchakovsky-Laurens, fondateur des éditions P.O.L. Pourquoi P.O.L vous semble-t-elle une maison singulière à cet égard ?
Il me semble que P.O.L était un exemple paradigmatique d’une indépendance parfaite sur le plan esthétique (innovation sans sectarisme, pour le dire vite) et imparfaite sur le plan commercial (inféodation au groupe Gallimard). Pourtant, le discours de Paul Otchakovsky-Laurens était sans ambiguïté : pour lui, l’indépendance éditoriale, c’était publier les livres qu’il désirait lire (suivant son instinct, ses désirs de lecteur). Il ajoutait même ne s’être jamais senti aussi indépendant qu’une fois son rachat par Gallimard complété. Les éditions Verticales ont une position semblable. Dans les deux cas, force est d’admettre que ce sont des exemples réussis de catalogues « exigeants » (même si le mot est assez faible conceptuellement, j’en conviens) en bénéficiant de la puissance de diffusion de Gallimard. J’ai donc inclus cet exemple dans mon livre pour être bien clair : l’indépendance ne doit pas être un tribunal de la pureté morale.


Par ailleurs, le courage et le risque éditorial dont vous parlez est le lot de nombreux éditeurs, et apparaît en effet comme l’une des caractéristiques de l’indépendance. Il appartient au sens commun de remarquer que certaines entreprises éditoriales sont plus risquées sur le plan financier (et c’est souvent ce qui est potentiellement ce qui est le plus payant sur le plan symbolique, sur ce point, je suis un bourdieusien orthodoxe) : premiers romans, poésie, traductions, sciences humaines, etc. Ce courage, cette prise de risque sont à la fois réels et narrativisés par les acteurs.
Si vous consacrez l’essentiel de vos analyses à l’édition française, vous n’oubliez cependant d’interroger le champ éditorial canadien, et plus particulièrement, québécois puisque, doit-on le préciser, vous enseignez à l’Université Queen’s à Kingston, au Canada. En quoi, selon vous, le marché et l’espace éditorial canadiens sont-ils très différents du marché français ? Vous parlez, s’agissant du Québec, d’une précarité notamment identitaire par rapport à laquelle l’édition doit se positionner : pourriez-vous nous en dire davantage ?
Le monde éditorial canadien a ceci de particulier qu’il est bilingue, et donc, à la fois complètement scindé (les défis y sont très différents dans le Canada anglophone et francophone, et même, au Québec et pour les communautés francophones hors-Québec) et unifié par un système de subvention fédérale. À ce bilinguisme du marché, ajoutons que de nombreux éditeurs autochtones viennent aussi remettre en question cette scission historique. L’édition au Québec s’est quant à elle développée à la fois contre la menace anglophone et contre le colonialisme commercial de la France. Elle s’est autonomisée relativement tard des grands éditeurs français et c’est dans les années 1970 que le marché s’est structuré sous l’impulsion du ministre Denis Vaugeois qui a fortement encadré (et professionnalisé, nationalisé) le milieu du livre. Le marché est beaucoup plus restreint qu’en France (on parle d’environ 8 millions de lecteurs francophones au Canada). Il s’agit donc d’un marché précaire, mais paradoxalement assez bien protégé par un système (imparfait) de subventions au fonctionnement.
La nouvelle et très compétente jeune génération d’éditeurs québécois cherche à créer des alliances avec des indépendants Français. Si, historiquement, la France a longtemps été relativement fermée à la littérature québécoise, il semble que les choses changent. De plus en plus nombreux sont les éditeurs québécois à être (correctement) diffusés en France (Remue-Ménage, Lux) ou alors à vendre des droits (on a vu récemment Kevin Lambert et Marie-Pier Lafontaine être publiés au Nouvel Attila, Éric Plamondon chez Quidam éditeur). Un système subventionné de traductions au Canada permet également des échanges entre la portion francophone et la portion anglophone.
Si le système éditorial québécois est subventionné, c’est donc pour des raisons nationalistes, pour protéger une identité nationale (une langue) minoritaire en Amérique du Nord. Mais certains ont montré que ce nationalisme éditorial (qui a son récit propre) était aussi parfois un lieu d’exclusion. Ainsi, nous avons vu l’apparition de Mémoire d’encrier, qui publie à la fois des textes issus de la diaspora caribéenne et des communautés autochtones, ou Hannenorak, spécialisée en littérature autochtone en français. Ici, on le voit, la propriété de la maison d’édition, son fonctionnement (ses moyens de production) sont au service sinon d’une cause, à tous le moins à la mise en visibilité de paroles généralement ignorées.

Enfin ma dernière question voudrait porter sur la notion de « luxe » qui donne en partie son titre à votre essai. Que faut-il finalement entendre par « luxe » au-delà de l’évidente provocation de votre titre tant on sait les difficultés financières de l’édition indépendante ? Vous évoquez « le luxe du communisme » : en quoi être éditeur indépendant finit-il par relever de ce luxe hérité des Communards ?
Mon idée est somme toute assez simple : l’indépendance devrait, en dernière instance, aspirer à une forme de gratuité de l’art et des idées, une plus grande démocratisation de la culture. En somme, si souvent dans le discours, l’indépendance est déceptive (mon titre fantôme : les ruines de l’édition, participait peut-être de cet imaginaire, c’est pourquoi je l’ai abandonné !), elle devrait être une manière de penser des formes alternatives d’économie de la culture. Le capitalisme avancé récupère tout, y compris, et avec force, les contenus créatifs et intellectuels. C’est donc le cœur de mon plaidoyer : il me semble que plus que jamais, la résistance anticapitaliste doit passer par une prise de contrôle des moyens de diffusion et de production de ces contenus créatifs et intellectuels. Ce luxe communal, dont Kristin Ross et Razmig Keuchayan ont élégamment reformulé les termes, revient donc à mettre le partage de la beauté et de l’intelligence au cœur de la vie citoyenne, non pas par élitisme ou par distinction bourgeoise. Au contraire, il s’agit plutôt de reconnecter l’art aux formes de vie, et réinsuffler de l’utopie dans l’espace public, de penser d’autres organisations du commun. S’agit-il là d’une posture romantique de ma part ? Peut-être. Mon livre sur l’indépendance vise toutefois à ramener ces idées utopiques, depuis leur ciel, jusqu’à des modes concrets d’organisation de l’économie. Il est d’autres façons de faire commerce des idées.
Johan Faerber, Diacritik, 22 mars 2021
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte