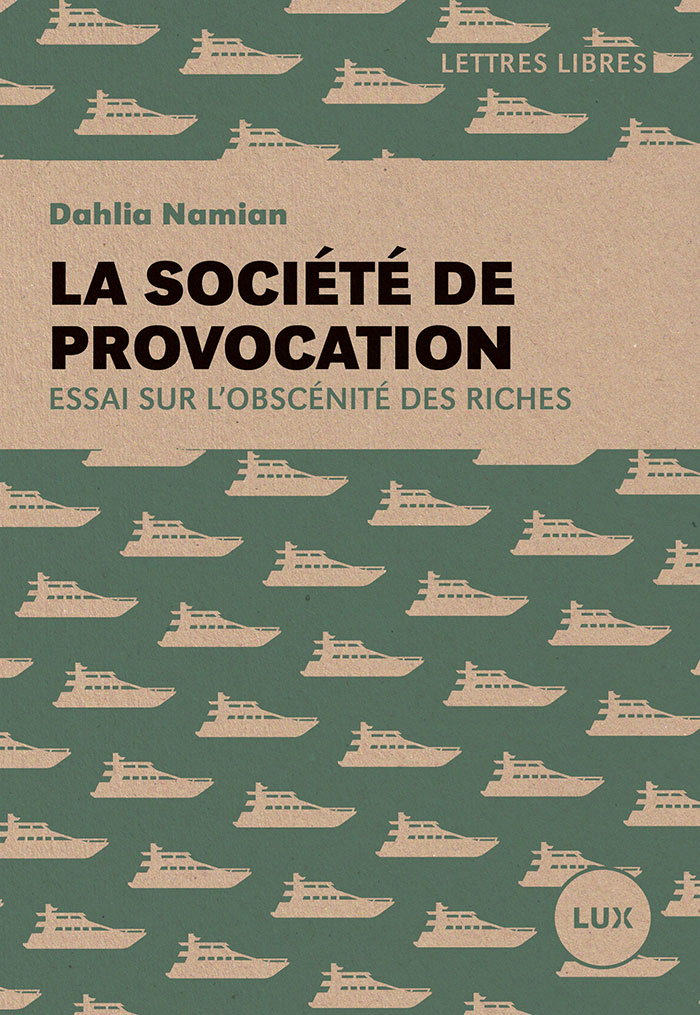Sous-total: $

Nous avons besoin de la socio
Ça m’a subitement frappée avec la mort la semaine dernière de l’auteure Caroline Dawson, et avec la lecture de l’essai de Dahlia Namian, La société de provocation, dont je vous ai parlé ici1. Ces deux femmes remarquables, qui ont mis des mots précis sur des situations délicates, inconfortables, l’ont fait à partir d’un point de vue commun. Elles sont toutes deux sociologues.
Dahlia pratique sa discipline à l’Université d’Ottawa, Caroline enseignait au cégep Édouard-Montpetit. Elles ont écrit avec un point de vue unique sur notre monde, celui donné par ce métier qui rend curieux, exigeant et empathique, et guidées par cette conviction profonde qu’ensemble, les individus forment, d’une manière ou d’une autre, un tout. Des sociologues, quoi !
Jeudi dernier, à propos du triple meurtre, dont celui d’un jeune de 15 ans, survenu sur le Plateau Mont-Royal à Montréal, Patrick Lagacé se demandait comment cela était possible2. Il tentait des pistes : la pandémie ? L’économie qui met de la pression sur tous ? La prolifération de maladies psychiatriques dans nos rues ? Le monde qui ne va pas bien ?
Dans nos maisons, nos lieux de travail, autour de la machine à café, nous, lecteurs, y allions de nos hypothèses. L’éducation ? Le civisme ? Les réseaux sociaux ? L’immigration massive, suggestion que j’ai beaucoup vue passer sur les réseaux sociaux. L’incompréhension était totale. Il y avait comme une soif de sens qui se heurtait au désarroi.
De quoi aurions-nous eu besoin à ce moment-là ?
Et à bien d’autres, d’ailleurs ?
Devant le monde qui se déglingue, des décisions politiques discutables, des évènements qui n’ont aucun sens ?
De spécialistes du tout et du rien, surtout du tout, de l’ensemble, de la globalité, qui replacent les choses dans leur contexte, qui essaient d’extraire ou de bâtir du sens autour de ce qui semble déroutant, trop nouveau, trop gros ou trop « toute ». Un docteur du corps social.
Je suis sociologue de formation. J’ai choisi ce parcours à l’université. J’avais envie d’une discipline qui s’attacherait à de larges ensembles, qui réfléchirait à la société actuelle et ses composantes : j’ai été gâtée. Ça aurait aussi pu être philosophie ou politique, mais j’aimais la riche palette d’objets que la socio embrassait. Dès la maîtrise, la radio m’avait déjà enjôlée, je n’ai donc jamais directement travaillé comme sociologue. Mais cette formation est résolument la base de mon travail. Elle est mon prisme pour construire des émissions de radio ou de télé. Elle a toujours outillé ma curiosité, donné de la profondeur à mes questions et à mon écriture. Elle est ma connexion sur le monde. Je suis une sociologue égarée dans les médias.
Il faut, j’en suis convaincue, réhabiliter la sociologie. C’est une science qui cherche à comprendre et à expliquer ce qui rend une société vivante. Elle s’intéresse aux mouvements sociaux les plus divers, à la construction des normes et des lois, à l’établissement des règles et des valeurs sociales. À l’essence de l’édifice de la société. Avec ses outils propres, sa façon de ne jamais perdre le tout de vue même en s’intéressant aux parties, de mettre en perspective des enjeux, avec sa part d’intuition, son sens de l’observation, la sociologie aide à comprendre le monde qui nous entoure.
Elle n’est pas la seule. Au passage, réhabilitons quelques sciences dites « molles ». La politique, l’histoire, la philosophie, l’anthropologie. Mal aimées, elles font pourtant le lien avec le passé, la culture générale, les cultures, les époques. Dans une société où les connaissances sont chahutées par le fossé générationnel, où la culture générale ne joue plus son rôle de socle commun, elles nous rappellent que les racines du passé sont garantes de l’avenir, y trouvent parfois un éclairage inédit pour des pistes de solution. Elles nous disent qu’il n’y a pas que l’« ici et maintenant ».
J’irais même plus loin. Je rêve de grandes institutions, d’entreprises, de ministères où un sociologue serait en résidence, veillant aux enjeux, au positionnement global, aux conséquences des actes.
Avec ses réflexions, le cafouillage de Desjardins autour de la Journée des patriotes aurait pu être évité, et la ministre France-Élaine Duranceau aurait été briefée convenablement sur les tenants et aboutissants de la crise du logement.
Actuellement, la plupart des organisations disposent de balises morales plus ou moins élaborées, de programmes EDI (équité, diversité, inclusion), de l’appui de firmes de relations publiques qui veillent au grain. Il s’agit là de mises en perspectives bien partielles, plus défensives qu’autre chose, souvent rattachées à des lobbys, même si elles peuvent avoir des effets positifs.
Je pense plutôt au bien commun. Un sociologue en résidence serait non partisan. Il éclairerait sur les enjeux et les conséquences des actes et des politiques, les replacerait dans une mouvance large. Parce qu’il se nourrit de données probantes, de points de comparaison, d’enquêtes de terrain. Que son souci est de connaître la perspective sociale plutôt que de savoir si la mesurette politique du jour « passe ».
Faire société. Voici ce à quoi nous aspirons tous, en ces temps inquiétants. Un sociologue inspiré au gouvernement, qui pousserait à penser en dehors de la boîte. Ça aiderait, dans notre quête collective de sens. Nous avons bien – et c’est heureux – un scientifique en chef.
Pourquoi pas un sociologue en chef du Québec ?
Marie-France Bazzo, La Presse, 28 mai 2024.
Photo: Martin Chamberland, Archives La Presse
Lisez l’original ici.
 Mon compte
Mon compte