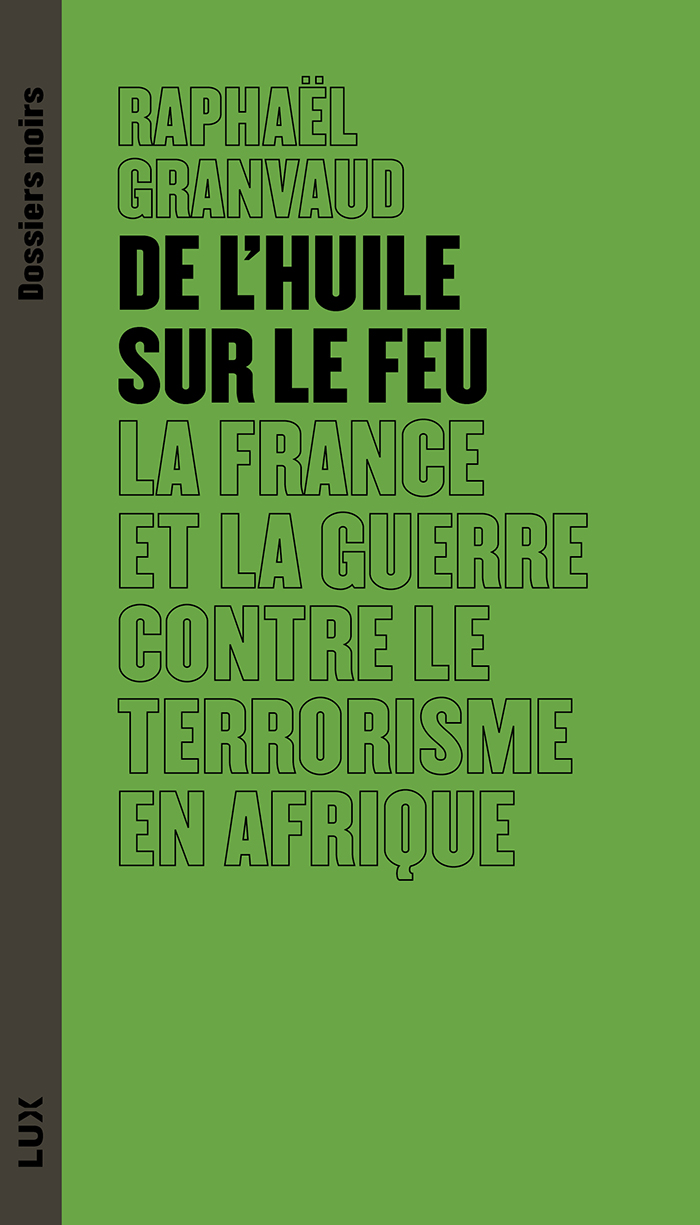Sous-total: $

Barkhane. De l’huile sur le feu et de l’eau dans le gaz
Le nouveau « Dossiers noirs » copublié par Lux et l’association Survie est consacré à la lutte antiterroriste de la France en Afrique, et plus précisément aux opérations Serval et Barkhane menées au Sahel ces onze dernières années. Son auteur, Raphaël Granvaud, revient avec moult détails sur les origines de cette guerre, sur ses conséquences et sur le « retour de bâton » qui a suivi.
Plus de onze ans après le déclenchement de l’opération Serval au Mali, en janvier 2013, et près de deux ans après la fin officielle de l’opération Barkhane, les enquêtes sur cette guerre de près de dix ans de la France au Sahel restent relativement rares. Cinquante-neuf soldats français y ont pourtant perdu la vie, et cette intervention, qui a coûté plusieurs milliards d’euros, a charrié un lot non négligeable d’alliances coupables, de « dommages collatéraux » et d’erreurs stratégiques qui ont abouti à l’échec militaire et à la politique que l’on connaît.
Fidèle à sa volonté de documenter le passé comme le présent de la Françafrique, l’association Survie consacre son dernier ouvrage de la collection « Dossiers noirs » (le quinzième, et le deuxième chez Lux Éditeurs) à cette longue « guerre contre le terrorisme », sous le titre volontiers provocateur : De l’huile sur le feu. Sous-entendu : la France, en prétendant vouloir « sauver » les pays sahéliens de la menace djihadiste, n’a fait qu’aggraver la situation, contrairement à ce que prétendent les dirigeants français.
Spécialiste de l’armée au sein de l’association et rédacteur du mensuel Billets d’Afrique, Raphaël Granvaud, qui se demandait, dans un précédent ouvrage, Que fait l’armée française en Afrique ? (Agone, 2009), propose une autopsie détaillée et sans concession de cette opération extérieure qui a viré au fiasco. Il constate que « même si les autorités politiques et militaires françaises ont mis très longtemps à le reconnaître, la situation au Sahel n’a cessé de se dégrader », que cet échec stratégique, doublé d’une ingérence politique permanente et « toujours aussi paternaliste », a abouti à « une hostilité grandissante des populations africaines » vis-à-vis de la présence militaire française, et que, « loin d’en tirer les leçons », la France a préféré accuser ses partenaires (africains, européens) ou ses adversaires (la Russie notamment) plutôt que de repenser son rapport à l’Afrique.
Il ne s’agit pas, pour Granvaud, de prétendre que l’État français serait le seul coupable de cette situation, ni de dédouaner les autres acteurs locaux et internationaux de leurs responsabilités – il le précise dès le début. Son ambition est de « rendre compte des modalités méconnues de l’intervention française et de ses effets », et de contribuer à « nourrir les mobilisations qui restent nécessaires » pour en finir avec les ingérences militaires de la France en Afrique.
[…]
Lisez la suite ici.
Afrique XXI, 17 mai 2024.
 Mon compte
Mon compte